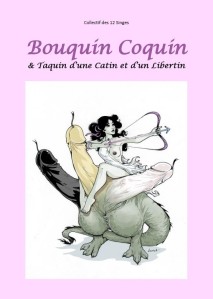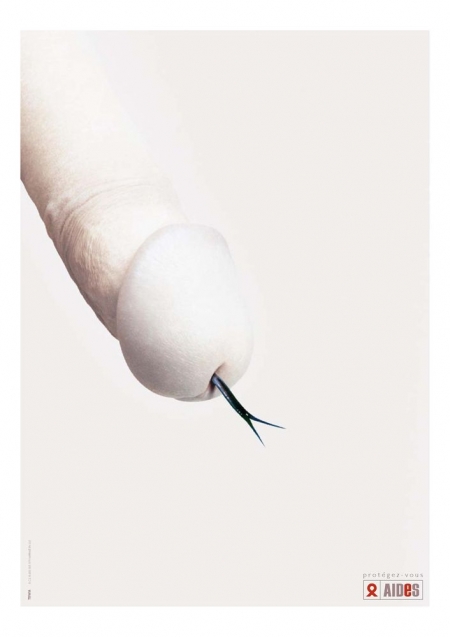• Historienne : En effet, même si dès 1935 il y eut un premier projet de loi visant la fermeture des « maisons », présenté par Henri Sellier, ministre de la Santé Publique sous le gouvernement de Front Populaire. Il fut adopté par l'Assemblée nationale, mais le projet fut rejeté par le Sénat (conservateur certes, mais d'habitude pas dans ce genre de sens). Il faut dire que les tenanciers disposaient de moyens de pression sur une partie du personnel politique qui, habitué de leurs établissements, dévoilait du coup ses petites manies sexuelles. Comme la prostitution accompagnait toujours les armées en campagnes (voire y était même organisée, comme à Bangkok lors de la guerre du Vietnam), les nazis firent fonctionner, entre 1940 et 1944, une véritable machinerie du sexe tarifé à l'usage de leurs soldats stationnés en France (les « maisons de tolérance » étant assimilées aux « spectacles de 3è catégorie » et obtenant leur rattachement au « Comité d'organisation professionnelle de l'industrie hôtelière »), Vichy assurant à la fois l'ordre moral, la surveillance policière des établissements (la « collaboration horizontale » n'étant pas seulement affaire de sexe, mais aussi d'argent et de répression), et la surveillance médicale de leurs employées. Dès l'avènement du Maréchal, puis l'entrée des contingents d'occupation sur le territoire national, les pouvoirs publics, français et allemands, firent de la réglementation de la prostitution une priorité : la rue pour les plus jeunes, les maisons « civiles » pour les irritables, les bordels allemands pour les mieux élevées. Prophylaxie des maladies vénériennes intensifiée de concert avec les nazis, mais pas seulement. Le gouvernement de Vichy imposa peu à peu un réglementarisme singulier, conférant à la maison de tolérance, sanitairement plus sûre, une forme d' « exclusivité » du commerce vénal : les tenanciers furent accueillis au sein des structures corporatives hôtelières, puis ils devinrent imposables fiscalement (1941-1942). Plus encore, l'État pourchassa les proxénètes, intermédiaires gênants dans ce nouvel organigramme et désignés comme les « responsables masculins de la défaite » (1940 et 1943). Pour autant, beaucoup de filles ne racolaient pas publiquement mais exerçaient en maison, ceci freinant considérablement l'ouverture d'une instruction du fait que la loi du 20 juillet 1940 restreignait la définition du souteneur à celui qui protège... le racolage public (même si l'on pouvait tout autant comparaître au titre de l'article 334 du Code pénal pour avoir fait office d'intermédiaire). Ainsi, toutes les femmes « en carte » draguant des soldats allemands en-dehors des maisons closes estampillées Wehrmacht ou tenue par elle (les FTP, résistants communistes, prirent volontiers pour cible les bordels, une manière comme une autre de nuire au moral de l'ennemi), étaient considérées comme un risque pour la sécurité, certaines prostituées patriotes venant en aide aux résistants (à qui elles donnaient des informations glanées sur l'oreiller, qu'elles cachaient ou dont elles abritaient certaines réunions). La règle était les « maisons d'abattage », temples du sexe à la chaîne, où des malheureuses promises à une décrépitude physique accélérée et aux maladies vénériennes, devaient contenter jusqu'à soixante hommes par jour en dix heures au moins d'activité. 1 500 femmes étaient encasernées à Paris dans des maisons closes et 6 600 autres exerçaient à même le trottoir (un nombre en baisse puisque six ans plus tôt on en comptait 8 000). Beaucoup étaient mineures, la majorité étant alors de 21 ans, et une grande majorité d'entre elles était atteinte de maladies vénériennes (astreintes réglementairement à une visite médicale hebdomadaire, seules 500 se présentaient, accueillies par seulement trois médecins). On comptait également 1500 lupanars dans toute la France, dont 200 pour la seule ville de Paris. Le secteur du plaisir tarifé constituait donc une entité économique non négligeable, doublée d'un lobby qui savait défendre ses intérêts (avec un « syndicat » occulte des bordeliers, l'Amicale des maîtres d'hôtel de France et des colonies, siégeant dans l'arrière-salle d'un café de la porte de Clichy, et regroupant les gros s-exploitants). Une réalité qui émut Marthe Richard, conseillère municipale de Paris (une des 9 élues femmes sur 88 dans la foulée de la Libération) mais personnage au passé tumultueux. Née en 1889 dans la Meurthe-et-Moselle, elle quitta le domicile familial pour s'en aller vivre la grande vie ... c'est-à-dire tapiner sur le trottoir nancéen avant d'échouer au bordel. Arrêtée, fichée par la police des mœurs, elle se découvrit syphilitique, ce qui ne l'empêcha pas de repiquer au tapin, à Paris dès 1907. Femme d'avant-garde, elle fut la sixième Française à décrocher le brevet de pilotage d'avion. Ecartée pendant la guerre par Vichy, où elle tentait de faire son trou, Marthe se retrouva FFI à l'été 1944 puis conseillère municipale de Paris. La Libération survint à temps pour mettre fin au cauchemar des tripots malfamés, et le rêve des uns fit les mauvaises nuits des autres. Nombre d'établissements s'étant montrés « tolérants » (et bien plus) sous l'Occupation (la France étant considérée comme une zone de repos pour les soldats allemands venant du front de l'Est), à partir de l'été 1945, Marthe Richard lança une véritable croisade contre les maisons closes. L'époque s'y prêtait plutôt bien : quelques mois plus tôt, certains patriotes (souvent tardifs) avaient mis les bouchées morales doubles, tondant en public les « traîtresses » coupables d'avoir pratiqué la « collaboration horizontale » avec les Allemands. Ainsi, soucieux de rattraper son retard à l'allumage côté Résistance, le parti communiste se lança dans un ultranationalisme virulent, lequel allait de pair avec un moralisme non moins agressif (la compagne de Maurice Thorez, secrétaire général du parti, conjuguant bientôt antiaméricanisme et lutte contre la libre sexualité ou le contrôle des naissances, « armes de l'impérialisme » ; l'URSS aurait fait disparaître, entre autres maux hérités du capitalisme, prostitution et homosexualité). Marthe Richard présenta donc son projet au conseil municipal de Paris le 13 décembre 1945, sous l'œil placide du président de séance André Le Trocquer (qui, ironie du sort, tombera en 1959 dans l'affaire de mœurs dite des « ballets roses », une affaire de prostitution de mineures). Le public y était presque entièrement composé de tauliers, de macs et de putains (avertis par leurs indics dans les milieux politiques). Le 17 décembre, le préfet de police de Paris se rangea publiquement aux raisons de Marthe Richard, décidant la suppression des maisons de tolérance dans le département de la Seine. Le président Le Trocquer semblait moins convaincu, il multiplia les artifices de procédures pour retarder le vote, qui fut un triomphe pour Marthe Richard avec 69 voix pour et une seule contre (un politique client d'un boxon sadomasochiste). Quinze jours plus tard, le dossier fermeture fut propulsé au niveau national. Voté le 17 décembre 1945, l'arrêté préfectoral fermant les maisons closes dans le département de la Seine fut publié le 21 janvier 1946, le lendemain de la démission de De Gaulle (en guerre ouverte avec l'Assemblée constituante). Le 9 avril, la proposition de loi arrive enfin en discussion. Le 13 avril, la loi stipulant que toutes les maisons de tolérance seront interdites sur le territoire national fut promulguée, accordant un délai de six mois pour fermer les maisons. Sa campagne anti-maisons closes lui valut des attaques du lobby des tauliers (qui devaient déjà participer à la reconstruction du pays en payant l' « impôt de solidarité national »), associé à la police (qui d'autre serait au courant de son fichage d'antan à la Mondaine ?), son passé tumultueux (héroïnomane, arriviste, mythomane, collabo, résistante) remontant à la surface.
• Animateur : Pourtant, cette solution n'en fut pas réellement une, ni à long terme ni même à court terme ?
• Historienne : Persuadée de tirer un trait sur ce passé sulfureux, la classe politique (qui avait également quelques accointances avec le milieu) décida la fermeture des maisons closes. Mais les politiques ne réalisèrent pas alors qu'ils ouvraient ainsi la boîte de Pandore, la prostitution non contrôlée proliférant, pour le plus grand profit des proxénètes. La fermeture des maisons closes en avril 1946 fut ainsi ressentie comme une grossière erreur par les policiers, les proxénètes « accrédités » étant leurs meilleurs informateurs (pour prix de leurs services, ils obtenaient un « condé », l'oubli d'un délit, la faculté de violer impunément la réglementation) et les tauliers/tenancières étant leurs meilleurs auxiliaires dans ce milieu où le crime est souvent lié à la débauche. Avec la fermeture des « maisons closes », il y eut un renforcement de la lutte contre le proxénétisme, la création du délit de racolage, la création du fichier sanitaire et social de la prostitution et de la surveillance médicale des personnes prostituées, ainsi que des dispositions pour la « rééducation » des femmes prostituées. Mais chassez la prostitution et celle-ci revient au galop : un an à peine après la fermeture, la police recensait déjà 200 lupanars clandestins (sans compter les bordels militaires fonctionnant dans les ports et villes de garnison - à la Légion étrangère, on appelait le lupanar un « pouf »). De fait, dès 1947, il y eut des tentatives de réouverture des « maisons de tolérance », avec toutefois un vernis d'humanisme puisque la France adhéra à la Convention Internationale du 2 décembre 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui ... mais ne la signa pas. Ratifiée finalement en 1960, la France avait pour autant crée en 1958 l'Office Central pour la Répression de la Traite des êtres humains (OCRTEH) dans le cadre du ministère de l'Intérieur, et modifia sa législation : intensification de la répression du proxénétisme (la cohabitation avec une femme prostituée devint un délit - d'où l'impossibilité pour elles d'avoir une « vie de couple normale ») ; création de la contravention dite « racolage passif » ; suppression du fichier sanitaire et social de la prostitution et de la surveillance médicale des personnes prostituées ; prévention et réinsertion des personnes prostituées. Les années de libération sexuelle virent le vieux débat revenir sur le devant de la scène, notamment avec en 1970 la proposition de réouverture des maisons closes (dénommées « cliniques sexuelles ») lancée par le docteur Claude Peyret, député UDR de la Vienne, et Jacques Médecin, député PDM, maire de Nice, mais plus étonnant encore avec le retour de Marthe Richard, cette fois pour proposer en 1972 d'ouvrir des « Eros Center » (accompagnée en cela par Kurth Köhls, un promoteur allemand et Jacqueline Trappler, qui se prostituait à Mulhouse). Mais ce fut également l'année du début de la fiscalisation des revenus des personnes prostituées.
• Animateur : Justement, à la libération sexuelle de tout un chacun allait succéder la Révolution des « mœurs légères » !
• Historienne : Qui plus est en 1975, année internationale de la Femme ! C'est d'ailleurs la première fois qu'il y avait participation à visage découvert de femmes prostituées, notamment avec « Ulla » dans l'émission télévisée des Dossiers de l'écran (à grand audimat). Ce que l'on a appelé plus tard la « Révolution de la prostitution » apporte non seulement un éclairage sur les conditions du passage à l'action collective d'une population aussi marginale et stigmatisée que les prostituées, mais aussi sur leurs rapports difficiles avec le travail social de l'époque (bien qu'elles avaient vu des éducateurs en maison maternelle ou en prison, qu'elles avaient connu des assistantes sociales, elles estimaient que cela n'apportait absolument rien, non que le personnel social n'accordait pas l'aide demandée, mais plutôt que les papiers traînaient des mois et des mois), sur la dimension affective qui imprégnait leur rapport à leurs éventuels proxénètes, ainsi que sur l'impitoyable stigmatisation que produisait alors une attitude policière centrée sur le fichage et la répression. En fait, le mouvement de 1975 survint à Lyon (puis fit tâche d'huile), dans un contexte spécifique de déstabilisation du milieu prostitutionnel après la mise à jour de divers scandales politico-financiers entre policiers et proxénètes lyonnais et par la poursuite plus sévère des prostituées par la justice et le fisc. La lutte des prostituées a débuté au printemps 1975. Cette action était destinée à protester contre la répression policière dont les prostituées lyonnaises étaient alors victimes : verbalisées plusieurs fois par jour pour racolage passif et régulièrement raflées, celles-ci étaient depuis peu menacées de peines de prison ferme en cas de récidive dans le délit de racolage, ce qui exposait celles qui étaient mères de famille à perdre la garde de leurs enfants. Trois jeunes filles avaient été frappées par cette loi. Alors les prostituées décidèrent que ces jeunes filles n'iraient pas en prison, et de ce fait, ont caché ces femmes. Et de là s'est déroulé tout un système qui a fait que les péripatéticiennes en avaient ras-le-bol parce qu'elles ne pouvaient plus travailler, ayant constamment sur le dos la police à la recherche des fuyardes. Pour un oui, pour un non, il y avait un « emballage » qui n'avait aucune raison. Leur ras-le-bol de la répression policière était très fort, mais affleurait aussi leur désir de parler d'elles, de leur vie, de leur santé, de leurs problèmes afin de faire tomber les préjugés qui les dégradent (la honte, la culpabilité, la méfiance, le refus d'une médiatisation racoleuse et d'une exploitation mercantile de leur souffrance). Les prostituées voulaient ainsi que l'opinion publique sache exactement ce qu'est une femme prostituée, que l'on supprime ce mythe de la prostituée au coin de la rue, bien maquillée, sans famille, sortant des bas-fonds, sans instruction, la bête, le sexe, et c'est tout : elles voulaient montrer qu'il y avait une tête, qu'il y avait un cœur, un sexe aussi, bref que les gens s'informent, parce que les prostituées étaient trop marginales. Par exemple, il y a une loi que les filles font elles-mêmes : si un gars tombe pour elles, c'est-à-dire si ce gars va en prison parce qu'il leurs a offert une amitié ou de l'amour ou de l'affection, leur point d'honneur est de l'assister en prison. Lorsqu'il ressort, qu'il est délinquant, qu'il ne trouve pas de boulot, elles continuent à l'aider même s'il n'y a plus rien entre eux. Alors là, ça en faisait un proxénète car on n'acceptait pas qu'une prostituée soit avec un homme à qui elle peut trouver autre chose que ce qu'elle trouve sur le trottoir, un peu d'intimité avec quelqu'un. Dans la même veine, à l'époque, lorsqu'une femme voulait se retirer de la prostitution, il fallait qu'elle aille se faire déficher, alors que le fichage (photographies et empreintes) n'était pas censé exister (du moins au motif de prostitution, donc les filles étaient fichées en tant que délinquantes). Beaucoup considéraient d'ailleurs que c'était la police qui les avait forcées à continuer de se prostituer, car parce qu'elles étaient fichées, c'était terminé ! Une centaine de prostituées lyonnaises, emmenées par leurs leaders Ulla et Barbara, décidèrent ainsi d'occuper en juin l'église Saint-Nizier à Lyon, d'abord parce que l'église était le seul endroit où les forces publiques ne pouvaient les sortir. Les prostituées étaient d'ailleurs soutenues par les catholiques du Nid et par des féministes qui faisaient le parallèle entre mariage et prostitution et pour lesquelles la prostitution était le paradigme de l'oppression d'une classe de sexe sur l'autre. Le Mouvement du Nid était certes l'allié privilégié des prostituées, mais il voulait les inscrire dans un mouvement de « conscientisation », pour favoriser la prise de conscience de leur « aliénation ». Leur influence se lut dès le début du mouvement dans la présentation publique des prostituées comme mères avant tout. L'encadrement social de la prostitution s'était mis en place au début des années 1960 lorsque que la France s'est ralliée aux thèses abolitionnistes (faisant ainsi reculer les positions dites règlementaristes) en acceptant de ratifier la convention de l'ONU de 1949 « pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui ». Redéfinie juridiquement, la sexualité vénale devint une activité privée et seul le racolage était poursuivi. Les prostituées étaient considérées comme des victimes souffrant de handicaps socioculturels et étaient prises en charge par les travailleurs sociaux. Des associations privées, dont l'Amicale du Nid, fondée dans la mouvance des catholiques sociaux, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s'occupaient du traitement social de la prostitution. L'Amicale du Nid, composée de travailleurs sociaux salariés, était issue d'une scission, intervenue en 1971, avec le Mouvement du Nid, association fondée en 1949 dans la mouvance de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et dont les militants, entendant œuvrer pour un « monde sans prostitution », assuraient sur les trottoirs une présence humaine auprès des prostituées en détresse. Les membres du Mouvement du Nid ont joué un rôle important lors de la révolte des prostituées en mettant leurs compétences et savoir-faire militants au service de prostituées novices en matière d'action collective protestataire. Le considérable, et largement inespéré, retentissement médiatique de cette occupation rallia non seulement aux prostituées lyonnaises le soutien de plusieurs organisations politiques, syndicales et féministes, mais il incita également les prostituées d'autres villes (Paris - suite à la fermeture du service « Saint Lazare » où les femmes prostituées étaient conduites après les rafles par la police -, Grenoble, Marseille, St-Etienne et Montpellier notamment) à occuper à leur tour des édifices religieux, ce qui a contribué à ce que les filles se resserrent vraiment. Alors que le gouvernement n'aurait jamais pensé que les prostituées lyonnaises se révolteraient à ce point, et surtout qu'elles tiennent le coup aussi longtemps (dix jours), refusant de répondre aux demandes de négociation des prostituées (la secrétaire d'Etat à la Condition féminine de l'époque, Françoise Giroud, s'était déclarée « incompétente »), le gouvernement mit fin aux occupations par une évacuation brutale des églises par la police au matin du 10 juin. Critiqué pour cette brutalité et pour son indifférence au sort malheureux des prostituées, le gouvernement tenta alors de restaurer son image en confiant une mission d'information sur la prostitution au Premier magistrat de la Cour d'appel de Versailles, Guy Pinot. Les prostituées, de leur côté, ne s'avouaient pas vaincues et, tout en acceptant de se rendre aux consultations ouvertes par G. Pinot, tentaient de maintenir leur mobilisation en vie par une série de meetings (à la Bourse du travail de Lyon en juin et à la Mutualité de Paris en novembre) ainsi que par des actions protestataires sporadiques, telles le bombage à la peinture de sex-shops accusés d'être, bien plus qu'elles, des « incitateurs à la débauche ». Malheureusement pour elles, les obstacles que rencontre toute action collective d'une population dépourvue de tradition et de savoir-faire en la matière eurent rapidement raison de leur ardeur militante. Incapables de se doter d'une organisation stable apte à relayer leurs revendications dans la durée, affaiblies par des dissensions internes, les prostituées subirent également le contrecoup de la défection d'Ulla et de Barbara qui préférèrent le retrait de la prostitution et l'écriture d'ouvrages autobiographiques à la poursuite de la lutte. Dans le même temps, le « rapport Pinot », remis au gouvernement en décembre 1975 mais dont les recommandations ne furent jamais examinées, fut « enterré ». Peu après, un vaste réseau de proxénétisme fut découvert à Paris et sa responsable, « Madame Claude », devint une célébrité. En parallèle, pour défendre « la liberté et la dignité des femmes prostituées », des hôteliers marseillais qui s'étaient enrichis dans les quartiers de prostitution créèrent une association nommée Association de soutien des commerçants de Marseille. Ulla, leader du mouvement lyonnais de 1975, reconnaît aujourd'hui avoir agi sur ordre des proxénètes du milieu local. Respectivement considérées comme la chef de file et la « numéro 2 » du mouvement, Ulla et Barbara ont en grande partie construit leur légitimité de leaders sur leur capital scolaire de niveau bac, supérieur à celui de la moyenne des autres prostituées, ainsi que sur leur position relativement favorisée au sein de la hiérarchie interne au monde de la prostitution (liens avec le milieu des proxénètes pour la première, spécialisation dans la clientèle masochiste pour la seconde). Dans le cas d'Ulla, il existait des liens étroits, quasi indissolubles, entre elle et celui qui fut à la fois son mari, le père de sa fille et son souteneur. Liens qui passent par l'amour, les coups, les affaires tordues, les humiliations incessantes, mais aussi l'argent, les voitures de course, le luxe, accompagnés de l'insécurité et de l'errance. Ulla montre à l'envie que la prostitution n'est pas un métier comme un autre et surtout l'extrême difficulté, pour celles qui le souhaitent, à sortir du cercle prostitutionnel. Cette difficulté tient autant à une société où il est difficile d'échapper à son passé de prostituée, qu'aux liens personnels et étroits qui unissent les « protégées » et leurs proxénètes. Dans le cas d'Ulla, mais c'est vrai aussi pour d'autres, les proxénètes ont été de véritables soutiens, voire plus, au mouvement qui leur permettait de desserrer l'étau étroit du fisc et de la police d'alors (intensification de la répression du proxénétisme avec les lois des 9 avril - avant le mouvement - et 11 juillet - après). Ce fut le point aveugle du mouvement de 1975. Après le mouvement, il y eut le collectif des femmes prostituées. Il était important car ce n'était plus une ou deux personnes, mais il regroupait toutes les jeunes femmes qui étaient mises en cause, qui se sentaient touchées par le problème. De fait, les femmes ont eu à se connaître, à s'aimer, à se comprendre, choses souvent très dures dans ce milieu de compétition (plus entre proxénètes qu'entre filles, mais quand même). Alors qu'auparavant une femme qui était convoquée à la police y allait et se débrouillait toute seule, après la révolte elle était accompagnée de ses consœurs. Automatiquement les flics leur fichaient davantage la paix, les laissant un peu plus tranquilles. Après le mouvement, en 1978, Joël le Tac, député du 15e arrondissement de Paris, présenta une proposition de réouverture des « maisons ». En 1990, les associations de prévention se réclamant d'une démarche de santé communautaire après l'apparition du virus du Sida, firent ressurgir la question du contrôle sanitaire des prostituées. Michèle Barzac, médecin, ministre PS de la Santé, présenta un projet de réouverture des maisons closes. En 1994, la réforme du Code Pénal supprima la pénalisation pour cohabitation avec une personne prostituée (en parallèle, des faits de proxénétisme pouvaient être qualifiés de crime) ainsi que la pénalisation pour « racolage passif ». En bref, les choses n'avaient pas tant évolué que ça, même si certains fondamentaux furent apaisés !