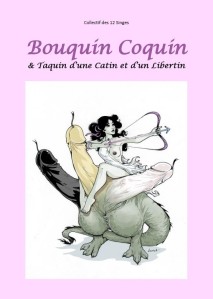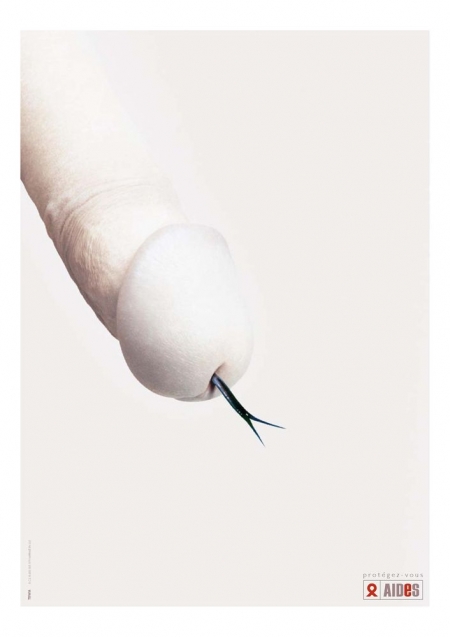• Historienne : Comme dit plus tôt, dans l'Occident médiéval, l'Eglise toute-puissante ne jetait pas la pierre à la pécheresse, inspirée en cela par l'exemple biblique de Marie-Madeleine. Les « châteaux gaillards » fonctionnaient tout à fait officiellement. Mais ce bel équilibre fonctionnait en temps de paix car en période de conflits, viols et exactions étaient l'apanage des combattants (même les croisés). Après la « libération » de la Renaissance, la période suivante avec la Réforme et la Contre-Réforme vit un « détournement de la sexualité », un retour de balancier avec un renouveau de l'ordre moral. A la suite du Concile de Trente, l'ambiance de tolérance légale et judiciaire à l'égard de femmes qui incarnaient dans la vie sociale les figures érotico-vénales prit fin. On assista alors à une marginalisation croissante des prostituées, qui étaient à la fois cantonnées et taxées, écartées et intégrées. Même le climat de la cour des papes changea après le Concile : il n'était plus possible de mener une carrière de courtisane « honnête » et cultivée, comme celle d'Imperia/Lucrezia dont le salon avait été fréquenté par les humanistes de l'entourage du pape Jules II. Pourtant ce n'étaient pas des conduites sexuelles scandaleuses qui en faisaient, de plus en plus, un gibier d'inquisition. En fait le Saint Office s'intéressait aux incantations « magiques » (à la différence des médecins, les religieux ne s'intéressaient pas directement à leurs savoirs sur le corps - qu'elles manipulent, embellissent, parfument et soignent par la parole - et à l'usage illicite qu'elles pouvaient en faire), conjurations et oraisons « pour l'amour » qui semblaient être un savoir spécifiquement lié au métier : complexité culturelle de ce savoir (entre oral et écrit, entre manuscrit et imprimé) et lien à la performance rituelle dont les prostituées étaient reconnues comme les seules officiantes efficaces, c'était dans l'ambivalence (sociale, culturelle et symbolique) des prostituées que s'enracinait leur pouvoir d'intermédiaires. La détention supposée d'un savoir tenait, d'une part, à leur connaissance intime et secrète du corps et des manifestations physiques et mentales du désir et, d'autre part, à la position marginale et clandestine dans laquelle elles se trouvaient de plus en plus cantonnées. La prostituée pouvait donc, tout particulièrement à cette époque, incarner la figure, par ailleurs bien attestée, de « l'illettrée-savante ». De plus, l'oralité qui véhiculait les connaissances des prostituées, reposant sur l'idée d'une force non seulement des mots mais de la voix, évoquait le « chant des sirènes », métaphore qui renvoie à leur capacité merveilleuse d'attirer les hommes et de les enjôler. Vers le milieu du XVIè siècle, une série d'ordonnances déclencha le mouvement de ségrégation. En 1549 on interdit aux prostituées d'habiter certains quartiers de Rome, en 1556 de se confondre avec les « honnêtes femmes » à l'église et en 1557 de racoler pendant le Carême (cette clandestinité allait de paire avec le caractère secret de leur savoir, surtout que lire et écrire étaient des compétences d'autant plus puissantes que pour les acquérir elles s'étaient heurtées à l'interdit social ; face à la conception dominante qui voyait dans l'apprentissage de la lettre une discipline chrétienne de l'âme et du corps, émergeait donc une tout autre pratique). En 1566, Pie V, avec son projet de les confiner dans un espace qui leur soit propre, inaugura le tournant répressif de la Contre-Réforme : trois ans plus tard, on commença à circonscrire de murs et à fermer de portes leur quartier réservé, qui devint un véritable ghetto, et à cela s'ajouta le renforcement de la pression fiscale (notamment diverses taxes pour financer les travaux publics). Dans ce contexte, la fondation de refuges pour accueillir et éduquer les « repenties », pratique déjà courante à l'époque médiévale, prit une signification nouvelle par rapport à l'ambivalence ecclésiastique et normative antérieure - pour qui la prostitution était un phénomène à tolérer à l'intérieur d'une politique de contrôle social de la sexualité. Désormais le rachat pédagogique des prostituées était plus ou moins assimilé à celui des figures de l'altérité absolue, juifs et musulmans, eux-mêmes diabolisés car exclus de la grâce de Dieu. Cependant la persécution judiciaire et le projet de moralisation promus par les autorités de l'Eglise cohabitaient paradoxalement avec la liberté d'exercer des prostituées qui payaient les taxes communales, ce qui affaiblissait singulièrement les principes proclamés d'une telle politique et inaugura une longue période de double jeu. Plus mobiles, plus dissimulées et plus nombreuses, les femmes qui, entre XVIè et XVIIè siècles, se vouaient au commerce du sexe, devaient affronter les normes rigides promues par la Contre Réforme. A cause de leur métier et des pratiques irréligieuses, blasphématoires et sacrilèges qui lui étaient associées, elles devinrent un gibier d'inquisition. Les prostituées tombaient donc sous le coup de la loi inquisitoriale, mais moins parce qu'elles exerçaient un métier scandaleux (celui-ci, s'il se conformait aux règles locales, n'était pas, de fait, interdit), que parce qu'elles posséderaient des connaissances spécifiques, un corpus de textes efficaces, une compétence énonciative qui, faisant intrinsèquement partie des instruments de leur office, les plaçaient en marge du peuple chrétien. En France (depuis 1560), en Espagne (depuis 1632) et dans tous les pays protestants, la prostitution sera ainsi pourchassée (assortie d'une condamnation du proxénétisme), mais comme les actions seront plus ou moins sévères et plus ou moins persévérantes, suivant les époques, le phénomène va perdurer : il lui suffisait de s'adapter, et de se développer dans la clandestinité. La politique royale de répression commença en 1560 avec l'ordonnance d'Henri I décrétant la fermeture des bordels dans toutes les villes de France. Pour autant, le Roi-Soleil fut déniaisé fort jeune par une professionnelle, ce qui ne l'empêcha pas d'instaurer la Salpêtrière, cette abominable prison pour femmes « perdues » (pour qui ?). Lui qui aspirait à être « un parfait modèle de vertu », fut pourtant avec Henri IV le roi bourreau des cœurs par excellence (une chanson populaire chantait les amours du roi : « Laissez baiser vos femmes, les nôtres en font autant »). Sa carrière de séducteur commença d'ailleurs peu de temps après sa prise de pouvoir en 1661 avec la duchesse de La Vallière, qui fut sa première maîtresse (prendre une maîtresse, pour un souverain, ne relève pas seulement de la puissance virile magnifiée mais aussi d'une stratégie de pouvoir visant la politique tant intérieure qu'extérieure. Il eut avec elle quatre enfants, et commit un adultère simple car sa maîtresse n'était pas mariée (mais lui oui, depuis seulement un an, avec l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, sa cousine germaine, dans le cadre du traité des Pyrénées qui fixait les frontières entre la France et l'Espagne). Les choses se compliquèrent avec sa longue et prolifique liaison (1667 à 1681, huit enfants illégitimes) avec madame de Montespan, épouse du marquis du même nom. Avec elle, le roi commettait un double adultère. La faute s'accentua encore à partir de 1674, année où il séduisit la gouvernante des enfants qu'il avait eus avec la belle Athénaïs, la future madame de Maintenon (d'ailleurs choisi par celle qu'elle allait remplacer). A partir des années 1680, Louis XIV mit un terme à une longue vie de libertinage afin de s'acheter une conduite. Et ce furent les filles publiques qui firent les frais du revirement d'un monarque vieillissant sous l'influence du parti dévot et de l'austère Mme de Maintenon afin de se rapprocher d'un modèle éthique plus rigoureux. Le laxisme et la tolérance des siècles précédents disparurent à cause du « mal de Naples », la syphilis, qui progressait (la première tentative de sanitarisme dans le domaine de la prostitution remontait pourtant à 1360, avec l'établissement par Jeanne Ière, reine des Deux-Siciles, d'un bordel en Avignon où les filles étaient largement contrôlées par des médecins et une abbesse), mais aussi en raison du moralisme des protestants puis des catholiques, prônant un redressement des mœurs. Mais la fermeture des bordels et des étuves, la surveillance des cabarets et des auberges par la police conduisit les putes (du sanscrit poutri, qui signifie fille, dont le diminutif en serait pucella, et le péjoratif, putana ; il est à noter qu'il n'a été pris en mauvaise part qu'assez tardivement : quand un garde-suisse disait à Madame de Fontanges - une des maîtresses de Louis XIV - « Vous pouvez entrer, je sais que vous êtes la putain du Roi », il n'avait pas l'intention de l'offenser) à se cacher et à tomber dans la clandestinité et l'illégalité. Certains établissements existaient toujours malgré les interdictions sans cesse renouvelées (en 1619, 1635, 1644, 1667). Pour autant, la plupart des filles étaient à la merci des maquereaux (« maque » signifiait vente, métier de marchand ; de là sont venus maquignon, maquerel ou maquereau, ce dernier n'étant qu'un maquignon - vendeur de bétail au détail - de femmes) et autres ruffians (aventuriers) qui pratiquaient l'abattement de nez au rasoir afin de mater les rebelles ou les indépendantes. A Paris, pour tromper la police, elles s'habillaient comme les autres femmes, opéraient de jour et non de nuit, à proximité voire directement dans les lieux fréquentés. La grande majorité de ces fausses promeneuses, surnommées les « pierreuses » ou les « coureuses », étaient de pauvres filles venues des campagnes environnantes ou vendues par leur famille. La misère et les multiples crises du XVIIè siècle furent toujours les grandes pourvoyeuses de la prostitution, sachant que même les femmes mariées vendaient leur corps occasionnellement pour survivre. Pour éviter les rafles policières dans la rue ou les établissements clandestins, les proxénètes imaginèrent le système de call girls, ne gardant aucune fille à demeure. A la fin du XVIIè siècle, la police fut totalement débordée par toutes ces formes de prostitution, demandant même au roi la réouverture des bordeaux, plus faciles à contrôler, mais le roi refusa, préférant rester dans une logique d'enfermement, d'abord appliquée aux pauvres et mendiants à partir de 1656 avec la création des hôpitaux généraux, puis étendue aux prostituées en 1684 grâce à trois ordonnances. La première, datée du 20 avril, créa le délit de prostitution (l'ordonnance accorda au Lieutenant Général de Police à Paris des pouvoirs exceptionnels en matière de surveillance des mœurs, d'incarcération et de correction pour débauche publique et maquerellage), qui n'existait pas auparavant, et la peine de prison, qui devint avec l'enfermement dans les hôpitaux généraux une peine dégradante, souvent associée à d'autres humiliations comme la flagellation publique ou l'immersion dans une cage de fer. Les prostituées emprisonnées dans des maisons de force (maisons de correction où l'on enfermait, pour les redresser et les mettre au travail, les vagabonds, petits délinquants et les femmes condamnées qui ne pouvaient être envoyées aux galères) subissaient une peine de pénitence et de correction par le travail, la discipline et la religion. L'apparition de telles structures à l'époque moderne montre, à l'évidence, la volonté étatique de contrôler la sexualité féminine (et par extension la sexualité masculine), notamment transgressive. Au-delà de cette question singulière, l'ensemble de la société faisait les frais du « resserrement » de l'absolutisme et de l'investissement, du pouvoir royal, jusque dans le secret des chambres à coucher. A une religion qui se voulait répressive, sévère, désormais immiscée, par l'intermédiaire de ses représentants officiels, dans l'intimité de tous les sujets du Royaume, s'aggloméra une « morale » qui ne parvint pas à s'imposer à tous et à laquelle les autorités se voyaient forcées d'ajouter de véritables gardiennes, personnes physiques qui la matérialisaient, par leur travail et leur présence. Les établissements de pénitence (établis à la fin du XVIIè siècle et dans la première moitié du XVIIIè à l'initiative des municipalités et des évêchés, et confiés à des communautés de religieuses ; vingt-trois communautés étaient recensées dans le royaume de France, dont six pour la seule capitale), avaient un objectif explicite : corriger les vices et les comportements sexuels déviants dans de véritables prisons de la vertu. C'était ainsi près d'un millier de « pénitentes », « repenties », « madelonnettes » (épouses infidèles, veuves et célibataires en concubinage, femmes débauchées et prostituées) qui purgeaient des peines variées, composant d'étranges colonies de punies, ayant en commun le fait d'avoir eu des relations sexuelles hors mariage et d'être sous la surveillance de femmes qui avaient, théoriquement, fait vœu de chasteté. Luxure et chasteté féminines se retrouvaient ainsi enfermées dans une sorte d'étrange face à face, par les hommes de loi et d'Eglise. Apparues sous le règne de Louis XIV, ces institutions participaient largement à une atmosphère de « punition généralisée » visant à contraindre les corps et à les rendre plus « dociles ». D'ailleurs, les femmes ou filles débauchées étaient enfermées à la prière des familles, sur l'ordre de l'évêque, de l'intendant, du lieutenant général, du juge de police, du colonel de régiment ou du commissaire, et souvent c'était bien la délation (notamment familiale, ou de proches) qui conduisait prioritairement, bien avant les descentes spontanées de police, les prostituées aux établissements de pénitence. Déshonneur, impudicité, débauche, revenaient d'ailleurs sans cesse dans les demandes d'internement pour prostitution. L'honneur de la famille était « sali » par la présence, en ville, d'une prostituée qui porte le nom d'un lignage et qui se livre à une débauche sexuelle rémunérée, hors mariage, au mépris de la morale dominante (catholique ou protestante) et de la loi en vigueur. On comprend mieux alors que la délation familiale était un des principaux leviers d'enfermement de ces femmes transgressives. Pour autant, lors du placement d'une femme dans un établissement de « repenties », le délateur devait s'acquitter, pour son entretien matériel, d'une rente (100 à 200 livres annuelles) payée aux religieuses, de fait les catégories les moins aisées de la population étaient plus ou moins exclues de cette forme d'enfermement. Toutefois, les descentes de police compensaient certainement (par les rafles de prostituées, dont les rentes étaient alors acquittées par l'intendant) cette inégalité devant la répression. Mais, de ce fait, les prostituées (dont la police avait la charge de s'occuper) n'étaient peut-être arrêtées et incarcérées que lorsque l'intendant en avait les moyens financiers... Pour autant, par les risques sanitaires qu'elle représentait, la prostitution était la plus sévèrement réprimée des « déviances ». Les prostituées enfermées souffraient fréquemment de syphilis, ce qui pourrait laisser à penser que celles qui n'avaient pas contracté la maladie (les progrès de l'hygiène sexuelle chez les prostituées répondaient aux mêmes exigences de rentabilité : en lavant leurs organes sexuels après rapport et en utilisant des « antiseptiques » - permanganate de potasse ou eau de javel -, les filles soumises tentaient surtout de préserver leur « outil de travail ») disposaient d'une plus grande marge de manœuvre par rapport à l'enfermement, puisqu'il pouvait s'agir alors d'une simple « quarantaine » censée mettre les hommes à l'abri jusqu'à la mise en place d'un diagnostic fiable. Par contre, les femmes « contaminées » étaient sujettes à une répression systématique. Une fois enfermées sous la surveillance de deux ou trois Filles de la Sagesse, les femmes vivaient, pendant toute la première année de leur incarcération, isolées les unes des autres, dans une chambre qui leur était attribuée et dont elles ne pouvaient sortir que pour une courte promenade quotidienne. Cette pièce où elles mangeaient, dormaient et lisaient des ouvrages de piété, bien proche d'une cellule de prison, constituait l'essentiel de leur univers. Passé ce délai d'un an, qui semble correspondre à une étape de « purification mentale et corporelle » (ce qui peut expliquer qu'il corresponde chronologiquement au temps du noviciat chez les religieuses de la Sagesse), les femmes retournaient à une vie communautaire de type conventuel : assistance aux offices religieux, apprentissage du travail manuel, oraison, repas pris, en commun, au réfectoire... L'objectif était bien sûr de les transformer en religieuses, dans le sens de la sauvegarde des âmes perdues et du retour des pécheresses au sein de l'Eglise. Elles devaient avant tout expier leur crime envers le mariage, la famille et l'ordre public car elles attaquaient les bonnes mœurs et la tranquillité publique, en risquant de contaminer la société par l'exemple de leur débauche mais aussi, et surtout, par leurs infections sexuellement transmissibles. Jugées à plus de cent dans le tribunal, sous les huées du public, les prostituées devaient écouter la sentence à genoux pendant qu'on leur tondait les cheveux, puis on les envoyait en maison de force en charrette découverte sous les insultes et crachats de la population. Il existait également des maisons de correction où des filles débauchées étaient envoyées là par leur famille (grâce à la seconde ordonnance royale de 1684), permettant aux parents pauvres de faire enfermer dans les hôpitaux généraux leurs enfants « libertins, débauchés ou paresseux » pour y être corrigés par le travail et la religion (les débauchés masculins étaient incarcérés à l'Hôpital Général, et une certaine « élite sociale » à la prison Sainte-Pélagie à partir de 1684). Pour se débarrasser de ces marginales, elles étaient quelques fois déportées dans les colonies du Mississippi ou des Antilles (à partir de 1663 pour envoyer des blanches en Martinique, Guadeloupe et Saint-Domingue), chargées de force sur des navires marchands, mais cela donnait une mauvaise image de la monarchie et de la piètre considération qu'elle portait à ses colonies. Pour autant, grâce à une ordonnance de 1719 permettant la relégation et la transportation pénale, de nombreuses filles de joie furent recrutées de force et déportées. Mais cette déportation cessa en 1730 à cause des plaintes des colons soulignant la difficulté d'intégration des condamnées. Cette logique répressive s'accompagna d'autres ordonnances plus dures encore (mars 1685), interdisant aux prostituées d'approcher les soldats du roi (pour soulager la souffrance physique et psychologique des militaires à la caserne, ou l'horreur de la bataille), sous peine de nez et d'oreilles coupés. Sûrement qu'il se souvenait des problèmes qu'avait rencontré Jeanne d'Arc en son temps : vu la réputation sulfureuse qui s'attachait aux femmes escortant les troupes, Jeanne la Pucelle (pour ne pas être prise pour une prostituée, sachant que les Anglais la traitaient de « ribaude », ou plus poétiquement, de « putain des armagnacs ») dut faire le ménage dans son camp et donc « ordonna que tous les gens de guerre se confessassent et se missent en état d'être en la grâce de Dieu ; elle leur fit ôter leurs fillettes et laisser tout le bagage ; puis ils se mirent tous en chemin pour aller à Orléans ». Cela dit, périodiquement, elle devait faire le ménage dans son camp, car les filles, à peine chassées, revenaient proposer leurs services. Si bien qu'un jour, à Saint-Denis, au retour du sacre du roi, poursuivant une jeune prostituée l'épée à la main, elle brisa même son épée dans cette poursuite. S'agissant de l'épée miraculeuse découverte à Sainte-Catherine de Fierbois, tout le monde, à commencer par le roi, vit dans cette arme rompue le présage des futurs désastres. Que l'épée se soit brisée au contact du péché, ou que Jeanne ait péché elle-même par colère et orgueil, toujours est-il qu'il était sans doute plus facile de bouter les Anglais hors de France que les prostituées hors des armées royales (qu'elle aurait peut-être dû laisser faire, histoire d'éviter que son compagnon - d'armes - Gilles de Rais, qualifié de « Barbe bleue » nantais, ne violente sexuellement et physiquement puis n'assassine nombre de jeunes enfants et jeunes gens) ! Mais parallèlement à la répression, Louis XIV soutint des initiatives privées de refuges (différents donc des prisons de pénitence) créés par des prostituées repenties sous l'égide de communautés religieuses, pour aider les filles à changer de vie à travers l'expiation. A la fin du règne de Louis XIV, la politique répressive fut moins aveugle, tendant à distinguer différents degrés de prostitution (publique ou secrète) et à s'adapter au type de prostituée (professionnelle ou occasionnelle). Cette évolution aboutit à la déclaration royale du 27 juillet 1713, tenant de mettre un terme aux abus des rafles policières en distinguant deux types de délits, et donc deux traitement différents : le premier, celui de « débauche publique et vie scandaleuse » n'entraînait que des amendes ou des bannissements avec confiscation de biens au profit des hôpitaux généraux, le second, de « maquerellage, prostitution publique » entraînait une peine afflictive avec un procès. Ce dernier délit donnait aux accusées un minimum de garanties juridiques nouvelles par rapport aux ordonnances de 1684 : les dénonciateurs devaient prêter serment devant la justice, les poursuites policières devaient s'appuyer sur des preuves, les prostituées pouvaient faire appel. Mais malgré une législation répressive, une police aux pouvoirs discrétionnaires, la prostitution ne recula pas après la mort de Louis XIV, au contraire, elle explosa au XVIIIè siècle, notamment à Paris où l'on aurait compté 25 000 prostituées. Une des peines les plus fréquemment infligées aux criminels sous l'Ancien Régime, notamment aux femmes délinquantes, était le bannissement. C'est à dire l'exclusion, publiquement prononcée, hors de la communauté et de ses solidarités protectrices. Mais au cours du XVIIIè siècle, les juges réalisèrent combien ces bannissements étaient préjudiciables car ils projetaient plus avant les délinquants dans le monde des « sans-racines ». Dès lors, l'enfermement apparut comme le moyen le plus sûr de protéger le groupe. Après la période plus libérale de la Régence (« où l'on fit tout sauf pénitence » comme nous le dit Voltaire), la logique d'enfermement du Roi-Soleil fut reprise par ses successeurs, en dépit de son échec patent.
• Animateur : Le siècle des Lumières, la chute de l'ancien régime, les révolutionnaires puis les parlementaires bourgeois, firent-ils évoluer les choses ?
• Historienne : Avant la Révolution, la société dans son ensemble était alors caractérisée par la violence sexuelle. Dans la ville d'Ancien Régime (comme au début du XIXè siècle), la destinée d'une femme seule, sans appartenance, était souvent celle de la déchéance. Livrée aux appétits sexuels d'un maître entreprenant ou d'une bande de jeunes revendiquant une virilité toute neuve, solitaire et abandonnée des réseaux traditionnels (parentèles, amis, village), exclue des solidarités reconstituées, cette femme de personne devenait rapidement celle de tous, une femme publique. A partir de la seconde moitié du XVIIIè siècle, la corruption accentuée des mœurs devint un véritable leitmotiv : « Paris, capitale du royaume, l'est aussi du libertinage ». En 1769, le nombre de filles publiques était estimé à 25 000. Au bas de l'échelle il y avait les cabarets, les marchands de vin, certains lieux de passage (tels les débouchés du Pont-Neuf - et ses fameux amants -, de la rue Saint-Denis ...), la proximité des casernes et postes de garde, des marchés (place Maubert) et de quelques églises. D'une manière générale, les lieux de plaisir et de loisirs étaient des lieux de racolage : les prostituées s'aggloméraient autour des salles de spectacle (l'Opéra, « ce marché aux putains », la Comédie Française : les uns et les autres furent déplacés à plusieurs reprises, mais la prostitution survécut à chaque changement), les foires, les grands boulevards, lieux de promenades devenus « lieux de foire permanente », les jardins des Tuileries et du Luxembourg, les Champs-Elysées... Il y avait aussi les « maisons de débauche », les boutiques, les appartements ou simples chambres, toujours tenus par une maquerelle. Le quartier du Louvre venait en tête, suivi des rues de vieille tradition bordelière et à proximité des couvents, communautés d'hommes et écoles de la rive gauche. Le périmètre restait assez restreint, se limitant au cœur du vieux Paris de la prostitution. À Paris, débauche et prostitution étaient, comme partout, cantonnées dans certains quartiers (rues Putigny, du Hurleur, Tire-Boudin, Trousse-Vache, dont les noms rappellent la vocation depuis le Moyen-âge) autour de la rue St-Denis. Parmi les quartiers de prostitution, on remarque la nette prédominance de la rive droite, avec des implantations bien précises dans deux types de zones. La première était une zone pauvre, sordide, de basse prostitution, dans les vieux quartiers centraux d'habitation dense et de travail intense. Là, un certain nombre de rues formaient de véritables îlots réservés, foyers traditionnels de la débauche (quartiers les plus chauds, les plus sordides et criminogènes), où la prostitution était vraiment intégrée au tissu urbain. Par exemple, dans le quartier du Marais, une rue au joli nom bien trompeur, la rue du Petit-Musc (qui en porta un autre avant que la morale bourgeoise ne s'en offusquât), était au XIVè siècle une petite artère où les prostituées exerçaient leur métier, d'où son nom d'alors, la Pute-y-muse (« y cherche son inspiration/inspirateur »). Peu avant la Révolution, il y eut un déplacement des noyaux « chauds » en faveur de l'axe de la rue Saint-Honoré et autour du Palais-Royal (lieu de débauche le plus célèbre de toute l'Europe d'alors). C'est là que se trouvaient alors bon nombre de rues que Saint Louis avait déjà assignées aux prostituées, d'autres proverbialement vouées à la prostitution. Mais plus on se rapprochait du Palais-Royal, plus forte était la densité des arrestations, notamment sur la place du Louvre. Le jardin Égalité (de l'ex Palais-Royal) était en fait le « jardin-lupanar », le lieu où se tenait le grand marché de la chair : là, depuis neuf heures du soir jusqu'au milieu de la nuit, des centaines de filles de douze à quarante ans recrutaient, l'œil effronté, l'éventail en jeu, et faisaient étal de leurs appas, de leurs mines, de leurs toilettes. Elles rôdaient dans les allées, en sœurs promeneuses ; elles emplissaient les galeries en faisant leur quartier général des fameux « promenoirs en bois ». En 1781, le duc de Chartres, par besoin d'argent, avait fait abattre les arbres du Palais-Royal dont il était le propriétaire (le Palais-Royal avait été donné par Louis XIV à son frère) pour les remplacer par des galeries de bois et des boutiques ; la galerie du sud, appelée « camp des Tartares », était alors devenu un lieu de racolage. Les deux allées des promenoirs étaient une foire riante et continuelle : « deux à deux et se donnant le bras, les libertins fendaient, riant et folâtrant, la cohue des prostituées, dont les unes traînaient à leurs côtés une vieille ou une servante, dont beaucoup se pavanaient, et marchaient seules, dans les insolences de leur jeunesse pourrie » (dixit les frères Goncourt). La Révolution ne fit que découronner le front des filles de ces chapeaux chargés de plumes et de fleurs, les faisant plus simples en leur mise (au lieu de ces robes traînantes, « vrais balais du Palais-Royal » dont elles s'enharnachaient naguère), portant désormais des caracos simples, et leurs cheveux noués avec un ruban bleu. A l'ouest du Palais-Royal, en direction de la périphérie, la clientèle de la prostitution devenait plus huppée. On y trouvait les « petites maisons galantes » de la périphérie (pied de la Butte Montmartre, Bercy, Passy), faites pour le secret et devenant souvent des lieux de « standing » réservés à une clientèle de choix. Les « petites maisons » voulaient la discrétion, l'éloignement et un « calme champêtre », contrairement aux « maisons de débauche », aux bordels, qui eux recherchaient la proximité commode. Sur la rive gauche, quartier d'étudiants, de religieux, de commerçants et de loisirs, la prostitution était moins présente et moins diffuse. La rue de Mâcon était déjà une des rues réservées sous Louis XI, où la prostitution était intimement mêlée aux autres activités, un autre foyer étant autour de la place Maubert (près de la Sorbonne) jusqu'à la Seine, quartier de pauvres et de gueux où régnait la violence populaire. Ce quartier fut d'ailleurs le théâtre de la « guerre des cocardes » qui opposa en septembre 1793 les femmes révolutionnaires aux femmes du marché de la place Maubert. Face à l'obligation de porter la cocarde tricolore (sans précision de sexe), les femmes (notamment prostituées) réclamaient que cette obligation (symbole de citoyenneté) s'étende aux femmes. Le député Amar, au nom du comité de Sûreté générale, fit un compte-rendu des troubles qui jetaient la suspicion sur les intentions de femmes « soi-disant révolutionnaires » dont certaines avaient pu être égarées (nombre de femmes ouvrières criminelles et/ou prostituées essayèrent, lors des troubles et révoltes urbaines, de jouer un rôle, d'intervenir dans la politique et le gouvernement de la ville) et beaucoup « conduites par la malveillance » afin de provoquer des troubles dans Paris, au moment où se préparait le procès des Girondins. L'affaire devint alors une bataille de rue, entre les partisans du port de la cocarde obligatoire et les autres. Aux portes de Saint Denis, on menaçait les femmes qui la portaient, et à la Halle (haut lieu de prostitution, constellation se densifiant en direction de la rue Saint-Honoré), on menaçait de poignarder celles qui n'en n'avaient pas. En effet, comme souvent en période révolutionnaire, les prostituées mettaient leur métier entre parenthèses afin de se battre aux côtés des autres citoyens pour revendiquer leurs droits et ainsi aspirer à un changement de leur situation (soit par une reconnaissance de leur métier, soit - le plus souvent - par une remise à plat social qui ferait qu'elles n'auraient plus besoin d'être des esclaves du sexe pour des raisons économiques liées à un régime politico-économico-social déchu). A la périphérie du Paris ancien, étaient utilisés les jardins et guinguettes de la rive droite et sur la rive gauche les estaminets de la plaine de Grenelle : « Le vin, dont les droits étaient moins élevés que ceux de Paris en-deçà des Barrières, y coulait à bon marché et on y voyait la joie en guenilles faire danser la misère ». Aux environs plus lointains, étaient les abords de casernes (Saint-Denis), les cabarets ou les champs de Montmartre, et les carrières de Belleville. Au-delà des lieux, il est à noter que de 1765 à 1790, une place de plus en plus grande fut prise par les jeunes de moins de 25 ans. La plupart étaient célibataires (même si les parisiennes d'origine étaient plus jeunes, l'âge moyen des prostituées, 26 ans, était aussi celui du célibat féminin à la fin du XVIIIè siècle). Beaucoup des filles avaient une profession (ou en avaient eu une), menée de pair avec une prostitution clandestine ou d'appoint : le métier faisait partie intégrante de l'identité de la parisienne des milieux populaires (pour la femme du peuple, le problème ne se posait pas nécessairement en termes d'alternatives, l'un n'excluant pas l'autre, même de façon durable), sachant que les prostituées professionnelles notoires représentaient moins de 1%. Parmi les prostituées arrêtées, moins d'un tiers étaient originaires de Paris et de sa proche banlieue. L'aire de recrutement des immigrants était presque entièrement située au nord de la ligne approximative Saint-Malo-Genève, la ligne « Maggiolo », coupure culturelle et économique entre les deux moitiés de la France. Les gros foyers d'émigration féminine étaient les villes importantes et les bourgades moyennes, notamment dans les régions de Normandie, de l'Orléanais, de Champagne et de Picardie, principalement à cause de la crise du textile touchant ces provinces à la fin de l'Ancien Régime. La Bourgogne, la Franche-Comté et l'Alsace n'envoyaient guère de filles (pour autant, les villes de garnison et la mouvance de l'armée vers Paris expliquent les 7,5% de filles originaires de Lorraine). Le poids du déracinement est ici indéniable même si l'itinéraire qui mène à la prostitution ne passe pas seulement par la migration ; du moins en province, le monde des prostituées n'était pas encore celui des vagabondes ou des étrangères (les deux tiers des filles dijonnaises étaient nées dans la ville ou les campagnes proches ; elles résidaient pour la plupart depuis plus d'un an dans la cité, seules 15% d'entre elles ne faisaient que passer ou suivaient des compagnons d'aventure). L'éloignement familial, la disparition du père ou de la mère les avaient rendues tôt vulnérables. De même, la prostituée déracinée incarne le type même de la victime du fait de son déficit d'insertion sociale et des caractéristiques liées à son appartenance sexuelle. Cette femme était toute désignée pour devenir la proie d'une bande criminelle. Dans une société où la femme était pure ou publique, où la morale dominante était matrimoniale, être une célibataire affirmée (catins est d'ailleurs l'abréviation populaire de Catherine, qui dérive du grec « pur », la catherinette étant une femme de plus de 25 ans et toujours pas mariée ; au masculin, il s'agit d'un bassin qui reçoit le métal fondu) ou demeurer trop longtemps veuve faisait naître rapidement la suspicion et le mépris (le statut socio-économique de la veuve rendait sa situation inconfortable et parfois désespérée, ainsi l'étape de la prostitution pouvait succéder à celle de la mendicité ; il en était de même pour les femmes mariées délaissées, les unes et les autres représentant 6% des prostituées arrêtées). A jamais souillée, rendue psychologiquement et physiquement vulnérable, cette femme, deux fois victime, ne pouvait plus espérer rejoindre la communauté des habitants. Son seul échappatoire restait de s'intégrer au groupe interlope des exclus. Les solidarités reconstituées semblent, en définitive, apparaître comme une des ultimes réponses collectives et informelles aux dérèglements de la rue qui tendait à la fin de l'Ancien Régime à devenir l'espace de parcours privilégié des organisations criminogènes. A l'opposé de ceux pour lesquels la ville s'imposait comme un cadre définitif, équilibré et structurant de leur existence, de nombreuses provinciales migrantes voyaient la ville comme un espace étranger et hostile, et de fait allaient s'acheminer de manière heurtée vers des solidarités délictuelles transitoires. Ainsi la violence précède-t-elle souvent et naturellement la prostitution, c'est-à-dire l'insertion dans un nouvel espace de solidarités (celui des marginaux), tout en devenant l'ennemi déclaré d'un autre réseau d'entraide, et de protection, celui du voisinage. Les déviantes évoluaient en effet sous le regard de la communauté puisque la rue était leur espace de mouvement. Ainsi le phénomène prostitutionnel n'épargnait aucun lieu de la ville, s'insérait dans l'entrelacs de l'habitat privé, des cabarets, des recoins de porte... Cette visibilité du crime qui se diluait dans l'espace de vie suscitait des sentiments de rejet, de dégoût, de réprobation et de honte qui se déversaient au fil des témoignages du voisinage. Les femmes, qui constituent plus des trois-quarts des déposantes, étaient unanimes pour déclarer leur répulsion devant l'indécence de ces pécheresses et les rapports honteux qu'elles entretenaient avec des hommes de la plus basse extraction. De tout temps, le monde prostitutionnel cristallise de nombreux fantasmes, fonctionne tel un exutoire de toutes les tentations de la société, et, de fait, est enserré dans un système de mise en visibilité absolue auquel il n'y a aucun échappatoire. Le voisinage s'accorde ainsi pour condamner à l'unisson cette sexualité dévastatrice qui s'affiche impunément et que l'on traque au-delà de toute intimité. En effet, seule une minorité de libertines se trouvait en pension (maison close), alors que la plupart d'entre elles habitait à l'extérieur, au contraire d'ailleurs, de ce que connaîtra le XIXè siècle. En dépit de cela, les réseaux prostitutionnels s'organisèrent, se structurant et rationalisant le commerce de la chair. Les femmes non pensionnaires formaient certainement l'essentiel du bataillon mobilisable tandis que lors des moments d'influence, en fonction de certaines demandes ou selon les goûts des clients, les maquerelles allaient quérir des prostituées occasionnelles (il existait ainsi des réseaux performants de prostitution, entre différentes villes provençales). Les plus jeunes des filles publiques étaient résidentes, car non seulement elles étaient visées en priorité par les rafles, mais représentaient également les joyaux valorisant la collection d'un établissement qui s'enorgueillit auprès de sa clientèle de la jeunesse et de la fraîcheur de ces « tendrons ». Pour autant, les bordels n'étaient que très rarement des maisons fermées, puisque les filles venaient s'y débaucher puis repartaient. Dans ces maisons, clairement reconnues par tous comme des bordels publics, allaient des hommes et des femmes (ainsi que des étrangères, à la région voire au pays) de tout état. Etait alors objet de répression et non seulement de réprobation morale, religieuse ou sociale, tout crime contre les mœurs, tout « mauvais commerce » (« une union charnelle illégitime entre deux personnes de sexe différent », l'homosexualité étant encore plus sévèrement punie) : débauche, prostitution, libertinage, adultère, concubinage ou proxénétisme. Malgré un accroissement exceptionnel des moyens de répression policière, il y eut cependant recrudescence de la prostitution, exceptionnelle elle aussi par ses formes et son ampleur. S'il est vrai que la seconde moitié du XVIIIè siècle vit déferler la vague des prostituées d'occasion, des demi-vertus, il n'en demeure pas moins que le proxénétisme étendit son pouvoir, tendant ainsi à modifier et à codifier non seulement la prostitution professionnelle mais également le milieu des filles débauchées. Dans ce monde de l'amour vénal particulièrement sensible à la hiérarchie des conditions et des fortunes, le rang de la femme débauchée (de la courtisane de luxe à la prostituée de bas étage, la « pierreuse »), c'est-à-dire son pouvoir social, n'était pas sans effet sur la puissance du charme. Les prostituées provenaient des milieux miséreux, mais il y avait aussi une prostitution de luxe. La prostituée était appelée « fille du monde » (fille à tout le monde), alors que sur le « haut du pavé », le « peuple galant » englobait les demoiselles de spectacle, les femmes entretenues, les « courtisanes de bon ton ». C'est surtout dans le Paris du XVIIIè siècle que se déployait le petit monde des « courtisanes de haut vol », qui recevaient des cadeaux somptueux de « princes, seigneurs, fermiers généraux, étrangers cousus d'or » en échange de leurs charmes. Un fait frappe d'emblée : la répression réservait un sort inégal aux deux sexes. La réprobation visait essentiellement la débauche féminine, soit la prostitution, les « liaisons illicites » (les poursuites pour « vie débauchée » recouvraient souvent un concubinage qui était puni comme un délit, mais la seconde moitié du XVIIIè siècle vit cette répression se réduire) ou le proxénétisme. Lorsqu'il y avait « délit contre les bonnes mœurs et la chasteté », la femme était toujours la première coupable : les femmes seules, éternelles suspectes et dont le statut juridique était celui de la non-appartenance à elles-mêmes, se voyaient refuser l'état de sujets. L'intérêt que leur portait la police était fonction de leurs bonnes fortunes, c'est-à-dire de leurs amants. Ceux-ci pouvaient se voir inquiétés, mais pour se soustraire à une quelconque peine, il leur suffisait d'accuser la fille de « publique » ou de notoirement débauchée. Toutefois, la surveillance d'hommes « sujets à la police » (individus suspects, étrangers, libertins et fils de famille, « débauchés d'un libertinage outré » - tel le marquis de Sade - de prêtres débauchés ...) existait, mais leur poursuite était moins sévère. Le maquerellage, surtout féminin, « commerce regardé comme abominable », était passible de répression sévère, mais pouvait aussi jouir d'une certaine impunité lorsque les « matrones » des maisons acceptaient d'être des agents de renseignement de la police, ou lorsque la clientèle était faite de grands noms de l'aristocratie, de la bourgeoisie ou même de la noblesse de robe. À la veille de la Révolution française, on évalue à 30 000 les simples prostituées de Paris et à 10 000 les prostituées de luxe, ce qui est une preuve de l'échec des mesures de répression (pour mesurer l'ampleur du phénomène, si la proportion de prostituées était la même aujourd'hui - environ 13 % des femmes -, on aurait pour Paris intra-muros une population de plus de 100 000 prostituées). La Révolution française vit les femmes (notamment prostituées, du fait même de leur « statut » d'exclues des exclus du Tiers-Etat) intervenir directement, parfois avec force et conviction, dans l'action. Avant même la prise de la Bastille, action mémorable à laquelle elles ne manquèrent pas de participer, elles étaient déjà directement engagées dans l'action : on les vit aux journées des Tuileries, le 7 juin 1788, manifester contre l'exil des parlementaires, elles intervinrent dans les violentes manifestations pour la subsistance au printemps 1789. Le mouvement des idées durant le dix-septième siècle et surtout durant tout le dix-huitième siècle, posait l'éducation des femmes comme une condition indispensable à leur sortie de l'état de dépendance où les mœurs les avaient confinées jusque-là. Pour eux, il était préférable de faire le pari de la culture féminine, au risque de la préciosité, plutôt que celui de l'ignorance imbécile qui conduirait immanquablement à des catastrophes pour les femmes elles-mêmes comme pour la société à laquelle elles appartiennent. Pour l'immense majorité des femmes, la soumission absolue restait le lot quotidien. On pouvait donc s'attendre à ce que les révolutionnaires de quatre-vingt neuf soient reconnaissants aux femmes et leur accordent immédiatement ce droit à l'instruction qu'elles réclamaient de manière explicite, ainsi que les droits civils et politiques auxquels les plus engagées aspiraient légitimement. Dans la réalité du droit et des mœurs, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Loin d'en instituer les conditions de leur libération, la Révolution a conduit à enfermer les femmes dans leur rôle domestique, rendant ce dernier le plus étroit et le plus clos possible, les soumettant au pouvoir masculin absolu des pères ou des maris. De fait, en cas de problème, il ne leur restait plus que la mendicité, et, en dernier recours, la prostitution. Paris était justement un vaste théâtre de prostitution, auquel les cahiers de doléances des trois ordres, fait exceptionnel, consacrèrent un passage. Dès 1789, les 60 000 cahiers de doléances des diverses assemblées électorales, quoique rédigées en quasi-totalité par des hommes, n'oubliaient pas les revendications féminines, dont prioritairement l'ignorance où était maintenues les femmes, la misère tant physique que morale qui les frappait, la dépendance économique qui les réduisait à l'état d'esclaves (« Sire, nous demandons à être éclairées, à posséder des emplois, non pour usurper l'autorité des hommes, mais pour en être plus estimées, pour que nous ayons les moyens de vivre à l'abri de l'infortune »). Si les Cahiers de doléances restèrent timides pour ce qui touche aux mesures économiques, ils abordaient néanmoins la question de la mendicité féminine et de la prostitution, proposant, au-delà des bureaux ordinaires de charité, la création d'ateliers visant à donner aux femmes en difficulté le moyen de gagner honnêtement leur vie. Bien que les femmes pratiquaient déjà un métier (mais sans droit et sans liberté), ces cahiers demandaient pour la femme le droit de jouir de ses biens propres sans avoir à en rendre compte à son mari, celui de travailler librement afin de gagner sa vie et de prendre ses affaires en main. Il fallait en urgence aux femmes des garanties juridiques assurant leur « honnêteté » et leur sécurité (les carrières artistiques étaient habituellement considérées comme le paravent d'activités galantes et les menus travaux, le plus souvent clandestins, tenus par des hommes installés qui n'hésitaient pas à exploiter des femmes sans ressource). De la loi, elles n'obtiendront que bien peu de choses, les citoyens décidant seuls des lois visant à maintenir ces pseudocitoyennes en état de sujétion (état de celui qui est soumis à un pouvoir, à une domination). La contradiction entre leur rôle économique, social et leur statut civil et civique devint éclatante. Ainsi, la réaction générale masculine qui a accompagné la Révolution à partir de 1793-1794, tant dans le domaine du droit que des mœurs, a traduit une pensée profondément réactionnaire telle qu'on est en droit de considérer le XIXè siècle qui a suivi comme en régression par rapport à l'Ancien Régime, à tout le moins du point de vue de l'aspiration des femmes à l'instruction et à l'exercice des droits civiques. Pour montrer toute l'ampleur de leurs désillusions (tant sociales qu'économiques), à la fin de la Révolution, les prostituées s'affichèrent nues à leurs fenêtres et ne les fermaient même pas lors des activités de leur métier.