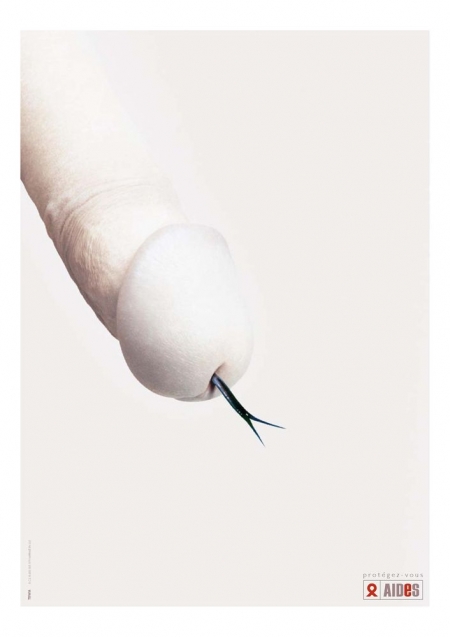-
Vas-y vas-y, développe mon amie, tout ceci est fort intéressant ! Peux-tu nous faire un historique du sexe filmé ?
-
U : « Avec grand plaisir, surtout que c’est très instructif ! Commençons alors par le commencement ! Dès 1895, année de la création du cinématographe, la bobine de Annabelle Serpentine Dance créa un certain émoi, au point qu’elle fut détruite quelques années plus tard. Avec ses voiles tournoyant et ses mouvements de fleur, de papillon, de flamme, l’américaine Loie Füller (1862-1928) a été une pionnière de la danse moderne, ayant su renouveler la conception du mouvement et révolutionner la scénographie par son utilisation savante de l’espace et de l’éclairage électrique. Le succès de la Danse serpentine, l’une de ses premières chorégraphies (1891), fut immédiat et inspira les premiers cinéastes, Louis Lumière réalisant également une version en 1896. Le réalisateur de Annabelle Serpentine Dance, William K. L. Dickson (son père, James Waite Dickson, était artiste, astronome et linguiste, et disait être le descendant en ligne directe du peintre Hogarth, et du juge John Waite, l’homme qui prononça la sentence de mort du roi Charles Ier ; musicienne douée, sa mère, Elizabeth Kennedy-Laurie Dickson, était apparentée aux Lauries de Maxwellton et, de façon plus lointaine, au duc d’Athol et à la branche royale des Stuart), travailla étroitement avec Edison au développement du phonographe. En 1888, l’inventeur et industriel américain Thomas Alva Edison eut l’idée d’un appareil qui devait faire « pour l’Œil ce que le phonographe fait pour l’Oreille ». En mars 1889, une déclaration préliminaire à un dépôt de brevet d’invention fut remplie pour l’invention proposée d’un engin capable de produire des images en mouvement, baptisé le Kinétoscope. C’est Dickson, alors le photographe officiel de la société d’Edison, qui fut chargé de concrétiser le projet. Pour répondre à cette demande, Dickson inventa le premier film celluloïd fonctionnel, et décida pour celui-ci du format de 35 mm, un standard qui existe encore de nos jours. Le premier prototype en état de fonctionner fut dévoilé en mai 1891 et la version finale du Kinétoscope fut officiellement inaugurée au Brooklyn Institute of Arts and Sciences le 9 mai 1893. À la fin de 1894 ou au début de 1895, Dickson devint conseiller pour la conception d’images en mouvement auprès des frères Otway et Grey Latham et de leur père Woodville Latham, qui dirigeaient l’une des sociétés les plus importantes proposant au public d’utiliser l’invention. L’équipe formée par ces anciens associés d’Edison développa le système de projecteur Eidoloscope, qui allait être utilisé lors de la première projection commerciale d’un film de l’histoire, le 20 mai 1895. La même année, Dickson réalisa le premier film homosexuel, The Gay Brothers, suivi en France en 1907 par L’Éclipse du soleil en pleine lune, film de Georges Méliès au début du cinéma muet : suivant les évolutions de la société, la représentation de l’homosexualité masculine à l’écran a difficilement passé le cap de la caricature ou du dénigrement. Tout d’abord cachée, mais suggérée en usant de subterfuges pour déjouer les censeurs – même si le français Jean Genet réalisa en 1950 Un chant d’amour, où depuis leurs cellules, deux prisonniers arrivent à communiquer grâce à un trou percé dans le mur qui les sépare et avec la complicité silencieuse du gardien qui les observe par le judas, ils vont établir un contact amoureux et érotique en utilisant divers objets tels qu’une cigarette, une paille, qui fut censuré jusqu’en 1975, elle fut surtout utilisée par le biais de la caricature ! L’année suivante, en 1896, le premier baiser à l’écran dans The Kiss, entre John C. Rice et May Irwin, déclencha la polémique et déchaîna les fureurs de la presse et des ligues bien pensantes à un point tel qu’un journaliste du Chicago Tribune demanda l’intervention de la police « contre cette obscénité ». En fait, les films pornographiques font partie des tous premiers films (et même dessins animés) réalisés suite à l’invention du cinématographe par les frères Lumière : ils étaient fortement marqués d’amateurisme, généralement tournés et projetés dans des maisons closes, mettant en scène des prostituées et leurs clients. Suite au développement du cinéma muet au début du XXè siècle, les tournages de films X furent parfois réalisés en parallèle des films plus conventionnels, l’équipe de tournage utilisant les mêmes décors et parfois les mêmes acteurs (les actrices étant généralement des prostituées ou de jeunes actrices), ces tournages apportant un apport financier permettant de soutenir la production de l’œuvre principale. Des réalisateurs très connus du cinéma muet en noir et blanc ont ainsi réalisé des films pornographiques. Tant et si bien que la censure apparut en 1907 aux États-Unis et en 1909 en Angleterre et en France. À partir de là, la nudité se dévoila dans deux circuits parallèles, le premier, clandestin, avec la confection de bandes érotiques pour une bourgeoisie aisée, le second, grand public, sous forme de suggestion. Pour montrer davantage qu’une épaule dénudée, il fallait un alibi, celui d’une société "décadente" appartenant au passé comme dans Cabiria en 1914, le personnage de la femme fatale apparaissant pour la première fois dans A fool there was (1915) sous les traits de Theda Bara. Pour créer un semblant d’érotisme, les réalisateurs jouaient avec les ombres et les transparences. Ainsi, Erich von Stroheim [qu’Hervé Bazin appelait « le marquis de Sade du cinéma » et qui est considéré comme le premier maître de l’ironie de l’Histoire du cinéma : metteur en scène avec des films muets très ambitieux et visionnaires, sur un mode pessimiste et cynique, dès son premier film, La Loi des montagnes (le docteur Armstrong et sa femme partent faire de l’alpinisme en Autriche. Dans le village où ils s’arrêtent, ils rencontrent le lieutenant von Steuben, personnage porté sur le sexe faible, qui ne tarde pas à entreprendre la femme du docteur. Celui-ci commence à avoir des soupçons et décide d’emmener le soldat faire une ascension à deux), ses obsessions sont manifestes : l’argent, le sexe, les blessés et les infirmes, l’officier de l’armée qu’il joue souvent lui-même. Cela se retrouve dans les rôles qu’il interprète par la suite, tant en France qu’aux États-Unis. Avec Folies de femmes, il brossa un portrait au vitriol d’une société corrompue par l’argent et le sexe. Avec la Veuve joyeuse, il détourne une opérette autrichienne en trois actes de Franz Lehár (d’après la comédie d’Henri Meilhac, L’Attaché d’ambassade, 1861) dont la première eut lieu le 30 décembre 1905 et dont le triomphe fut immédiat partout en Europe, pour en faire un film sur les orgies dans une cour royale avec infirmes, obsédés sexuels et monarques dégénérés. Meilleure adaptation cinématographique de La veuve joyeuse et aussi la plus audacieuse, bien que la moins reconnue des œuvres de Stroheim, c’est pourtant l’une de celle qui est des plus parfaites et qui a subit le moins de mutilations. Loin d’être une version édulcorée de son univers, ce film semble radicaliser son auteur. Stroheim se montre davantage et plus violemment que dans ses films précédents. Il procède ici à une mise à nue presque pornographique et obscène des motivations de toute une société. Le montage a été initié par Stroheim, mais son contrat avec la MGM fut rompu et son travail revisité. Lâché par les producteurs d’Hollywood qui l’avaient affublé du titre de « l’homme que vous aimerez haïr », rapport à ses tournages exigeants qui nécessitaient des budgets faramineux pour l’époque, il abandonna la mise en scène n’étant pas convaincu par le parlant, et se consacra à sa carrière d’acteur] multipliait les scènes d’amour au clair de lune et les viols dans Folies de femmes (1922 : Le faux comte Karamzin est un Don Juan qui vit d’escroqueries avec deux fausses princesses à Monte-Carlo où il a dû s’exiler. Erich joue un officier russe appartenant à la bourgeoisie, le comte Karamzin, en exil avec deux princesses, dans la ville de Monte-Carlo. En fait, ce sont tous les trois des escrocs recherchés par la police. Il courtise la femme de l’ambassadeur américain, et lui soutire une énorme somme d’argent. La servante de Karamzin, amoureuse et enceinte de son patron, l’enferme avec sa maitresse dans une tour et y met le feu. Karamzin, une fois sauvé et désireux d’échapper à la police, se réfugie chez un vieil anarchiste, fabriquant de fausse monnaie et veut violer sa fille. Surpris par le père, il est tué et son cadavre est jeté dans un égout. La censure ne laissant rien passer, les scènes jugées trop scandaleuses étaient retirées du montage final, et à chaque fois le film y perdait. Il fut obligé ici de retirer des séquences trop excessives comme l’éclatement d’un bouton de pus en gros plan, ou encore celle où le comte, habillé en femme, batifole avec les deux princesses), La Symphonie nuptiale (1926), Mariage de prince (1926) et Queen Kelly (1928 : dans un royaume imaginaire, la reine passe son temps à se promener nue, ce qui agace son fiancé et cousin, le prince Wolfram, un soldat libertin. En manœuvre avec son escadron, Wolfram croise un groupe de jeunes filles. Le prince à cheval les salue, elles s’inclinent mais l’une d’elles perd sa culotte. Éclat de rire dans l’escadron. Furieuse, Kitty Kelly ramasse son sous-vêtement et l’offre au prince qui tombe amoureux d’elle). Sa seule erreur est d’avoir réalisé ces chefs-d’œuvre dans l’Amérique puritaine des années 20. Le sexe et l’argent étaient des sujets hautement tabous, et montrer que les êtres humains sont pervertis autant par l’un que par l’autre était une entreprise risquée. Pendant le tournage de Boulevard du crépuscule, Billy Wilder dit à Von Stroheim : « Vous savez pourquoi vous avez été incompris ? Parce que vous aviez dix ans d’avance ». Von Stroheim lui répondit : « non, vingt ans ». D’ailleurs, le démocrate Joseph Kennedy avait dit : « On ne doit jamais plus permettre à Stroheim de diriger un film ». On se trouvait ici dans la lignée des surréalistes qui, en pointant le désir plus que l’acte, donnèrent son vrai sens au cinéma érotique. Pour eux, le désir sexuel comme réalité subversive est au cœur même du cinéma. « Ce qu’il y a de plus spécifique dans les moyens du cinéma, écrit André Breton, c’est de toute évidence le pouvoir de concrétiser les puissances de l’amour ». Pour lui, le cinéma est amour, force du désir ! Dans les années 1920, plusieurs scandales, relayés par la presse populaire, ébranlèrent l’industrie naissante du cinéma hollywoodien. L’acteur Fatty Arbuckle [il avait réalisé la plupart de ses films et courts métrages avec Buster Keaton, son ami et complice de toujours, avait également travaillé avec d’autres stars du cinéma telles que Charlie Chaplin, Laurel et Hardy : un des acteurs les plus populaires de l’époque, les studios Paramount Pictures qui voyaient en lui un tel potentiel lui offrirent un million de dollars par an (c’était le premier acteur à percevoir un tel salaire) pour le garder] fut déclaré coupable de la mort de l’actrice Virginia Rappe, lors d’une soirée "de débauche" à San Francisco, en 1921 (Fatty fut reconnu innocent après son troisième procès, recevant même les excuses du jury, fait sans précédent dans l’histoire de la justice américaine. Cependant, le mal avait été déjà grandement fait : ce scandale avait brisé net la carrière de Fatty, les magnats d’Hollywood ordonnant à leurs acteurs de ne rien faire pour l’aider – seul Buster Keaton, que Arbuckle avait rendu célèbre, fit une déclaration de soutien) ; le décès crapuleux, en 1922, de l’acteur et producteur William Desmond Taylor, sur fond de bisexualité et la mort par overdose de l’acteur Wallace Reid en janvier 1923, firent paraitre Hollywood comme un lieu de perdition et de débauche. D’autant que Reid fut suivi dans la tombe, et pour les mêmes raisons par Olive Thomas, Barbara La Marr, Jeanne Eagels puis Alma Rubens. Cela conduit, en 1922, à la création de la Motion Pictures Producers and Distributors Association (devenue la Motion Picture Association of America en 1945), présidée par l’avocat William Hays. La première mesure de Hays fut de bannir Fatty Arbuckle de tout film et d’imposer un certificat de moralité pour toute personne apparaissant à l’écran. Pour autant, les films des années 1920 et du début des années 1930 reflètent l’attitude libérale de l’époque : ils pouvaient inclure des actes sexuels sous-entendus, des références à l’homosexualité ou au métissage. D’ailleurs, les rôles populaires de l’époque incluaient souvent une prostituée. En 1927, William Hays dressa une liste de sujets et de thèmes que les scénaristes devaient éviter. La même année, l’avènement du cinéma parlant appela à la révision ou la précision des règles d’autocensure : aucun film ne serait produit qui porterait atteinte aux valeurs morales des spectateurs, la sympathie du spectateur ne devait jamais être jetée du côté du crime, des méfaits, du mal ou du péché, et la loi, naturelle ou humaine, ne devait pas être ridiculisée et aucune sympathie ne serait accordée à ceux qui la violent. Seuls des standards corrects de vie soumis aux exigences du drame et du divertissement seraient présentés. C’est l’époque du Pré-Code : un code de conduite pour l’industrie cinématographique écrit par un prêtre jésuite, le père Daniel A. Lord, fut officiellement adopté en 1930. Beaucoup le trouvant trop censeur, il fut largement ignoré et son application ne fut que peu enthousiaste, son refus étant en partie dû à l’attitude libertine des années folles, comme on pouvait encore le voir en Europe : dans Un chien andalou (Bunuel, 1928), Pierre Batcheff malaxe les seins nus de Simone Mareuil ; L’âge d’or (1930), interdit pendant un demi-siècle car la femme y est non seulement consentante, mais désirante, donc scandaleuse (Lya Lys suce avec frénésie le doigt de pied d’une statue : c’est là « l’exaltation de l’amour total » selon André Breton), est traversé par l’irrésistible pulsion du désir, la volonté de s’accoupler dans la boue malgré la présence des ecclésiastiques et autres notables ; dans La coquille et le Clergyman (Germaine Dulac, 1928) Antonin Artaud identifie l’érotisme à la cruauté (« il se jette sur elle, écrit-il dans le scénario, et lui arrache son corsage comme s’il voulait lacérer ses seins. Mais ses seins sont remplacés par une carapace de coquillages »). Mais en 1934 les recettes des films s’effondrèrent, à cause de la Grande Dépression. Ainsi, l’ère du Pré-Code se termina avec l’établissement d’un bureau spécial qui relisait tous les scripts, qu’il acceptait s’ils respectaient le nouveau code. Le texte initial du code de conduite fut retravaillé par un deuxième ecclésiastique, Martin Quigley, éditeur catholique, et devint un code censure appliqué par l’Administration du code de production (Production Code Administration), dirigée par le très catholique Joseph Breen, qui imposa sa marque sur tous les films hollywoodiens de 1934 à 1954, période connue pour sa rigueur morale. Établi par le sénateur William Hays, président de la Motion Pictures Producers and Distributors Association, adopté et désormais appliqué par les studios hollywoodiens, le code Hays fut un "exemple" d’autorégulation ("appliqué" jusqu’en 1966), les studios s’imposant eux-mêmes cette censure afin d’éviter l’intervention extérieure, en particulier de l’État fédéral. Il établissait des règles précises en matière de moralité : les décolletés étaient limités de dos jusqu’à la taille, de face jusqu’à la naissance des seins, le nombril ne pouvait être montré, les « mouvements inconvenants » étaient interdits. L’importance de la famille et de l’institution du mariage étaient primordiales aux yeux des rédacteurs du code Hays. Par conséquent, l’adultère, parfois nécessaire dans le contexte narratif d’un film, ne devait pas être présenté explicitement, ou justifié, ou présenté d’une manière attrayante. Les scènes de passion ne devaient pas être présentées sauf si elles étaient essentielles au scénario et les baisers excessifs ou lascifs, les caresses sensuelles, les gestes suggestifs ne devaient pas être montrés. « La présentation de chambres à coucher doit être dirigée par le bon goût et la délicatesse », précisait le code afin d’éviter de se faire contourner par la métaphore. Il en allait de même de la séduction et du viol qui ne pouvaient être que suggérés et non montrés, et seulement lorsqu’il s’agissait d’un élément essentiel du scénario, n’étant jamais un sujet approprié pour la comédie. Toute référence à la perversion sexuelle (concept très vague et relatif aux époques) était formellement proscrite. Ainsi, certains critères de « décence » reposaient sur les préjugés raciaux de ce temps, la présentation de rapports sexuels interraciaux étant tout bonnement interdite : la Metro-Goldwyn-Mayer rejeta la candidature de la sino-américaine Anna May Wong pour le rôle principal dans une adaptation de The Good Earth (Visages d’Orient) de Pearl S. Buck en raison de principes interdisant les gestes intimes entre les diverses "races". L’acteur principal masculin étant de "race" blanche (Paul Muni), les producteurs considéraient impossibles de lui donner une partenaire de "race" jaune et choisirent plutôt l’actrice Luise Rainer que l’on maquilla pour lui donner l’apparence orientale. En ce qui concerne l’homosexualité au cinéma, The Celluloid Closet, essai de Vito Russo, puis documentaire de Robert Epstein, montre comment la représentation de ce qui était encore largement perçu comme une déviance, contourna les interdits du code Hays. La prostitution ne devait pas être représentée, de même que les thèmes de l’hygiène sexuelle et des maladies vénériennes. La naissance d’un enfant (même en silhouette) ne devait jamais être représentée, ainsi que ses organes sexuels ne devaient jamais être visibles à l’écran (ils faisaient donc déjà très attention à la pédophilie). L’obscénité dans le mot, dans le geste, dans la chanson, dans la plaisanterie, ou même simplement suggérée était interdite : « Des titres licencieux, indécents ou obscènes ne seront pas employés » soulignait le code, soucieux d’éviter que l’industrie du cinéma se serve des affiches de cinéma pour opérer un détournement de la censure et atteindre aux bonnes mœurs que le code Hays tentait si vigoureusement de protéger. Si les scènes de déshabillage étaient à éviter sauf lorsqu’il s’agissait d’un élément essentiel du scénario, l’indécence était interdite (les costumes trop révélateurs, les danses lascives, celles qui suggèrent ou représentent des relations sexuelles, étaient proscrites, les danses comportant des mouvements indécents devant être considérées comme obscènes) de même que la nudité, réelle ou suggérée, et les commentaires ou allusions d’un personnage à ce sujet. Si Tarzan était torse nu, exotisme oblige, l’évolution des tenues de Jane dans la série produite par la Metro-Goldwyn-Mayer avec Johnny Weissmuller est flagrante : dans Tarzan, l’homme singe (1932) et dans Tarzan et sa compagne (1934), Jane n’est vêtue que d’une peau de bête qui ne cache pas grand-chose, dans Tarzan s’évade (1936) elle est revêtue d’une combinaison qui ne met plus du tout en valeur ses formes. Les producteurs américains jouèrent alors avec les allusions, ouvrant une sorte d’âge d’or au fétichisme sexuel. Les actrices développèrent des poitrines de plus en plus fortes : à Mae West, que le magnat de la presse William Heartst qualifiait de « monstre lubrique », succéda Jane Russell ; la publicité du film Le Banni de Howard Hughes fut ainsi principalement basée sur sa poitrine généreuse, ce qui retarda la sortie du film de trois ans. En 1946, un striptease apparut encore comme le comble de l’érotisme lorsque Rita Hayworth enleva seulement son gant dans Gilda. Pour Hollywood, la star s’élève au dessus des vivants : elle est la femme inaccessible, incarnation de l’amour fou cher à André Breton. Adou Kyrou est allé jusqu’à parler de la « Femme cinématographique » en songeant à Marlène dans Shanghai Express (1932), à Mae West, à Louise Brooks. En Europe, le cinéma était plus "libre" que son homologue américain. En 1933, dans Extase du tchécoslovaque Gustav Machatý, Hedy Lamarr apparut entièrement nue sortant de son bain : le gouvernement américain en fera brûler symboliquement une copie en 1935. En France, dans Le jour se lève (1936), Arletty était nue sous sa douche mais le plan fut coupé par la censure ».
-
Effectivement intéressant concernant les mœurs de nos grands-parents ! Je t’en prie, continue jusqu’à leurs petits-petits-enfants !!!
-
U : « Surtout que les films pornographiques après guerre suivirent les innovations technologiques du cinéma conventionnel, et des salles de cinéma dédiées les projetèrent. L’érotisme, empêché par la censure et notamment par le code Hays, surgissait par effraction, l’érotisme n’étant moins refoulé que sublimé. Comme cette jeune fille hésitant à toucher le pis d’une vache dans Los Olvidados (Les Réprouvés / Pitié pour eux, 1950, Prix de la mise en scène à Cannes en 1951) ou le lait s’écoulant sur ses cuisses, ou encore les vieillards fétichistes, adorateurs des chaussures de femmes chers à Luis Bunuel : Susana la perverse (1950), El (1953), La vie criminelle d’Archibald de la Cruz (1955), et surtout le personnage de Don Jaime dans Viridiana (1961). En 1952, la Cour suprême des États-Unis revint sur la décision de 1915 et décida que le cinéma devait bénéficier de la liberté d’expression garantie par le premier amendement de la Constitution des États-Unis d’Amérique. L'industrie de la pornographie contemporaine a vraiment pris son essor au début des années cinquante, avec la création du magazine de charme Playboy en 1953 par Hugh Marston Hefner ! Le célèbre logo, qui représente un profil stylisé de lapin portant un nœud papillon de smoking, a été choisi comme mascotte pour sa « connotation sexuelle humoristique ». Devenu célèbre pour ses photos de stars dénudées (Marilyn Monroe fut la première Sweetheart of the Month) et ses playmates (Hugh Hefner popularisa The Girl Next Door, « La fille d'à côté », en juillet 1955, alors qu'une secrétaire de Playboy, Janet Pilgrim posa pour le magazine), l’illustré a dès le départ mélangé érotisme et journalisme, invitant les plus grandes plumes : le magazine s’adresse aux hommes attirés par un style de vie libertin, festif et sensuel, sans négliger la dimension politique, sociale, sportive et culturelle. Il faut dire que GQ (à l'origine Gentlemen's Quarterly, littéralement « Le trimestriel des gentlemen ») était un magazine masculin mensuel qui avait ouvert la voie dès 1931, étant consacré à la mode, au style et à la culture à travers des articles sur la nourriture, le cinéma, la culture physique, le sexe, la musique, les voyages, les sports, les technologies et les livres. Mais le vrai innovateur fut Esquire (littéralement « écuyer », titre de noblesse anglais désignant un membre de la petite noblesse se classant juste au-dessous d'un chevalier), créé en 1933, un magazine mensuel pour hommes devenu célèbre lorsqu'il a publié d'importantes figures littéraires, comme Ernest Hemingway et Francis Scott Fitzgerald. Il s'adressait à une clientèle financièrement aisée, étant considéré comme l'un des titres les plus haut de gamme de la presse masculine ango-saxonne, et comprenait des photos dites de charme. Dans les années 1940, sa popularité aux États-Unis augmenta lorsqu'il publia des peintures d'Alberto Vargas qui mettaient en vedette des pin-up (femmes dans une pose attirante ou "sexy" dont on accroche la représentation sur un mur, d'où l'expression anglaise de « pin-up girl » qui pourrait se traduire en français par « jeune fille punaisée au mur »). Le concept apparut plus tôt, au début du siècle, sous le nom de Gibson Girl (du nom de leur créateur) et ses variantes (« Pretty Girls », « Varga Girl », « Christy Girl », etc.). Femme fatale, poupée, sexe-symbole, la pin-up est représentée par ses créateurs comme la femme idéale. Les pin-up, provocantes sans être vulgaires, apparurent sur des magazines, journaux, posters, calendriers ou des « cartes d'arts », petites vignettes à collectionner qui ont aidé à la popularisation des pin-up. Dès la Seconde Guerre mondiale, les équipages d'avions affichaient ces illustrations sur les carlingues de leurs avions. La plus célèbre d’entre elles est Betty Boop, l'héroïne d'une série de dessins animés américains créée par les Fleischer Studios entre 1930 et 1931. Elle apparut dès 1930 dans une douzaine de dessins animés, comme personnage secondaire anonyme, notamment aux côtés du chien vedette Bimbo, lequel aura en définitive une renommée plus modeste. À ses débuts, dotée de longues oreilles tombantes mais déjà très maniérée, elle hésitait entre une identité de chienne anthropomorphe et de jeune femme cabotine et délurée. Ce fut à partir de 1931 qu'elle devint la vedette de plusieurs aventures sous le nom de Betty Boop. Première héroïne de dessin animé, représentée sous les traits d'une petite femme brune aguicheuse et sensuelle (qui n'est pas sans rappeler Marilyn Monroe – laquelle reprendra avec un grand retentissement le fameux gloussement affecté poo-poo-pee-doo de la reine du glamour de celluloïd –, bien que ce soit la chanteuse Helen Kane qui ait été utilisée comme modèle), elle est devenue un sexe-symbole de l'âge d'or de l'animation américaine. Mais, à cause de sa jupe trop courte et de certains épisodes avec ses compagnons, Betty Boop a été censurée pendant quelque temps (le temps que le studio rallonge sa robe). Dans les États-Unis des années 1950, il était généralement convenu de ne pas considérer les photographies de nu comme pornographiques tant qu'elles s'abstenaient de faire apparaître les poils pubiens et a fortiori les organes génitaux. Pour préserver ses apparences "artistiques", la photographie respectable pouvait s'approcher de cette limite mais devait veiller à ne pas la franchir. Dès ses premières années, Playboy offrit de temps en temps quelques aperçus de toisons pubiennes, la première fois dès février 1956 avec une image sous l'eau de Marguerite Empey (même si le pubis des playmates restait masqué le plus souvent par un linge, une jambe ou un élément du décor ; ces audaces ponctuelles, qui évitaient soigneusement le poster central, se firent plus timides au début des années 1960). En 1956, la sortie simultanée de Et Dieu… créa la femme de Roger Vadim avec Brigitte Bardot en sexe-symbole de renommée mondiale et de Baby Doll d’Elia Kazan qui met en avant la sensualité de son héroïne, ouvrit une voie dans laquelle une partie importante de la production européenne et américaine allait s’engouffrer, le cinéma italien en tête. Il y aura bien un durcissement de la censure à la fin des années 50, mais le mouvement était lancé. À Hollywood, les réalisateurs jouèrent alors avec les métaphores : dans La Mort aux trousses, Alfred Hitchcock fit suivre la scène où Cary Grant et Eva Marie Saint s’enlacent dans un wagon par un plan montrant un train entrant dans un tunnel, dans Spartacus, Stanley Kubrick évoqua avec subtilité l’homosexualité du personnage de Laurence Olivier qui explique à Tony Curtis qu’il aime aussi bien « les huîtres » que « les escargots » ! Les producteurs indépendants créèrent quant à eux un nouveau genre : le film de nudistes sans contact physique et sans nudité montrée. Russ Meyer, ancien photographe de Playboy, s’engagea dans cette brèche pour créer ses films parodiques avec des actrices aux seins hypertrophiés : son L’Immoral Mr. Teas (1960) constitue l’un des premiers films à caractère pornographique américain qui ait bénéficié d’une distribution officielle et de l’attention d’une critique sérieuse. Par rapport à la production européenne importée sous le manteau, le film de Russ Meyer innova en racontant une histoire (Mr. Teas a la faculté de déshabiller les femmes de son regard) avec des personnages ayant un minimum de psychologie. Avec ce film muet de 63 minutes en couleurs, sorte de "Les Vacances de monsieur Hulot perverti", Russ Meyer inventa un genre nouveau, le "nudie". Le film rapportera plus d’un million de dollars soit quarante fois son coût de production et marqua le début d’une série de films à succès pour son auteur qui dépassèrent largement le cadre des salles spécialisées et attirèrent donc un nouveau public. Parallèlement, le 4 juin 1963, Hugh Hefner de Playboy fut arrêté pour vente de littérature obscène ! En 1965, le magazine Private fut lancé à Stockholm en Suède par Berth Milton Senior : c'était le premier magazine pornographique en couleur apparu dans le monde (Private Media Group a ensuite sorti trois autres revues : Sex, Triple X et Pirate, cette dernière se focalisant sur le fétichisme et le sadomasochisme). Avec Le Désir dans les tripes (1965) et Faster, Pussycat! Kill! Kill!, Russ Meyer imposa son propre style : l’exploration d’une sexualité rurale à travers des intrigues rudimentaires mais pimentées de violence et servies par des héroïnes à la poitrine démesurée. C’est d’ailleurs en 1965, que sortit Le Prêteur sur gages de Sidney Lumet, le premier film produit par un grand studio à montrer des seins nus. À la fin des années 1960, Russ Meyer se trouva à la croisée des chemins : d’un côté, les films pornographiques commencèrent à faire leur apparition dans certains sex-shops de San Francisco, de l’autre, la nudité était devenue habituelle dans les films classiques. Refusant d’entrer dans le monde du X mais incapable d’engager des stars pour ses films à petit budget, Russ Meyer contre-attaqua avec Vixen en 1968. Vixen, une femme de petite vertu, vit dans le bush du Nord-Ouest canadien avec son mari aviateur, Tom. Quand Tom est absent à cause de son travail, ou simplement quand il a le dos tourné, Vixen le trompe avec différents partenaires. L’intrigue n’a pas de véritable fil rouge, si ce n’est les personnages de Vixen, Tom et Niles. On peut noter deux axes principaux dans le scénario: 1) la sexualité débridée de Vixen, qui la pousse à se lancer dans différentes aventures, indépendamment de la morale établie ; 2) l’évolution du personnage de Niles, jeune Noir ayant fui les États-Unis pour ne pas faire partie des contingents envoyés au Vietnam, alors en guerre. Le dernier quart d’heure du film, plus axé sur la comédie pure que le reste de l’œuvre (que l’on peut qualifier de "film érotique" ou de "comédie érotique"), est également plus politique. En effet, les personnages évoquent à travers leurs dialogues les contradictions de la démocratie (accusée de ne pas avoir de considération pour les individus qu’elle envoie mourir au combat), avant de mettre dos à dos les régimes communiste et démocratique. C’est avec ce film qu’il va connaître ses plus graves démêlées avec la justice, tout en lui rapportant 15 millions de dollars pour un budget de 72 000 dollars. Aux États-Unis, le Congrès vota la création d’une Commission sur la pornographie et l’obscénité pour faire face à une production montrant une nudité complète et des comportements sexuels de plus en plus libérés, le code moral Hays n’étant plus appliqué (libéralisé dans son application à partir de 1961, il sévit jusqu’en 1966 : plusieurs tentatives eurent lieu aux États-Unis dans les années 1970 pour proscrire la pornographie, mais les tribunaux firent la distinction entre une personne qui reçoit de l’argent en contrepartie d’un rapport sexuel, et la représentation cinématographique ou photographique d’un rapport sexuel). Deux ans plus tard, c’était Woodstock… Le film consacré à cette dernière manifestation diffusa à travers le monde une image de liberté sexuelle. Cette tendance libertaire permit au cinéma traditionnel d’aborder de nouveaux thèmes ou de parler plus ouvertement des relations sexuelles : l’homosexualité fut abordée dans Thérèse et Isabelle (roman de Violette Leduc rédigé en 1954, paru sous forme censurée en 1966 puis en version intégrale en 2000 : dans le pensionnat d’un collège, deux adolescentes découvrent la passion physique. Thérèse, la narratrice, découvre le plaisir grâce à Isabelle, durant trois nuits. La description sans fard, à la fois poétique et crue, de la sexualité, de l’homosexualité féminine, forme l’intégralité du roman. Thérèse et Isabelle devait être la première partie du roman Ravages. Son éditeur, réticent et craignant le scandale, lui conseilla de retirer toute cette partie, et Ravages parut sans elle. Violette Leduc intégra alors des passages de Thérèse et Isabelle dans La Bâtarde qui parut en 1964, et Gallimard accepta de publier Thérèse et Isabelle en 1966, dans une version raccourcie), la polygamie dans Bob et Carole et Ted et Alice (un couple, Bob et Carol, après avoir passé un week-end dans une clinique spécialisée pour revigorer leur sexualité, est déterminé à mettre en pratique les principes d’amour libre et d’ouverture qu’ils ont appris. Leurs amis Ted et Alice hésitent entre rejet et curiosité) ou encore Le Mariage collectif. En 1971, Le Dernier Tango à Paris aborda la sodomie et rendit célèbre une tablette de beurre, assurant au film une renommée et un succès important avec plus de cinq millions d’entrées en France (un quadragénaire américain erre dans Paris à la suite du suicide de son épouse. Dans un appartement à louer du 16e arrondissement, il rencontre une jeune femme, fille de colonel et de vingt ans sa cadette, en phase de rupture, avec qui il engage une relation intense, houleuse, brève, mais désespérée. Le film incarne une époque de transition. Pour le réalisateur, la relation entre les deux protagonistes « est à la mesure des tourments que provoque l’explosion du féminisme ». En fait, plus globalement, l’histoire est une allégorie du passage d’une époque « classique » à une époque « moderne » voire « postmoderne »).
En Europe, les films érotiques se cachaient encore derrière l’alibi de l’éducation sexuelle. Il faut dire que la censure gouvernementale tenta d’interdire en France Suzanne Simonin, la Religieuse de Diderot (d’après Diderot) réalisé par Jacques Rivette en 1966 et qui présentait une mère supérieure "entreprenante" : au XVIIIè siècle, Suzanne Simonin est cloîtrée contre son gré par ses parents qui la destinent à la vie conventuelle sans qu’elle en ait la vocation et où elle subira notamment la cruauté d’une abbesse sadique et le harcèlement sexuel d’une autre. Après avoir reçu en 1962 un avis de précensure défavorable de la commission de contrôle, le scénario, rédigé par Rivette et Jean Gruault, est adapté en 1963 pour le théâtre au Studio des Champs-Élysées, sous la direction de Jean-Luc Godard et avec Anna Karina dans le rôle de Suzanne Simonin. La pièce ne déclenchera pas de scandale et ne remportera d’ailleurs aucun succès. Toutefois, comme le fit remarquer à l’époque François Mauriac dans Le Figaro, l’appel à censurer La Religieuse a été lancé avant même que quiconque ait vu le film (mais "à décharge", en 1760 Diderot fit, selon ses propres termes, « une effroyable satire des couvents »). La hiérarchie de l’Église catholique, alors en plein concile de Vatican II (destiné à moderniser l’Église), n’a pas cherché le scandale, mais des associations de parents d’élèves de l’enseignement privé et, surtout, de sœurs s’alarmèrent dès 1965 : la présidente de l’Union des supérieures majeures écrivit au ministre de l’Information Alain Peyrefitte pour lui faire part de son inquiétude : « un film blasphématoire qui déshonore les religieuses ». Le ministre la réconforta sans ambiguïté : « Je partage entièrement les sentiments qui vous animent » et lui donna l’assurance qu’il utiliserait tous ses pouvoirs pour empêcher le film de nuire à l’image des religieuses (l’intervention d’Yvonne de Gaulle, épouse du général et président, et ancienne élève des dominicaines, a aussi été déterminante). Le tournage fut un peu gêné (refus d’autoriser le tournage à l’abbaye de Fontevraud, dépendant des Monuments historiques) mais en mars 1966 la commission de contrôle autorisa la distribution du film, celui-ci devant être interdit aux moins de 18 ans. Une semaine plus tard, Yvon Bourges (secrétaire d’État à l’Information) réunit à nouveau la commission et y convoqua le directeur de la sécurité nationale, Maurice Grimaud, afin d’exposer les troubles à l’ordre public que pouvait provoquer le film. La commission ne changea cependant pas son vote, mais son avis n’était que consultatif et deux jours plus tard Yvon Bourges interdit la distribution et l’exportation du film. La censure provoqua un tollé : Jean-Luc Godard interpella André Malraux qu’il appela ministre de la Kultur. De nombreuses personnalités publiques, y compris des gens d’Église, s’insurgèrent. Malraux lui-même n’empêcha pas le film d’être sélectionné pour le Festival de Cannes et d’y être projeté. Le producteur Georges de Beauregard et son avocat Georges Kiejman se lancèrent dans une bataille juridique qui conduisit en 1967 le tribunal administratif à annuler la décision d’interdiction, pour vice de forme. Le nouveau ministre de l’Information, Georges Gorse, lui accorda un visa d’exploitation mais confirma son interdiction aux moins de 18 ans. Le film sortit le 26 juillet 1967 dans cinq salles parisiennes. Fort de sa publicité et de son aura scandaleuse, il enregistra 165 000 entrées en cinq semaines. Le public découvrit un film sobre et extrêmement fidèle au roman dont il est l’adaptation (qui profita de ce succès et fut réédité plusieurs fois), ne méritant sans doute pas la publicité sulfureuse qui a entouré sa sortie et que Jacques Rivette expliquera ne jamais avoir cherché. La décision d’annuler la censure du film fut définitivement confirmée par le Conseil d’État en 1975. Michelangelo Antonioni fut le premier à montrer un pubis féminin dans Blow-Up en 1967 [Palme d’or au festival de Cannes : le film fit scandale à sa sortie en Grande-Bretagne car c’était la première fois qu’on montrait dans un film britannique un corps féminin entièrement dénudé, en l’occurrence, celui de Jane Birkin. Pour information, le film original a subi récemment une censure sur deux scènes lors du passage du support VHS au DVD. Une partie de la scène où Jane (Vanessa Redgrave) se déshabille devant Thomas (le photographe) est tronquée en bas pour cacher la poitrine de l’actrice qui apparaît nue sur la vidéo. Dans la scène dite "d’orgie" où Thomas chahute avec les deux jeunes filles (Jane Birkin et Gillian Hills) qui n’ont pas de sous-vêtements, le pubis est flouté]. En 1965 parut au Royaume-Uni le premier numéro de Penthouse, magazine pour hommes fondé par Bob Guccione, combinant des articles sur la vie urbaine et des images pornographiques soft. Dès ses débuts ou presque, le nouveau venu, s'appuyant sur une attitude plus tolérante en Europe à l'égard de la nudité, publia des images de femmes qui, même retouchées et floutées, marquaient une rupture avec les prétentions artistiques encore en usage. Presque dès le premier numéro, les images publiées montraient des sexes féminins et la toison pubienne, alors que ceci était considéré comme obscène : ce fut le début des « Guerres pubiennes ».Chez Playboy, pourtant, la réaction fut lente à venir : sur le poster central un tout premier brin de poils apparut avec Melodye Prentiss, Miss July 1968, soit quelque quinze ans après le lancement du magazine. Alors que Guccione était américain, le magazine fut publié d'abord au Royaume-Uni avant de paraître aussi aux États-Unis en 1969. Pour préserver sa part de marché, le leader contesté se résolut, malgré les risques judiciaires, à prendre les devants. En août, Playboy publiait son premier nu de face intégral, bien qu'ombré, avec le portrait non d'une playmate mais de la danseuse et actrice afro-américaine Paula Kelly. D'autres pilosités se firent jour dans ses pages et même, quoiqu'à l'état de traces, jusque sur le poster de Gloria Root, en décembre 1969. Mais il fallut attendre les photographies de Liv Lindeland, en janvier, pour obtenir enfin une vue claire de la toison pubienne, en l'occurrence blonde, d'une playmate. L'événement généra un fort courant d'attention dans les médias et le public. En décembre 1971, seul le bocal d'un poisson rouge séparait encore Karen Christy du premier nu de face intégral en poster central. La palme en revint le mois suivant et pour l'Histoire à Miss January 1972, Marilyn Cole. Sur leur lancée, Liv Lindeland et elle furent toutes deux désignées « Playmates de l'année », en 1972 et 1973 respectivement. Mais la performance de Marylin devait rester inégalée pendant plus d'un an, le poster central de Bonnie Large en mars 1973 étant le premier à retrouver un tel niveau d'exposition, comparable à celui des modèles de Penthouse à la même époque. En 1968, Marc Dorcel se lanca dans l’édition d’œuvres érotiques. Associé avec deux amis, il créa Select Diffusion, et vendait des livres aux titres sulfureux, au travers des publicités. Il publia Ursula, qui devint un best-seller dans son domaine : plus de vingt-mille exemplaires furent vendus en moins de trois mois. Mais la dix-septième chambre correctionnelle en interdit la diffusion, vente et publicité. Au début des années 1970, l’engouement pour les ouvrages érotiques déclina. Mais il existait un marché pour les romans-photos érotiques : il s’agissait de revues américaines importées en France et "retouchées" : les sexes et poils pubiens furent masqués par des sous-vêtements grossièrement dessinés. Pour se les procurer, les consommateurs étaient prêts à débourser jusqu’à 120 ou 140 francs, une somme importante pour l’époque. Marc Dorcel décida alors de lancer le premier roman photo érotique français en couleur. Les effets libérateurs des hippies et de mai 68 ont fait évoluer les mentalités, changer les mœurs et imposer progressivement le sexe à l’écran : les scènes d’amour devinrent plus crues et ce n’était plus juste des femmes nues et des baisers mais des scènes de plus en plus explicites. La série allemande des Helga connut un très gros succès en 1968 avec plus de quatre millions de spectateurs en Allemagne et autant en France pour le premier des deux films. Sur les affiches, la prostitution, la traite des blanches, et la libération des mœurs firent fleurir des avertissements sur les affiches des films concernés, en forme d’appel à consommer. C’était l’avènement du cinéma érotique à large diffusion (car déjà existant avec des dessins animés ou des films dès l’invention du cinématographe), étoffé grâce à Emmanuelle et à l’autre grand classique, Deep Throat (Gorge profonde), dont le scénario se résume en quelques lignes et qui devint un véritable phénomène culturel en 1972, un film culte pour toute une génération. Une jeune femme, Linda, consulte un médecin pour lui faire part de ses difficultés à atteindre l’extase lors des rapports sexuels. Après examen, celui-ci l’informe que sa frigidité s’explique par le fait que son clitoris n’est pas localisé là où il devrait être mais au fond de sa gorge. Dès lors le remède qu’il prescrit est simple puisqu’il lui suffira d’avaler la totalité d’un organe masculin pour atteindre la satisfaction. Et il s’empresse de le lui démontrer en lui donnant son propre organe à sucer. Reconnaissante, Linda se propose pour être sa compagne mais le docteur refuse car il est déjà engagé auprès de sa propre infirmière. Il lui offre toutefois un rôle de thérapeute auprès de ses patients incluant la fellation, la pénétration vaginale et la sodomie. Le film s’achève alors que Linda est en visite chez l’un de ses patients tandis que, un godemichet en verre dans le vagin, la bande-son joue I’d Like To Teach the World To Screw, parodie d’un jingle célèbre de l’entreprise Coca-Cola. Deep Throat fut à l’origine en 1972 d’un scandale (aujourd’hui encore, il suscite une polémique qui n’est sans doute pas près de s’éteindre) qui propulsa sa vedette, Linda Lovelace, au premier plan de l’actualité en la consacrant comme première superstar du show-biz pornographique, le symbole sexuel de la femme "libérée". Après la sortie du film, l’acteur Harry Reems fut la vedette de procès retentissants "pour obscénité" aux USA, et devint un symbole de l’émancipation culturelle et sociale, et de la lutte contre l’hypocrisie des milieux traditionalistes qui cherchaient par tous les moyens à étouffer l’épanouissement individuel. L’écrivain Norman Mailer rappelle qu’au début des années 70 le porn-shooting s’attribuait une fonction d’émancipation sociale : « C’était un monde qui naviguait entre l’art et l’illégalité. c’était l’aventure ».Tourné en six jours à Miami et destiné à l’origine à une diffusion confidentielle sous le manteau, ce film n’avait coûté que 25 000 dollars à produire. Toutefois, au cours de ses trente ans d’exploitation, le FBI estima qu’il avait rapporté plus de 600 millions de dollars ce qui le place parmi les plus grandes réussites de l’industrie cinématographique américaine. Par son concept provocateur mettant en image une fellation profonde [commentant l’inauguration le sleight of throat (le tour de force glottique) de Linda Lovelace, l’acteur dit : « Quand elle m’a avalé en entier, je me suis demandé si j’allais m’en sortir vivant...J’ai regardé autour de moi : les yeux de Gerry (le cinéaste) lui sortaient de la tête, et le caméraman avait la mâchoire inférieure sur les chaussures »] et grâce à son humour distanciateur, ce film participa à la destruction de nombreux tabous et initia une mode du "Porno-Chic" qui contribua à une libération des mœurs aux États-Unis. Alors que l’actrice, afin de réussir les fellations du film sans s’étouffer, avait dû subir un entraînement pour apprendre à avaler entièrement un pénis, pendant les mois qui ont suivi de nombreuses femmes ont été hospitalisées aux États-Unis, victimes de viols de la "gorge" du fait que leurs petits amis avaient tenté de leur faire réitérer à la maison l’exploit de Lovelace. Gorge profonde a été un des premiers films pornographiques à obtenir une audience débordant les salles pornographiques : en ayant ainsi défié les lois américaines sur l’obscénité en étant présenté dans des salles de cinéma "ordinaires", il a ainsi participé à la "libération" de la pornographie aux États-Unis et dans le reste du monde occidental, et en à fait un phénomène social acceptable qui ne pouvait être contesté que par des conservateurs et des groupes religieux. Pour autant, dans sa biographie intitulée Ordeal (« L’Épreuve »), Linda Lovelace a écrit que son manager et ancien mari Chuck Traynor l’avait forcée à exécuter certaines scènes qui ont fait la célébrité du film : « À chaque fois que quelqu’un regarde Gorge Profonde, il me voit en train d’être violée. C’est un crime qui est en train de se dérouler dans ce film ; j’avais un revolver sur la tempe, tout le temps » (lors du tournage, d’ailleurs expéditif, le cadreur et l’éclairagiste devaient avoir soin d’occulter sur le corps de Linda les ecchymoses récentes). En contraste avec la personnalité extravertie et jubilatoire de l’acteur Harry Reems, qui « n’était pas un grand acteur, mais un grand baiseur », l’actrice Linda Boreman (dite Linda Lovelace) était une pauvre fille exploitée non seulement par son mari (pour en faire une attraction, il l’aurait accoutumée à subir l’introduction d’objets dans son arrière-gorge en dominant le réflexe nauséeux), mais aussi par le réalisateur, et plus tard par les ligues féministes qui brandirent ses témoignages. Le titre du film inspira même au journaliste Bob Woodward le surnom de son informateur secret qui fut à l’origine du scandale du Watergate, le "cambriolage" raté du QG démocrate ayant eu lieu trois jours avant la sortie du film dans les cinémas de Broadway. En 2005, un documentaire d’une heure et demie intitulé Inside Deep Throat est sorti aux États-Unis. Revenant sur l’énorme succès de ce film, ce reportage met en exergue l’écart entre les modestes intentions de ses promoteurs et son incroyable impact sur la société américaine. Preuve de l’évolution des mentalités et qu’est révolue l’époque où Bob Hope se vantait d’avoir parlé de Deep Throat à la TV (il avait osé dire : « Mais oui, je suis allé le voir, je croyais que c’était un documentaire sur la vie des girafes... »), le titre s’est banalisé ! Gérard Damiano réalisa The Devil in Miss Jones après le succès inattendu de Deep Throat. En raison de la profondeur pseudo métaphysique de son scénario et de certaines scènes d’anthologie, il s’agit de l’un des rares films pornographiques qui ait été parfois qualifié de "chef d’œuvre". Il met principalement en scène le héros masculin de Gorge profonde, Harry Reems, et une nouvelle actrice, Georgina Spelvin, qui grâce à sa prestation étonnante, malgré une courte carrière, est entrée définitivement grâce à ce tournage dans la légende du cinéma X. Dans son appartement de New York, une femme célibataire, Justine Jones, se désespère en songeant au vide de son existence. Elle déambule dans l’appartement et se caresse devant une glace mais sans éprouver le moindre plaisir. Elle finit par se suicider en s’ouvrant les veines dans son bain. Bien que toute sa vie ait été exemplaire, elle est alors damnée pour ce suicide et arrive en enfer où un employé du Diable est là pour l’accueillir. Tandis qu’elle contemple une allumette qui se consume entre ses doigts, elle réalise la gravité de son geste et l’ampleur de ce qu’elle a perdu. Elle supplie alors ce subordonné de la laisser revivre afin qu’elle puisse faire en sorte d’être condamnée à l’enfer pour de bonnes raisons. Le diablotin accepte et elle entreprend alors de rattraper le temps perdu en s’adonnant activement au stupre {du latin classique stuprum « action de déshonorer, violence, attentat à la pudeur ; relations coupables » : débauche honteuse, avilissante} et à la fornication. Lors de son second décès, elle retourne en enfer où elle se retrouve enfermée dans une cellule avec un homme (interprété par Damiano lui-même) qui, malgré ses suppliques, refuse de la toucher. En effet, il ne s’intéresse qu’aux mouches volant dans la cellule car il attend le retour de Dieu sous cette forme. Le premier film de Damiano attira 157 000 spectateurs sur Paris-périphérie et le second 102 000 ; les États-Unis n’auront le droit qu’à des versions soft de ces deux films pourtant américains. Un troisième film à la même époque (mais premier du genre), Derrière la Porte Verte (1972), fit naître l’idée que le film pornographique est un matériau propice à l’expérimentation, tout en marquant le début de la starisation de ses actrices. Marilyn Briggs (plus tard rebaptisée Chambers), mannequin au visage connu pour une campagne américaine de publicité pour un savon (le savon Ivory, « pur à 99,44% » d’après le slogan évidemment détourné ensuite par les Mitchell en « impur à… »), répondit à une petite annonce des frères Mitchell pour auditionner le rôle principal. D’abord hésitante, elle envisagea plutôt d’y jouer un rôle non pornographique, mais intriguée par l’histoire elle accepta le rôle principal. Les Mitchell lui proposèrent une offre exceptionnelle pour l’époque : 2 500 dollars de salaire plus un pourcentage sur les recettes et le choix de ses partenaires. Offre profitable puisque le film rapportera 200 000 dollars en 20 semaines et 20 millions en moins de trois ans d’exploitation (un Blair Witch avant l’heure). Ce film est important pour le genre pornographique parce qu’il dit pratiquement déjà tout sur le X dès les années 70 : le charme de Miss Chambers et une patine années 70 (la musique et un certain discours hédoniste New Age typiquement californien, où « l’énergie du bien-être monte des pieds », dixit un personnage) délicieuse tirent le film, distancié et excitant, vers le haut et vers un mystère autrement plus trouble que l’obsession contemporaine de transparence sexuelle. Le film récolta d’excellentes critiques et devint vite le film à voir, donnant une respectabilité éphémère au genre en l’amenant dans les salles de cinéma traditionnelles, les films sortant même sur les Champs-Élysées. Au festival de Deauville de 1975, le ministre de la culture de l’époque, Michel Guy, réserva même une rangée de fauteuils VIP pour la première française du film. Deux chauffeurs routiers s’arrêtent dans un dinner et bavardent avec le cuisinier. Ils en viennent à lui raconter l’histoire de la fameuse Porte Verte : tout commence dans un hôtel avec une jeune femme blonde, ensuite enlevée par deux hommes qui l’amènent à un club où les participants sont masqués. Elle est bientôt sur scène, au centre d’une orgie, devant une assistance d’abord passive puis active. L’un des camionneurs – le narrateur de l’histoire – est dans le public, mais le cuisinier se demande si tout cela a vraiment eu lieu, ou s’il s’agit d’une légende urbaine, dont l’une des premières variantes serait celle du viol rituel d’une jeune mariée dans une maisonnette du sud de la France, auquel des GI pouvaient assister moyennant finance à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Le dispositif "je vais te raconter" du film creuse ce même sillon du fantasme masculin, d’une histoire entre mecs racontée à un comptoir. Le mutisme permanent de l’objet blond du désir Marilyn – face à la logorrhée verbale mâle {besoin fort de parler, souvent de façon incohérente, généralement avec un débit rapide et continu} des sept premières minutes, puis pendant les scènes de sexe – appuie l’idée que le regard et le discours de ces messieurs, et de tous les messieurs blancs du monde, vont structurer le récit. Derrière la Porte Verte épuise pratiquement ainsi – dès 1972 – le genre pornographique en mettant à nu sa nature par une quasi mise en abyme : une femme kidnappée (à l’écran, les ravisseurs sont interprétés par les frères Mitchell eux-mêmes), jetée en pâture puis consentante devant une assistance voyeuse et passive, composée d’un échantillon d’humanité (hommes et femmes de sexualité et physique divers), et finalement plus participative. Soit le rapport trivial {trois voies est emprunté par Rabelais au latin « carrefour » puis « endroit fréquenté » : chose commune, banale, sans connotation péjorative, puis prend son sens moderne de "grossier", qui existait en fait déjà en latin (par référence aux manières des prostituées arpentant lesdits carrefours, eux-mêmes protégés par des phallus d’Hermès)} du spectateur face au film X, d’autant qu’une voix off précise dans le film avant le début du sexe « vous allez assister au viol d’une personne dont la peur initiale s’est muée en curiosité (…) Demain, elle ne se souviendra de rien, sinon d’avoir été aimée comme jamais elle ne l’a été. Même si vous la connaissez, vous ne pouvez rien y faire. Alors, détendez-vous ». La voix s’adresse autant à l’assistance dans le film qu’au spectateur, confortant son voyeurisme dans une expérience sans conséquence. Le film aurait été tourné en un jour, ce qui se ressent dans à peu près toute la première partie hors sexe du film, à cause d’un montage approximatif. Mais lorsque la bagatelle surgit à l’écran, les choses s’améliorent grandement : cadres et éclairages pensés et une manière de filmer près du corps qui a peu à voir avec les plans chirurgicaux du X d’aujourd’hui avec lumière crue. Le choix d’organiser en rituel le sexe pratiqué conditionne la mise en scène et l’atmosphère : Chambers en blanc et ses prêtresses en noir, impressions d’Afrique de pacotille avec l’entrée en scène de l’amant noir, la scène des trapèzes ou l’abstraction du coït final – filmé sur fond noir – composent un climat onirique, d’autant que le langage imagé "d’encouragement" associé au X est absent ici. Vers la fin, lorsque le public du spectacle s’emmêle et emplit l’écran, les règles du porno sont à nouveau à l’honneur mais l’étrangeté demeure : on croit parfois regarder un happening d’art moderne, une performance datée. Marilyn Chambers traverse les outrages, distinguée mais non distante, excitante et passionnée sans trop en faire. Le fruit non défendu même coupé demeure mystérieusement intact, charnel et rêvé. La fin ouverte de Derrière la Porte Verte laisse le goût du fantasme persister. La scène la plus probablement mémorable est celle de l’éjaculation externe et faciale, figure incontournable qui est au X ce qu’est l’explosion au blockbuster moderne ou le jet de sang au gore. C’est un rituel esthétique, paroxysmique de domination masculine pour signifier le plaisir de l’Homme, sa victoire sur la femme. Mais c’est aussi un constat d’impuissance face au mystère de la Femme, puisque si la jouissance féminine est facilement feinte à l’écran (oui ou non ?), le plaisir masculin doit pouvoir s’incarner, la preuve par l’image. A l’énigme féminine, la grammaire pornographique propose donc la réponse la plus crue. Ainsi, heureux ceux qui croient après avoir vu. Les Mitchell trouvent ici le moyen de ridiculiser et célébrer ce cliché du X dans une séquence devant beaucoup au cinéma underground : ralentis (qui confèrent au pénis une vie propre, distincte de celle de son propriétaire), solarisation, filtres et surimpression subliment la satisfaction masculine (ah, la petite mort !) tout en créant une distanciation assez ironique qui renvoie l’Homme à sa tanière. L’extase mâle tout en feux d’artifice n’est qu’une idée, une coupe imbuvable. Un "truc de mecs", pour parler crûment. Le "narrateur" enlève ensuite sa sabine Marilyn sur scène. Le cuisinier lui demande ce qui s’est passé après et s’entend répondre que "cela est une autre histoire". Le narrateur reprend sa voiture et visualise l’Acte (abstrait) avec Marilyn. Cela est-il vraiment arrivé ? Quelle est la part de vrai et de fantasmé ??? Si le narrateur a effectivement assisté à cette orgie, l’a-t-il fait avec Marilyn ? Le film ne répond pas : la seule certitude est que l’image de Marilyn – réelle ou non – obsède l’imagination du narrateur. On notera cependant qu’à la suite de ce coït rêvé ou non, le "narrateur" n’apporte pas la preuve de la jouissance inhérente au genre : il n’éjacule pas. De là à penser qu’il n’a pas "conclu"… après tout quelle importance, tant qu’il a raconté la chose. Mais elle aussi semblait dire, plus crûment, que les amants étaient les meilleurs amis et ennemis d’une femme. En juillet 1972 paru Union, magazine français de charme et d'information sur la sexualité. Un tiers du rédactionnel était composé de photos et courriers des lecteurs et lectrices, le reste se partageant entre les rubriques bonnes adresses, reportages sur le monde du sexe, rubriques Conseils et Sexo (il est devenu depuis davantage orienté vers la pornographie). Les réalisateurs profitèrent de la brèche qui s’ouvrait à eux : Bertrand Blier et l’inoubliable Les Valseuses avec Miou-Miou, Patrick Dewaere et Gérard Depardieu, illustrent parfaitement cette frénésie sexuelle, sans oublier les Contes immoraux de Valérian Borowczyk, évoquant le libertinage à travers les siècles de manière ouvertement érotique. Penthouse se tourna également à partir de 1974, année du lancement de Hustler, vers une présentation de plus en plus anatomique du sexe, donnant une vision détaillée de la vulve souvent accompagnée de poses évoquant la masturbation et montrant les petites lèvres ouvertes. Ensuite apparurent les rapports sexuels simulés, sans pénétration ni verge visible, ce qui fut le cas assez rapidement avec des pénis en érection. Par ailleurs, Penthouse essaya de maintenir la qualité des articles, bien que sur des thèmes plus sexuels que ceux publiés par Playboy. Hustler quant à lui est un mensuel pornographique américain destiné à un public masculin, créé à l'initiative de Larry Flynt en 1974. Nul doute que celui-ci a contribué à briser certains tabous américains dans les années 1970 en exposant notamment des parties génitales féminines de manière plus explicite que ne le faisait le magazine Playboy. Larry dut cependant se battre de part et d'autre avec ceux qui trouvaient son magazine trop explicite sexuellement et qui menaçaient de le faire retirer du marché. Il fut approché par un paparazzi qui détient des photos nues de Jacqueline Kennedy Onassis et il les publia dans l'édition d'août 1975. Ces photos firent énormément de publicité au magazine, si bien qu'il s'en écoula un million d'exemplaires en quelques jours. En juillet 1976, les autorités de Cincinnati accusèrent Larry et quelques membres de la direction d'Hustler de "Pandering", d'avoir produit du matériel obscène. Larry fut reconnu coupable et condamné à 7 ans de prison et à une amende de 11 000 dollars. Finalement, il gagnera sa cause en appel. Les années 1973 et 74 marquèrent la grande offensive du sexe à l’écran : la France vit arriver une production de films B ou Z « avec séquences additionnelles », c’est-à-dire des films traditionnels à petit budget comportant des scènes rajoutées provenant de films hards ou érotiques. Ce phénomène dura un an, jusqu’à l’exploitation in extenso des films d’où sont tirées ces scènes supplémentaires. Parmi cette production de films érotiques, on trouve L’Étalon italien qui marque les débuts de Sylvester Stallone. Se développa alors une production de luxe de films ouvertement érotiques qui bénéficièrent d’une promotion comparable à celle des films traditionnels. Emmanuelle est le fleuron de cette époque. L’air du temps était à la libération des mœurs, mais le film érotique cherchait encore sa place entre une production de plus en plus hard et un cinéma traditionnel qui jouait avec la séduction. Le producteur Yves Rousset-Rouard acquit les droits d'un roman à succès d'Emmanuelle Arsan, Emmanuelle (roman de 1959 où un diplomate raconte les récits de ses rapports pour le moins libres avec sa femme eurasienne, récit attribué à son épouse sous le pseudonyme de Emmanuelle Arsan. Cette magnifique histoire d’amour très troublante fut immédiatement interdite, l’éditeur Losfeld fut condamné à de la prison et à une forte amende. Néanmoins ce livre se vendit, sous le manteau, en millier d’exemplaires, voire dizaine de milliers). Il en proposa l'adaptation à un jeune photographe de charme, Just Jaeckin, qui n'avait qu'une expérience de la photographie et de la publicité. Le casting réunit une jeune actrice inconnue (et pour cause puisqu'il s'agit d'un modèle néerlandais dont c'était le deuxième film : Sylvia Kristel) et un acteur de renom en initiateur pornocrate (Alain Cuny, 65 ans : un des compagnons de la première heure de Jean Vilar au TNP et au Festival d'Avignon, il connut son heure de gloire en 1942 avec Les Visiteurs du soir de Marcel Carné, avec Arletty, Grand prix du cinéma français). Clamant en 1974 avec Arthur Rimbaud qu’il faut changer la vie, le film consacra le triomphe du porno soft à l’usage des familles endimanchées : le culte du plaisir et de la jouissance rencontra un succès planétaire ! Emmanuelle, entouré d'un parfum de scandale, provoqua un vaste débat en France sur la censure des œuvres érotiques. Le film aurait dû, selon la première commission de censure en avril 1974, subir de nombreuses coupes après avoir été interdit par le gouvernement Pompidou pour « manque de respect envers le corps humain ». Cependant, la mort la même année du président de la République française, Georges Pompidou, changea la donne. Un nouveau secrétaire d'État à la Culture, Michel Guy, fut nommé en remplacement de Maurice Druon. Alors que ce dernier était pour la répression, allant jusqu'à l'interdiction et la censure, le nouveau ministre est lui plus modéré et affirmera : « Tous les films doivent pouvoir sortir sans distinction. Je ne me reconnais pas le droit d'interdire à des spectateurs adultes la possibilité de voir les films qu'ils désirent. En 1975, les gens choisissent ce qu'ils veulent voir et je dois les laisser libres ». Suivant la promesse du candidat Valéry Giscard d'Estaing (qui, devenu Président, a eu une relation avec l'actrice principale Sylvie Kristel) d'abolir la censure, il décide alors de ne plus systématiquement suivre la commission, permettant ainsi au film de sortir en salles au prix de quelques coupes, mineures selon le producteur. Il sera simplement interdit aux moins de 16 ans (la même aventure arrivera à sa suite, Emmanuelle 2). Le film sortit le 1er juin 1974 dans une combinaison importante (pour l'époque) de dix-huit salles, soit une capacité de 8 000 fauteuils sur la première semaine (à peu près l'équivalent de L'Arnaque ou du Retour du grand blond qui sortent la même année). Après une première journée à 15 100 spectateurs à Paris-périphérie, le film réalisa la deuxième meilleure semaine de l'année avec 126 530 entrées. La baisse des semaines suivantes fut minime (105 671, 110 199 et 104 501 entrées). Au bout de 8 semaines, le score était de 745 000 spectateurs pour Paris-périphérie. En France, le succès se transforma en triomphe historique. Au bout de quatre ans, le score était de 2 500 000 d'entrées à Paris et de 7 350 000 sur la France. Emmanuelle fut projeté pendant 553 semaines sur les Champs-Élysées (UGC Triomphe) ; les cars de Japonais s'y succédaient et les petits Français y accouraient dès qu'ils atteignaient leur majorité. Le succès fut tel qu'une salle le programma à Paris pendant dix ans (il fut retiré en 1985 ; le score sur Paris intra-muros est éloquent : 2 788 000 spectateurs alors que la population parisienne tourne autour de 2 000 000), proposant en été un sous-titrage en anglais pour les touristes. Ce fut l'un des plus gros succès du cinéma français, attirant dans les salles françaises près de 9 millions de spectateurs et plus de 50 millions dans le monde. Précurseur, le film de Just Jaeckin devint l'objet d'un culte à travers le monde. Aux États-Unis, Emmanuelle fut classé X, puis ressortit dans une version expurgée la même année. En 1978, c'était le plus gros succès d'un film francophone sur le sol américain. Le Japon fut également conquis (16 millions de recette). Des suites furent tournées avec toujours Sylvia Kristel en femme qui se libère (d'autres films essayèrent également de surfer sur la vague) et le succès était toujours là, du moins jusqu'au quatrième épisode (en 1984) qui marque la dernière apparition de l'actrice hollandaise dans le rôle qui la rendit célèbre : Emmanuelle 2 (557 000 spectateurs sur Paris-périphérie), Good-bye, Emmanuelle (341 000 spectateurs), Emmanuelle 4 (378 000 spectateurs). Just Jaeckin se vit confier l'année suivante l'adaptation d'un autre roman érotique célèbre, Histoire d'O [livre érotique et pornographique de 1954 ayant reçu le Prix des Deux Magots l'année suivante. Dominique Aury, secrétaire de la Nouvelle Revue française, intellectuelle de haut-vol, amoureuse de Jean Paulhan, voulait lui écrire une lettre d'amour en forme de roman : « Je n'étais pas jeune, je n'étais pas jolie. Il me fallait trouver d'autres armes. Le physique n'était pas tout. Les armes étaient aussi dans l'esprit ». Commentant le comportement de son héroïne dans Histoire d'O, Pauline Réage dira simplement : « C'est une destruction dans la joie ». L'ouvrage paraîtra avec une préface de Paulhan, visiblement émerveillé du cadeau : « Enfin une femme qui avoue ! Qui avoue quoi ? Ce dont les femmes se sont de tout temps défendues (mais jamais plus qu'aujourd'hui). Ce que les hommes de tout temps leur reprochaient : qu'elles ne cessent pas d'obéir à leur sang ; que tout est sexe en elles, et jusqu'à l'esprit. Qu'il faudrait sans cesse les nourrir, sans cesse les laver et les farder, sans cesse les battre. Qu'elles ont simplement besoin d'un bon maître, et qui se défie de sa bonté... ». C'est d'ailleurs Paulhan qui avait insisté pour que ce roman, écrit pour lui seul à l'origine, soit publié. Pris au premier degré et compris avec une grille de lecture des années 2000 (aujourd'hui le sadomasochisme est un type de pratiques sexuelles institutionnalisé), il ne s'agit que d'un roman érotique, mais Histoire d'O est aussi un cri, celui d'une personne qui veut appartenir à une autre. Si la référence au sadomasochisme est donc bien présente, ce n'est pas aux pratiques visant à pimenter la vie d'un couple, mais à celles qui sont une quête d'absolu, le don de soi. Son écriture, froide et concise, en fait un objet d'autant plus fascinant, d'une crudité assez rare dans ce registre. L'attribution du prix des Deux-Magots (prix qui est octroyé à de jeunes talents prometteurs) a entraîné le succès public, mais aussi de multiples interdictions (de vendre aux mineurs, d'afficher, et de faire de la publicité) et poursuites pour outrage aux bonnes mœurs. Au final, le procès n'eut jamais lieu. Aujourd'hui, ce livre a été diffusé à 900 000 exemplaires], et se spécialisa sur le créneau des films érotiques "haut de gamme", retrouvant Sylvia Kristel en 1981 pour une adaptation de L'Amant de Lady Chatterley [roman de David Herbert Lawrence écrit en 1928. La publication du livre a provoqué un scandale en raison des scènes explicites de relations sexuelles, de son vocabulaire considéré comme grossier et du fait que les amants étaient un homme de la classe ouvrière et une femme de l'aristocratie. Lors de la première publication au Royaume-Uni en 1960, le procès des éditeurs, Penguin Books, sous le coup de la loi sur les publications obscènes (Obscene Publications Act) de 1959, fut un événement public et un test pour cette nouvelle loi qui venait d’être promulguée à l’initiative de Roy Jenkins. Cette loi permettait aux éditeurs de textes « obscènes » d’échapper à la condamnation s’ils pouvaient démontrer que l’œuvre en question avait une valeur littéraire. Dans le cas de ce roman, un des arguments de l’accusation était le fréquent usage du verbe fuck (en français, baiser) et de ses dérivés. Divers critiques universitaires furent convoqués comme témoins, et le procès se termina sur un verdict d’acquittement. Le procès fit jurisprudence pour ouvrir la voie à une plus grande liberté d’expression dans le pays].
Le cinéma populaire s’empara du mouvement et Georges Lautner réalisa une comédie sur le sujet de l’avènement des films pornographiques aux États-Unis, On aura tout vu avec Pierre Richard et une Sabine Azéma débutante très déshabillée (François Perrin, photographe désireux de se lancer dans le cinéma, a écrit avec son ami Henri, un scénario baptisé Le miroir de l’âme. Ne trouvant aucun producteur, François confie le scénario au producteur de films pornographiques, Bob Morlock. Ce dernier transforme le film en érotissisme et le baptise La vaginale. Seulement, ce projet devient la source de conflit entre François et son amie Christine). Les premiers films de Bertrand Blier, Les Valseuses et Calmos, sont emprunts de cette désacralisation du nu qui caractérise l’époque. Devenu culte par son inventivité et sa poésie parfois teintées de cynisme, symbole de toute une époque, de ses dérives et de ses charmes, le film est à sa manière une ode à la liberté et à l’anticonformisme, face aux conventions sociales rigides d’une petite bourgeoisie mesquine et étriquée. Lors de sa sortie (interdit aux moins de 18 ans, puis déconseillé à la télévision aux moins de 16 ans par le CSA), Les Valseuses a connu un certain succès en faisant 5 726 031 entrées en France. Le film raconte la cavale de deux jeunes marginaux. Il illustre la frénésie de la libération sexuelle et des mœurs après l’épisode soixante-huitard. Miou-Miou a d’ailleurs reconnu que le tournage s’était déroulé dans une ambiance survoltée d’excitation sexuelle quasi-permanente, certaines techniciennes ou maquilleuses allant parfois jusqu’à participer aux ébats qui se déroulaient hors caméra. Aux États-Unis, les actrices de premier plan acceptèrent à partir de ce moment de se déshabiller. Le cinéma italien produisit également quantité d’œuvres jouant sur l’érotisme de ses héroïnes (le genre atteignant son apogée avec le Caligula de Tinto Brass en 1980). En 1973, Laura Antonelli gagna ainsi ses galons de star internationale grâce à ses porte-jarretelles aguicheurs dans Malizia. Le dessin-animé n’était pas en reste, puisque 1976 vit également sur les écrans Tarzoon, la honte de la jungle de Picha, qui racontait les aventures coquines de l’homme-singe (un Tarzan laid, lâche et ridicule part à la recherche de son acariâtre compagne enlevée, à travers un univers burlesque et fou, peuplé de mini-phallus, de pygmées cannibales, de fleurs nymphomanes et d’explorateurs éméchés, sur fond de valses viennoises. C’est bien malgré lui qu’il deviendra un héros. Le mythe de Tarzan créé par Edgar Rice Burroughs est mis à mal par un caricaturiste déchaîné collaborateur de revues satiriques, telles que Pan ou Hara-Kiri. Dans la version américaine, la voix de Tarzoon est celle du propre fils de Johnny Weissmuller, l’athlétique interprète de Tarzan dans les années 1930 et 1940. Les héritiers de Burroughs tentèrent de faire interdire le film pour obscénité et réclamèrent du moins le retrait du nom de Tarzan dans le titre, transformé en The Shame of the Jungle. Pour éviter d’être classé X au moment de sa sortie aux États-Unis en 1979, le film dut être amputé de quelques scènes. Cette parodie dévastatrice s’inscrit dans la lignée des nouveaux films d’animation destinés aux adultes qui apparaissent dans les années 1970, à la suite de l’irrévérencieux Fritz the Cat sorti en 1972 – premier film d’animation classé X et réservé aux adultes, qui rencontra un grand succès critique et générationnel. Durant la production, le distributeur initial, la Warner Bros. Pictures, rejeta le projet après avoir visionné quelques minutes de la version de travail. Crumb lui-même rejeta ce film animé, ce qui ne l’empêcha pas d’être. Dans l’histoire Fritz the Cat Superstar publiée en 1972, Fritz est dépeint comme une star d’Hollywood arrogante et exploitée par ses producteurs et son agent, caricaturant la réalité de l’auteur. Alors qu’il conduit sur Sunset Boulevard, Fritz est appelé par une fan lapine qui lui demande de la violer. Plus tard dans l’histoire, après avoir rencontré une ancienne amie autruche, Fritz quitte son appartement lorsque tout à coup il reçoit un coup de pic à glace dans le dos et meurt). Dans le même temps, les premiers films "hardcore" (en argot, « du vrai » : contenant des actes sexuels non simulés), arrivèrent en France dès 1975, l’américain Alex de Keuzy exposant dans Anthologie du Plaisir le sexe de manière claire, sans artifices, passant alors de la suggestion à la représentation non simulée de l’acte. Après le succès de films tels qu’Emmanuelle, le cinéma érotique et pornographique connut un engouement toujours croissant du public : profitant d’une législation laxiste, les salles spécialisées se développèrent beaucoup plus rapidement que les cinémas classiques, et le cinéma X créa ses propres stars comme Alban Ceray et Brigitte Lahaie, José Bénazéraf ayant sortit quatre films hard. Les films pornographiques représentaient la moitié des films projetés et prirent 20% de part de marché sur Paris-ville et 15% sur la France (soit 25 millions de spectateurs) : Exhibition de Jean-François Davy attira 575 000 spectateurs sur Paris-périphérie et 15 millions sur la France, soit un score comparable au succès des James Bond de l’époque. Trois autres films dépasseront le million d’entrées en France : Les Jouisseuses en 1974 (2,2 millions), Les expériences sexuelles de Flossie en 1975 (1,5 millions) et La masseuse perverse en 1973 (1,1 millions). La prolifération de ce nouveau genre de films provoqua toutefois des remous, les milieux conservateurs s’érigeant contre cette liberté. Le mouvement avait même gagné rapidement l’intelligentsia et des auteurs-réalisateurs tels qu’Alain Robbe-Grillet, Marco Ferreri ou Barbet Schroeder, abordèrent de façon directe les divers aspects de la sexualité. Le mouvement de la passion érotique est dans "l’égarement et la démesure" au sens où Nietzsche l’entend : « Ce que nous voulons, écrit Bataille, est ce qui épuise nos forces et ressources et qui met, s’il le faut, notre vie en danger ». C’est ce que Sade affirme lorsqu’il dit que l’essence de la volupté est à l’image du crime. Le gouvernement du premier ministre Jacques Chirac, jusque-là attentiste et pensant d’abord à l’autodiscipline, se rangea à l’idée d’une taxation plutôt que d’une censure, qui existait tout de même : les pornographes étaient régulièrement convoqué en chambre correctionnelle, les avocats faisaient toujours plus ou moins la même plaidoirie invoquant l’art, agitant le spectre de l’Inquisition et à la fin, il y avait de toute façon une amende, dont le tarif variait en fonction de l’inspiration de l’avocat. Cette entrée du sexe dans le paysage français se traduisit également par l’apparition des premiers sex-shops, ce qui est plutôt révélateur du rapport des français au sexe et à la pornographie. Malgré l’existence de librairies libertines dès les années 30, le mot sex-shop n’a lui été utilisé qu’à partir des années 70. Dès 1973, l’obligation d’opacifier les vitrines (par arrêté préfectoral) obligea les propriétaires des lieux à se faire remarquer par des néons et enseignes lumineuses. Des cabines de visionnage apparurent dans ces lieux dédiés à la sexualité de sorte qu’en 1975, après la loi de taxation sur les œuvres pornographiques, les sex-shops diffusèrent les films n’ayant pas obtenu les visas d’exploitation [tous les films autorisés à la vente, avec comme restriction l’absence de scène de viol ou d’inceste et les déclinaisons de spécialité tel le sado-maso ou le scato ; de nombreux films sont multicritères, ainsi de nombreux films hétérosexuels incorporent des scènes homosexuelles mais uniquement féminine, les films transsexuels étant souvent catalogués comme films gay ou lesbien. Bien sûr, le fait de réaliser, posséder ou distribuer un film pédophile, nécrophile (sexualité avec des morts) ou zoophile (avec des animaux), constitue un délit pénal, pouvant aboutir à des peines de prison et d’amendes]. Les sex-shops devinrent alors des lieux de masturbation et des espaces à dimension communautaire par le biais de la diffusion de petites annonces en vue de rencontres sexuelles. La loi de 1975 institua ainsi le classement X (voté par la droite parlementaire alors que la gauche y était majoritairement opposée : une grande manifestation eut même lieu au Trocadéro et les partis de gauche annoncèrent qu’ils dénonceront cette "censure" à la prochaine alternance), classement attribué aux films interdits aux moins de dix-huit ans en France, considérés comme pornographiques (à différencier de la simple interdiction aux moins de 18 ans – pour les films mettant en scène des violences ou portant atteinte à la dignité humaine –, qui n’est pas assortie des mêmes contraintes légales, c’est-à-dire l’obligation de diffuser les films jugés pornos dans des salles spécialisées), et instaura une taxation spécifique (hausse de la TVA de 20% pour ces films pénalisant fortement les producteurs, suppression de tout droit au soutien automatique). Cette loi eut pour effet de ranger le cinéma pornographique dans une catégorie séparée, où la rentabilité était difficile à obtenir, n’incitant pas à une grande créativité et offrant des transpositions télécinéma médiocres, avec de la neige sur les vidéos (il y eut tout de même en contrepartie une taxe de 300 000 francs qui fut mise en place sur l’exploitation des films X étrangers, ce qui créa un protectionnisme de fait qui permit à la production française de vivre correctement pendant encore quelques années : 85% des films projetés en France étaient français). Ce fut la fin de "l’âge d’or de la pornographie" (la loi instituant le classement X relança en même temps le succès de la production des films érotiques de luxe : privée de l'accès aux films X marqués d'infamie, une partie du public se retourna vers le film de charme, Emmanuelle devint le symbole du cinéma érotique acceptable même si la version française à succès n'était pas complète puisque la longue scène d'amour entre Emmanuelle et Bee avait été coupée – elle est aujourd'hui généralement rétablie à la télévision) : de 200 salles en 1975, la loi du 31 octobre 1975 a fait chuter le nombre à 136 l’année suivante. En 1977, les salles X faisaient encore 8 millions d’entrées sur la France, soit 5% des entrées. Marc Dorcel, producteur et réalisateur français de cinéma pornographique créa sa société en 1979. Ayant commencé par des romans-photos érotiques, son premier film de fut Jolies petites garces en 1979. Plus de 4 000 cassettes de Jolies Petites Garces furent vendues en sex-shops. À 500 francs la cassette, les bénéfices étaient très importants. Le nombre de salles X tomba à 72 fin 1981, mais la part des films X était encore de 13% de la fréquentation de Paris intra-muros et 5% sur la France. Les plus gros succès du genre attirèrent environ 170 000 spectateurs, les deux réalisateurs dans le vent étant alors Burd Tranbaree (Les bas de soie noire, Initiation d’une femme mariée) et Gérard Kikoïne (Bourgeoise et pute), la ressortie d’Exhibition attirant encore 87 000 spectateurs en 1983. L’année suivante marqua une cassure. Les temps avaient changé : la peur du SIDA apparut et l’esprit libertaire des années 70 a progressivement laissé le champ à l’esprit libéral des années 80. Le développement des technologies de support comme les cassettes vidéo VHS permit l’accès au grand public des films pornographiques dans le cadre de la vie privée, en quittant le milieu restreint des cinémas X, la qualité des productions déclinant généralement pour répondre à une demande continuellement croissante (le libéralisme, la pilule, la psychanalyse lacanienne et les confessions radiophoniques de Ménie Grégoire – épouse de Roger Grégoire, conseiller d’état, son émission sur RTL a permis de vulgariser la psychanalyse et démythifier la sexualité – se donnèrent la main de telle sorte que l’érotisme aseptisé, ayant perdu sa charge subversive, pouvait s’afficher au grand jour et devenir marchandise à usage domestique). Le marché du X en salles s’effondra, comme l’illustre bien le plus gros succès de 1984 qui fera moins de la moitié de celui de 1983 (55 000 contre 134 000 entrées sur Paris). Même pour le film de charme (soft), la fréquentation s’est érodée : Emmanuelle 4 (1984) côté France et 9 semaines 1/2 (1985) côté États-Unis sont les derniers films érotiques à connaître un succès en salles. Le mouvement s’amplifia en 1985, lorsque Canal+ fut autorisé à diffuser un film X par mois (ce qui sauva la chaîne de la faillite), le premier étant Exhibition. Le film érotique soft se cantonnera quant à lui désormais à des productions télé calibrées pour les secondes parties de soirée, sur M6, la petite chaîne qui montait et grimpait. La création d’un journal du hard sur Anal+, la baisse du prix des cassettes (qui passèrent de plus de 150 euros en 1984 à moins de 15 euros quinze ans plus tard), la publicité faite par les chaînes de télévision aux stars du X et l’essor du DVD finirent par déculpabiliser les spectateurs. Le marché de la vidéo hard explosa et de véritables empires du sexe filmé furent créés (le suédois Private qui possède la plus grande collection de DVD pornographiques au monde, dont le classement thématique permet de cibler les différentes catégories de consommateurs, ou l’américain Vivid par exemple) profitant de l’essor de chaînes de télévision spécialisées (Play-boy TV aux États-Unis dès les années 80, XXL en France au milieu des années 90). Les films érotiques hard assurèrent plus de 75% des recettes de pay-per-view dans les hôtels et les cassettes X quittèrent les magasins spécialisés pour être vendues dans les kiosques à journaux traditionnels. Ce cinéma créa ses vedettes : les hommes restaient (Rocco Siffredi, Christophe Clark, Tom Byron, Roberto Malone), les femmes passaient (Traci Lords, Julia Chanel, Tabatha Cash, Laure Sinclair...). Côté cinéma, si les jeunes actrices n’hésitaient plus à se dévêtir pour accéder à la célébrité, l’érotisme des films des années 80 et 90 était moins naturel qu’avant, puisqu’on jouait davantage sur la suggestion (Sharon Stone dans Basic Instinct) et la sensualité (Exotica ou L’Amant), seul le cinéma espagnol donnant au nu un peu de chaleur avec des personnalités telles que Pedro Almodóvar (Attache-moi) ou Bigas Luna (Les vies de Loulou). En 1991, il n’y avait plus que 24 salles X sur tout le territoire français et, dix ans plus tard, une seule à Paris (Le Beberley - 75002). Si la sexualité française semble s’être décoincée chez les particuliers, les Dorcel père et fils sont en revanche plus amères sur l’évolution « des gouvernances » en matière de cul. En évoquant avec nostalgie « les affiches 4x3 mètres de pornos sur les Champs Elysées, qui restaient parfois un an à l’affiche, quelque chose d’impensable maintenant », ils ont pointé le paradoxe d’une société certes plus épanouie au lit, mais pas forcément débarrassée de certains tabous. L’exemple le plus frappant a été cette pique adressée au cinéma traditionnel où « les scènes de sexe non simulées sont quasiment toujours associées à un univers négatif, à la douleur, à la culpabilité », citant les films de Lars Von Trier, ou le fameux Baise-moi. « Rappelons que pour le Centre National de la Cinématographie, un film avec des scènes de sexe explicite qui pourrait être l’objet de masturbation doit être classé X ».
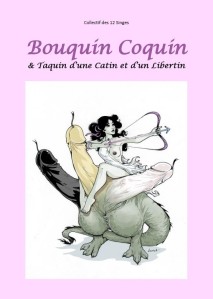 Bienvenue aux mateurs de tous poils ! Ceci est le blog dédié à notre troisième livre autoédité,
Bienvenue aux mateurs de tous poils ! Ceci est le blog dédié à notre troisième livre autoédité,
« Bouquin Coquin et Taquin d’une Catin et d’un Libertin »
(pour nous soutenir en commandant, c'est ici !!!).
Après « Lendemain du Grand Soir », « La philo south-parkoise, ça troue le cul !!! », voici notre essai érotique et réflexif sur la place et l’impact de la sexualité sur nos vies sociales et sentimentales, utilisant des vocabulaires thématiques « neutres » (nature, sports mécaniques, gastronomie, végétaux, sports, musique, drogues) détournés de leur contexte et sens originel pour visualiser des scènes érotiques (l’œuvre reste érotique-chic plutôt que porno-crado !).
Parallèlement à cela, nous avançons sur « Une histoire d’Homo Sexualis » : émergence biologique puis évolution comportementale du sexe, la sexualité chez les autres animaux ainsi que dans notre vaste groupe de primates, puis chez les différents Homo qui se sont succédés jusqu'à nous (même dans l'art préhistorique, constellé de triangles pubiens et de phallus), la vision mythologique du sexe et de la sexualité, la prostitution dans la civilisation.
Catégories
- Bouquin Coquin & Taquin ... (24)
- La prostitution à travers les âges (8)
- La contraception à travers les âges (2)
- La naissance de la sexualité biologique (1)
- La sexualité chez les autres animaux (1)
- La sexualité de la famille primates / Homos (1)
- La sexualité de nos ancêtres deux fois "sages" (5)
- La sexualité dans la civilisation et ses mythes (5)
Recherche
Derniers articles
- Histoire du sexe filmé
- ANNIV' des 5 ans du Collectif des 12 Singes : PROMO à pas chère jusqu'à Noël
- ** COMMANDER ** « Bouquin Coquin et Taquin d'une Catin et d'un Libertin »
- Chapitre 0 : L'innocence de l'enfance face à la montée du besoin/envie de jouissance
- Introduction de Bouquin Coquin et Taquin d'une Catin et d'un Libertin
- Chapitre 1b : Le boum-boum zen dans sa Benz
- Chapitre 1a : Contons fleurette à la belle des champs
- Chap 10b : Plus on est de fous plus on jouit
- Chap 8 : Les Amazones démontent Jésus
- Chap 5 : Heureusement qu'il y a l'Amour, enfin ... !!! / ???
Publications en direct liv(r)e
Liens
- Groupe facebook dédié à Bouquin Coquin
- Blog du Collectif des 12 Singes (et Bonobos)
- Suivi de nos publications en direct liv(r)e
- Une jolie histoire de libertinage : découvrir, pas à pas, les débuts d'un jeune couple dans sa quête du plaisir
- Histoire erotique gratuite (blog pour rendre le pouvoir aux mots)
La prostitution à travers les âges
• Historienne : La prostitution n'est pas « le plus vieux métier du monde » ! Elle n'a pas été présente, loin s'en faut, dans toutes les sociétés humaines (tout comme elle n'est pas intemporelle, car elle a même disparu lors de moments historiques révolutionnaires ou dans certains modes de vie communautaires qui ne réprimaient pas la sexualité). Dans les sociétés protohistoriques comme dans les sociétés primitives et les sociétés traditionnelles, la prostitution n'existait pas. En effet, la liberté des échanges sexuels, encore pratiquée dans certains groupes ethniques, montre que l'idée même de prostitution est restée étrangère à de nombreuses populations. Jusque dans son plaisir solitaire, le plaisir de l'individu des sociétés anciennes ne pouvait jamais être le plaisir d'un individu unique, puisque l'individu n'existait que dans son rapport à la communauté humaine. Cependant, avec la naissance des premières formes organisées de spiritualité, il pouvait déjà exister des femmes « maraboutes » vivant dans des demeures qui regroupaient des filles spirituelles et se livrant à l'exercice de la prostitution sacrée (parfois même toutes les femmes d'une tribu étaient concernées par cette pratique qui apparaît alors comme une survivance de rites d'initiation sexuelle). Dès la période historique, la prostitution exista, sous forme de prostitution sacrée puis de service sexuel vénal (certains pensent d'ailleurs que c'est la naissance du mariage institutionnalisé par l'état et la religion, à la place des alliances matrimoniales claniques, qui a incité le phénomène de prostitution, l'amour collectivisé ou tarifé permettant d'échapper au couple à visée essentiellement patrimoniale/propriétaire). Avec la formation des Etats-empires mésopotamiens, c'est-à-dire avec la mise en mouvement de la valeur comme puissance autonomisée par la domination d'une classe des maîtres sur une classe populaire, le plaisir était lié à la puissance de l'Etat et aux manifestations de cette puissance dans les cérémonies publiques et les réjouissances collectives à la gloire de l'aristocratie. La prostitution sacrée était, à l'origine, liée aux cultes de la fécondité, le point de départ étant à la fois religieux et familial : les cultes de la déesse-amante, présents dans toutes les sociétés anciennes, avaient pour rite essentiel l'union sexuelle des hommes avec des prostituées sacrées. Au départ, seuls les prêtresses et les prêtres de la divinité devaient s'accoupler, afin de provoquer la fertilité des terres et l'abondance du gibier, mais rapidement des groupes de femmes et d'hommes liés aux sanctuaires apparurent et s'unissaient aux prêtresses et aux prêtres, puis aux fidèles, afin de ressourcer la force génitale des fidèles masculins et pour que cette force étende ses effets positifs à la fertilité des troupeaux et des sols. Les premières femmes à avoir été consacrées à la prostitution sacrée pour honorer la déesse de la fertilité, Inanna à Sumer, devenue Ishtar pour les Babyloniens, étaient les femmes stériles ; ne pouvant assurer la procréation au sein d'une famille avec un seul homme, elles trouvaient une place dans la société en servant la déesse, devenant les épouses de tous. De même, les prostitués masculins apparaissent avoir été à l'origine ceux qui, par malformation naturelle ou par accident, ne pouvaient pas davantage assurer la continuité de l'espèce ; eux aussi trouvaient ainsi, au service de la déesse, une place dans la société (ayant également un rôle dans les liturgies publiques et privées d'Inanna et Doumouzi - son compagnon berger, image du roi avec son troupeau de fidèles -, mais cette prostitution semble avoir eu un caractère plus marginal et plus sordide). En Mésopotamie, les prostituées étaient nombreuses et leurs appellations diverses indiquaient leur allégeance à un dieu ou leur spécialité. Elles étaient attachées à l'un ou l'autre temple et y exerçaient leur art au bénéfice de la divinité qui les rétribuait. Il existait ainsi une homologie entre l'actrice rituelle et la prostituée qui, en l'occurrence, concilie l'impureté méprisée de son métier et les hautes compétences symboliques qui vont avec, la pauvreté de ces compétences culturelles et les pouvoirs qu'elle est capable de conquérir. C'est en tant que telles que les prostituées sacrées se trouvaient en affinité avec les vierges et les dieux, personnages transitifs, entre deux états, entre deux mondes, et susceptibles à ce titre d'assurer des médiations spécifiques. En effet, la vierge a une position neutre, hors du commerce sexuel donc asexuée en quelque façon, qui en fait une médiatrice religieuse centrale dans un monde social où la séparation des rôles masculins et féminins était très rigide. En jouant la vierge, la prostituée sacrée faisait sans doute écho à cette homologie et, en même temps, comme elle donnait corps à un être double (la putain vierge) elle en dévoilait le principe, le ferment : la vierge comme la prostituée nie les valeurs du groupe tout en les fondant (la fécondité pour l'une, la pureté pour l'autre). La prostituée sacrée était ainsi une médiatrice capable de veiller sur des passages, de capter et détourner vers le groupe social des influences cosmiques. Le noyau de l'action rituelle consistait alors à traverser les frontières et singulièrement la moins perceptible et la plus décisive, celle qui sépare les mondes visible et invisible : le fait de se dénuder, emblématique s'il en est du métier de prostituée, prenait le sens d'un dédoublement, d'un passage dans l'au-delà et d'une substitution avec l'entité invoquée. Sortir de son corps, à l'instant du rite et aussi en rêve, permettait à l'officiante d'assurer le lien entre des espaces et des êtres distincts et séparés. « Curatives », ces « femmes sans hommes » avaient un statut ambigu dans la mesure où elles oscillaient entre les catégories du féminin et du masculin, de l'humain et du divin, de l'impur et du pur : elles visaient à obtenir un bénéfice immédiat au moyen de rituels, lesquels, par les chants, la musique et la danse, permettaient de communiquer avec les dieux. Ces bayadères (femmes dont la profession était de danser devant les temples en Inde) étaient ainsi consacrées autant au culte des dieux qu'à la volupté des croyants, l'un nourrissant l'autre. Le Code d'Hammourabi, notamment la loi 181, citait une hiérarchie des prostituées sacrées sans faire ouvertement référence à une rémunération par les fidèles. Mais, très vite, on voit que les offrandes aux dieux furent remplacées par le paiement de ces personnes, et, en beaucoup de lieux, la prostitution du personnel religieux servit à alimenter le trésor du sanctuaire. Concrètement, des fonctionnaires de certains temples géraient des maisons de prostitution, et la déesse Inanna possédait ainsi des cabarets, des débits de boisson et des lupanars : « Sise à la porte du cabaret, je suis la prostituée experte du pénis ! ». Se détachant peu à peu de sa fonction religieuse (la « prostituée sacrée » comme vestale - prêtresse dédiée à Vesta, déesse du foyer à Rome, continuatrice d'une très ancienne tradition, le maintien du feu commun perpétuellement allumé, sauf qu'elle devait rester vierge, car en cas de relations sexuelles sacrilèges, un crime qualifié d'incestus, la vestale était enterrée vivante ou brûlée vive - et comme exorciste de la menace que les femmes faisaient peser sur la communauté abstraite de la religion), elle apparaît comme « marché » dans les sociétés où l'État, aux mains d'une classe sociale dominante (une aristocratie, une oligarchie, une théocratie), exerce sa puissance et sa tutelle sur le reste de la société. Il faut que le rapport marchand urbain se soit autonomisé comme espace d'échange de valeur pour que « le commerce » sexuel s'y rattache. Les empires-États mésopotamiens, non seulement permirent, mais établirent la prostitution comme catalyseur d'urbanisation et opérateur de la circulation de la valeur (à la place du système économique clanique basé sur le don et le contre-don, on instaura par ce biais la notion d'échange marchand propice aux sociétés étatiques). La prostitution devint une affaire d'argent et l'on quitta le domaine du « sacré ». Ces comportements se monnayaient : les sanctuaires s'enrichissaient des sommes payées par les fidèles désirant accomplir le rite, de même que les chefs de famille rentabilisaient le prêt des femmes qui étaient leur propriété. Les responsables des États, à Babylone comme dans tout le Moyen-Orient, ne laissèrent pas échapper cette source de revenus, et se mirent à créer leurs propres maisons de prostitution. Les prostituées se multiplièrent autour des temples, dans les rues et dans les tavernes. Ainsi, Ourouk, la ville d'Inanna, était renommée aussi bien pour les diverses catégories de femmes dont les activités étaient partiellement ou intégralement vouées à la prostitution que pour les diverses variétés d'invertis et de travestis, les deux associées ès qualités aux cultes locaux. Nanaya, autre déesse d'Ourouk, était clairement associée à l'érotisme et à la sexualité tarifée : « Si je suis droite contre le mur, c'est un sicle ; si je me penche, c'est un sicle et demi ». Toutefois, il ne manquait pas de péripatéticiennes qui travaillaient en indépendantes dans les rues, le long des quais ou à l'ombre des murailles. Les prostitué(e)s avaient en commun avec les humains consacrés aux dieux qu'ils échappaient au cadre familial et à ses règles sexuelles, mais le mariage ne leur était pas interdit, même si c'était une union que désapprouvait l' « homme sage » (il déconseillait d'ailleurs tout autant tout mariage avec une femme rencontrée lors de fêtes et spécialement parée à cette occasion). Pourtant, l'importance sociale et le rôle positif de la prostitution apparaissent bien dans l'Epopée de Gilgamesh où une femme, appelée « Epanouie », séduisit Enkidou, et, de brute sauvage qu'il était, en fit un homme ! Enkidou, à l'approche de la mort, maudit la prostituée qui l'avait arraché à l'innocence de sa vie première, puis, prenant en compte le bien qu'elle lui avait somme toute apporté, revint sur sa malédiction. Pour la Bible, les femmes mésopotamiennes aux mœurs dévoyées et les despotes efféminés étaient la négation même de la différence entre les sexes et donc la négation de la société et de la civilisation. Les fondateurs de la religion hébraïque voulurent rejeter le culte des idoles qui se manifestait, notamment, par la prostitution sacrée : ils furent donc amenés à proscrire toute prostitution sacrée pour les « filles d'Israël ». Mais les textes montrent le peu d'efficacité des interdictions car des prostitués, hommes et femmes, liés au Temple, sont évoqués de multiples fois, à propos du fils de Salomon ou du roi Josias, par exemple (le roi Josias, vers -630 « ordonna de retirer du sanctuaire de Yahvé tous les objets de culte qui avaient été faits pour Baal, pour Ashéra et pour toute l'armé du ciel. Il démolit la demeure des prostituées sacrées, qui était dans le temple de Yahvé »). La prostitution vénale existait aussi (évoquant la prostitution, le livre d'Ezéchiel précise dans un langage très cru comment la femme dite de mauvaise vie « raffolait d'amants dont le membre viril égalait celui d'un âne et la décharge celle d'un cheval »), les hommes avaient facilement recours aux prostituées et n'étaient accompagnés d'aucun jugement moral négatif (les livres de sagesse répètent à qui mieux mieux le conseil d'éviter celles qui vous prendront dans leurs filets pour vous dépouiller de tous vos biens, mais les recommandations sont du domaine de la prudence, non du respect des personnes, et la prostituée est un personnage bien présent dans le monde de la Bible) : dans ces sociétés, la sexualité était un comportement humain, comparable aux autres recherches de plaisir, donc tout à fait normal. La prostitution ordinaire était interdite aux femmes du peuple hébreu, mais autorisée pour les étrangères (finalement, même les juives la pratiquaient, presque légalement). En fait, cette interdiction fonctionnait grâce à un tour de passe-passe, car n'était pas appelée « prostituée » la femme que son père prêtait contre de l'argent, mais seulement la femme qui était sous l'autorité d'un homme et qui, sans son approbation, vendait ou donnait ses charmes. C'était le détournement du bien d'un chef de famille qui était interdit, pas le commerce sexuel, et, au Moyen-Orient, un père pouvait monnayer les services de sa fille dès que celle-ci avait trois ans. La Bible montre de fait que les hommes avaient facilement recours aux prostituées. En Egypte, la prostitution était pratiquée sur les bords du Nil, mais elle était condamnée moralement puisqu'on attendait même d'un veuf de longue date qu'il évite ce genre de fréquentations. Pour autant, les maisons closes existaient (représentations d'accouplements collectifs sur papyrus ou tessons de poterie). Par contre, il n'y avait pas de prostitution sacrée, les relations (même intimes) entre une prêtresse et une divinité s'effectuant dans le cadre d'une relation symbolique de couple légitime. En somme, dans de nombreuses sociétés archaïques, la prostitution n'était pas mal vue et représentait pour les femmes de condition libre une source de revenus pour se constituer une dot et accéder ainsi au mariage qui était un statut recherché (ce fut par exemple le cas dans la société étrusque, où les femmes avaient pourtant des droits importants, à la grande indignation des Grecs qui reprochèrent de ce fait aux Étrusques la légèreté des mœurs de leurs femmes - en plus de leurs pouvoirs et de leur « autonomie »).
• Animateur : Qu'en était-il justement des civilisations grecques et romaines, fortement influencées par leurs prédécesseurs orientaux ?
• Historienne : Dans ces sociétés esclavagistes, seul le plaisir des maîtres existait, car il était le seul à contribuer à la puissance de l'Etat. L'esclave concourait d'ailleurs à intensifier ce plaisir. Il n'était pas condamnable, ni même répréhensible, de vendre des êtres humains : son enfant, garçon ou fille, sa mère, sa sœur, voire soi-même. Avec l'esclavage, le commerce des humains générait la recherche de personnes à prostituer : guerres, rapts, razzias de pirates et de bandes organisées fournissaient un abondant personnel aux proxénètes et à tous les amateurs dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Dès la petite enfance on pouvait être rentable pour son propriétaire, et souvent celui-ci consacrait temps et argent afin de parfaire les qualités sociales et les compétences érotiques de ses protégés dans l'espoir d'un profit maximum (des hommes ou des femmes de bonne famille tiraient même profit de la beauté de leurs esclaves en les prostituant dans un coin isolé de leur domicile). L'histoire des plaisirs de la chair (manger, boire et faire l'amour) dans la démocratique Athènes est une étude de la jouissance des sens que procure aux hommes de la cité le marché des corps et de la table (sur les vases attiques du -Vè siècle, la représentation des ménades - ivres en permanence, jouant du tambourin et chantant la joie de chasser les chèvres -, les adoratrices et nourrices de Dionysos - dieu de l'extase et de tous les sucs vitaux dont le sperme, il est celui qui permet à ses fidèles de dépasser la mort -, est très proche de celles des courtisanes vouées au culte d'Aphrodite - déesse dérivée de la sumérienne Inanna, elle symbolise tant le plaisir de la chair que l'amour spirituel, pure et chaste dans sa beauté ; les femmes étaient tant ses victimes que ses instruments destinés aux hommes car, elle-même mariée à Héphaïstos, elle eut de multiples aventures extraconjugales). Le banquet athénien de l'époque classique, le lieu par excellence des plaisirs de la chair, avait recours à des « professionnels » des deux sexes. Les épouses et les filles de citoyens étant par leur statut exclues des festivités de l'andrôn, il était dans l'ordre des choses que les femmes admises à partager la couche des dîneurs et à contribuer à leurs divertissements soient exclusivement des « professionnelles », pornai (prostituées) ou hetairai (compagnes) rétribuées d'une façon ou d'une autre, pour leurs prestations. Rappelons tout de suite que l'érotisme masculin est à aborder dans la sphère de la consommation vénale de partenaires féminins ou masculins : l'hétérosexualité n'était pas uniquement confinée à la reproduction de l'oikos (la maison) et de la polis (la cité) et l'homosexualité masculine était aussi concernée par le marché du sexe. Même si la liaison de l'éraste, l'adulte, et de l'éromène, le pais (« l'enfant » qui n'a pas encore de poil au menton), ne relevait pas du marché des corps, mais de la paideia, de l'éducation, des adolescents apparaissent en grand nombre dans l'iconographie du banquet où ils faisaient les échansons (chargés de servir à boire aux personnages de haut rang) et le service de la table, et ils étaient, bien plus souvent que des éromènes (amants), des « professionnels » venus du marché du sexe. De leur côté, les femmes qui accompagnaient les hommes en société (fermée aux femmes honnêtes) et qui avaient reçu à cette fin une certaine éducation - dont étaient privées les femmes en général - étaient dites « compagnes ». Ces hétaïres (courtisanes de luxe) étaient de riches affranchies ou des étrangères qui faisaient, librement, commerce de leur corps. Elles circulaient librement et menaient une vie indépendante, contrairement aux femmes mariées, mais elles n'obtenaient jamais le statut de citoyennes. Comme disait un contemporain : « Les hétaïres nous les avons pour le plaisir, les concubines pour les soins de tous les jours, les épouses pour avoir des enfants légitimes (pour perpétuer le nom et recueillir le patrimoine du père) et garder fidèlement le foyer ». Les femmes étaient donc classées dans la société non par les critères sociaux, mais par leur rôle sexuel. Ainsi, dans le monde des plaisirs, à Athènes comme ailleurs, la hiérarchie des professionnelles a toujours un grand nombre d'échelons, ainsi la distinction entre pornai et hetairai devient obsolète. Ce sont toutes des prostituées. Toutefois, la première différence, essentielle, porte sur le mode de rétribution des prestations. La pornê était payée en argent par ses clients (souvent représentés sur les vases la bourse à la main !), l'hetaira recevait des cadeaux de ses hetairoi (compagnons) et de ses philoi (amis). Dans le premier cas, il y avait échange anonyme de marchandises : ce que vendait la pornê, son corps, son sexe, accessoirement ses talents artistiques, était une marchandise et elle était, elle-même, une marchandise. Cette dernière était tarifée, qu'il s'agisse de la personne (il y a des professionnelles nommées « une obole », « deux drachmes ») ou du type de passes demandées par le client, la kubda, la pénétration anale, ayant le prix standard le moins élevé. Dans le second cas, des cadeaux étaient échangés entre des personnes liées entre elles par la philia, un terme qui dit moins la relation sentimentale que l'appartenance à un groupe engagé dans des liens de réciprocité. Aux dons de ses philoi qui assuraient son entretien, l'hetaira répondait par un contre don. Le contenu et le montant du don et du contre don étaient à la discrétion des donateurs. Une hetaira n'avait pas les mêmes exigences et les mêmes gracieusetés vis à vis de tous ses philoi. Elle avait, en revanche, intérêt à ce que soit respecté ce mode de rétributions de ses prestations et à déployer toute une stratégie pour garder l'amitié hors du marché, car il y allait de son rang. Aussi, lorsqu'elle acceptait de se faire payer en argent, et que sa position dans le monde des plaisirs lui permettait de le faire, elle exigeait des sommes fabuleuses (mille drachmes pour une nuit) ce qui ne faisait qu'accroître son prestige et confirmer sa place dans la hiérarchie. Le deuxième paramètre à considérer est la nature et la durée des services demandés. Dans tous les cas, la copulation faisait partie du jeu, mais elle pouvait être associée à d'autres prestations comme le chant, la danse ou la conversation, voire des soins divers. La location pouvait être opérée par un ou plusieurs clients et sa durée pouvait aller de la simple soirée à celle d'un ensemble de festivités. Entre la pornê qui était payée à la passe et qui devait accepter tous les clients et l'hetaira qui avait un nombre restreint de philoi assidus et qui devait être « séduite » pour accorder ses faveurs, l'échelle était longue et ses degrés bien flottants. Le troisième paramètre à considérer lorsqu'il s'agit de distinguer la pornê de l'hetaira était « l'économie du regard ». A Athènes, la réclusion dans l'espace privé était le signe d'un statut (et même d'un rang social) : l'Athénienne, la fille / épouse / mère de citoyen, était dissimulée à tous les regards, à l'abri de ses vêtements et des murs de l'oikos de son père puis de son mari. L'espace de l'hetaira oscillait entre ces deux extrêmes qu'étaient l'espace public de la pornê et l'espace privé de l'épouse. La pornê était exposée aux regards de tous : son corps était dénudé (pour l'exhibition du bordel puis lors de ses prestations de musicienne et de danseuse) ; elle n'était pas rattachée à un oikos et partageait la promiscuité du bordel. L'hetaira avait une résidence personnelle, mais ce n'était pas une recluse enfermée dans la maison. Elle n'exhibait pas son corps ; au contraire, lorsqu'elle sortait, elle le couvrait pour en garder toute sa valeur. Lorsqu'une hetaira était prise comme concubine (pallakê), elle perdait son ambivalence : elle devenait une « femme de l'intérieur », traitée comme une épouse et astreinte au même comportement. L'opposition hetaira / pornê a donc été mise en place en Grèce archaïque, pendant la période où les banquets aristocratiques constituaient « une anti-cité » avec ses propres règles et ses propres conventions. Alors que la cité adoptait le système monétaire, l'anti-cité aristocratique le refusait et entendait garder l'organisation de ses plaisirs hors du marché. Situer les échanges entre l'hetaira et ses hetairoi dans le champ du don et du contre don relèverait donc plus du politique que de l'économique. Selon le droit athénien, l'homme libre qui se prostituait (dans une relation homosexuelle, comme prostitué ou comme courtisan/amant) perdait la capacité d'exercer une fonction publique et de fréquenter les lieux publics (tout comme celui qui avait frappé ou négligé ses parents, celui qui n'avait pas pris part aux expéditions militaires ou avait jeté son bouclier, celui qui avait dévoré les biens de ses parents ou tout autre héritage), la violation de ces interdits étant punie de mort. La raison de ces règles se trouve dans le rôle social que jouait la pédérastie. On déduisait en outre de la prostitution d'un homme, l'engloutissement de son héritage, notamment par une insatiable soif des plaisirs et les dépenses que génère l'absence de maîtrise de soi. La passion de la bonne chair (opsophagia), des joueuses d'aulos, des courtisanes et du jeu, amène à accepter de s'installer chez son amant pour jouir de tout cela gratuitement et toucher un misthos, devenant de fait un courtisan hetairikos. Ce genre de citoyen était considéré comme un prostitué parce qu'il faisait commerce de son corps et comme un « efféminé » parce qu'il était insatiable dans sa quête des plaisirs. Ce qu'on lui reprochait n'était pas son comportement sexuel mais sa situation de dépendance vis-à-vis des amants chez lesquels il s'était installé, une situation qui était celle d'une femme vis-à-vis de son mari, entretenu par autrui parce que son corps ne lui appartenait plus et parce qu'il avait perdu toute liberté de parler et d'agir. Ainsi, la métamorphose d'un amant devenant homme après avoir été femme n'a rien de sexuel, elle est simplement dû à un changement de situation économique et de position sociale : après avoir été entretenu par un amant, le prostitué/courtisan devient à son tour suffisamment riche pour entretenir à son tour un amant. Mais un hetairikos citoyen qui impose à son amant des dépenses considérables dans la vie privée doit nécessairement le payer de retour dans la vie publique. Comme le « parasite » (le asumbolos, qui ne paye pas son écot) avec son « sponsor », l'hetairikos entretient avec son amant une relation de dépendance politique, ailleurs on dirait de clientèle. Cela aboutit dans tous les cas à la même conclusion : comme l'avait prévu le législateur, la prise de parole d'un débauché qui s'est vendu à ses amants ne peut rien apporter de bon à la communauté. Parallèlement à cela, la prostitution féminine n'était pas punie, car elle remplissait une fonction socialement utile (rempart contre l'adultère). L'offre et la vente des corps se déroulaient dans des lieux publics, rigoureusement séparés de l'espace privé de l'oikos (la maison) et considérés comme des zones de commercialisation, des espaces magiques qui transforment les humains en produits. C'étaient évidemment les rues de la cité où les épouses, « les femmes mariées selon les règles » et soucieuses de leur réputation, ne s'aventuraient que par nécessité et cachées sous un épais manteau. C'était là que déambulaient en revanche, s'offrant à tous les regards, des troupeaux de péripatéticiennes (prostituée qui arpente le trottoir, par allusion plaisante au verbe grec signifiant se promener, qui inspira les péripatéticiens, les partisans de la doctrine d'Aristote qui apprenaient en marchant et en regardant la vie autour d'eux) : gephuris (fille des ponts), dromas (coureuse), peripolas (vagabonde)... Les murs, les portes, les places et le port de la cité étaient particulièrement fréquentés. Il semble que le quartier du Céramique avec sa porte (le Dipylon), son cimetière et ses jardins était un haut lieu du commerce du sexe. Parmi les racoleuses de l'espace public, les auletrides, les joueuses d'aulos (une sorte de hautbois), étaient les moins chères et les plus méprisées même si certaines d'entre elles parvinrent à s'élever dans la hiérarchie de la prostitution. Elles pouvaient en effet être distinguées dans des « écoles de musique », sans doute sans grande qualité artistique, mais très prisées par un public masculin assidu. Les rues d'Athènes étaient dures : les bagarres pour se procurer une professionnelle étaient très fréquentes et les dîneurs se disputaient particulièrement les « musiciennes » indispensables à leur fête. Pour canaliser les pulsions naturelles des jeunes gens et protéger les femmes mariées, Solon (le grand démocrate) fit l'acquisition de femmes esclaves, les installa dans différents quartiers de la cité (près des remparts ou dans les quartiers populeux) pour les offrir à tout le monde dans le cadre d'établissements municipaux (même si très vite purent s'ouvrir des établissements privés, soumis à autorisation et redevables de taxes). Protégées par les autorités, les maisons publiques versaient en échange une redevance, le pornikon. Avec cette taxe, Solon fit construire un temple à Aphrodite Pandémos (l'Aphrodite commune à tous ; au-delà de ça, la prostitution sacrée était pratiquée auprès de certains temples et à leur profit), patronne des plaisirs tarifés. Pour que l'ordre public soit respecté, les astynomoi, les dix magistrats qui en étaient chargés, devaient veiller à l'application de la loi : les joueuses d'aulos et autres musiciennes ne devaient pas profiter de la compétition dont elles étaient l'objet pour faire monter les prix. En effet, le prix forfaitaire pour une nuit ne devait pas dépasser deux drachmes et si des hommes se disputaient la même professionnelle, cette dernière était tirée au sort sans être consultée. Celui qui payait plus était passible d'une eisangélie, une action judiciaire qui concernait les délits politiques. Dans une cité démocratique, le marché du sexe devait être ouvert à tous, sans distinction de fortune ! Ainsi, le bordel était un « lieu public » où se pratiquait légalement le commerce du sexe féminin. Le terme normal pour le désigner depuis Solon est ergasterion, atelier (non pas que du sexe, car il était aussi un atelier de filature et de tissage ce qui doublait sa rentabilité). Des hommes (et des femmes) sont quelquefois décrits comme « assis dans un oikêma », une stalle (siège de théâtre, mais aussi espace limité par des cloisons, notamment réservé à un cheval dans une écurie) individuelle dont la porte s'ouvre directement sur la rue, ce qui laisserait supposer qu'il s'agissait d'une institution légèrement différente de celle du bordel (mais que la porte soit modestement fermée ou ouverte pour un « show », la profession de l'occupant ne faisait pour le passant aucun doute). La forme la plus dépréciée de prostitution était celle que pratiquaient les femmes en se vendant au bord des routes ou dans les bordels. C'était notamment le cas des pornai, des prostituées de basse condition. Ce nom vient du verbe « vendre », car les prostituées étaient au départ des esclaves achetées sur le marché par des proxénètes femmes et installées dans de petites cellules qu'un simple rideau fermait pendant la passe. Pour autant, les esclaves pouvaient espérer (pour certaines d'entre elles, les plus belles et talentueuses) changer de statut, passer de la condition d'esclave à celle d'affranchie : c'était alors pour une prostituée accéder à la propriété, propriété de son corps, propriété de ses biens et propriété de ses enfants qu'elle pouvait désormais garder si elle le désirait. Comme en Grèce, la prostitution (du latin « prostituere » : mettre devant, exposer au public) était tolérée à Rome tout en faisant l'objet d'une réprobation sociale. Pour autant Caton l'Ancien (homme de la République pourtant réputé pour sa sévérité), disait à des mâles sortant du lupanar : « Bravo ! Courage ! C'est ici que les jeunes gens doivent descendre, plutôt que de pilonner les épouses des autres » (à Rome, les dicterions - lupanars - étaient considérés comme lieux d'asile et, par la suite, reconnus inviolables ; dans leur enceinte, les hommes mariés ne pouvaient y être accusés d'adultère, un père ne pouvait y chercher son fils pas plus que le créancier poursuivre son débiteur) ; de même, après la morosité du règne augustéen, les mœurs se libérèrent brutalement pendant les premières années du règne de Tibère et on vit même un sénatus-consulte de 19 se plaindre, entre autres « déviances », qu'aucune fille libre de moins de 20 ans n'avait le droit de se prostituer contre un salaire. La prostitution, très fréquente et totalement admise (rejetée certes, mais tolérée quand même) puisqu'aucun homme ne se cachait pour aller au bordel, était peu onéreuse. A Rome, les professionnels (femmes ou hommes) se rencontraient dans les lieux publics tels que les forums, les portiques, les théâtres, les auberges et bien sûr les lupanars (du mot « louve », le surnom des prostituées ; leurs chambres étaient ordinairement construites sous terre et voutées, fornix, d'où est dérivé le mot fornication). Les maisons closes étaient encadrées par l'Etat au nom de l'intérêt public (pour éviter que les jeunes gens ne se ruent sur les femmes mariées). Au-delà des créatures aussi vénales qu'affolantes qu'étaient les courtisanes de comédie, ou encore ces figures de « demi-mondaines » (que célébraient les poètes), sans parler des princesses impériales (comme Julie ou Messaline, dont les historiens anciens dénonçaient à plaisir les incartades sexuelles la nuit dans Rome), les hommes eux-mêmes étaient accusés de se prostituer comme César et son ami Mamurra dont Catulle prétend qu'ils disputaient leurs clients aux filles des rues. Toutes ces figures peuplent la Rome imaginaire de nos contemporains, dont ils font volontiers une société orgiaque et « décadente ». Toutefois, le mot de prostitution renvoie tantôt au commerce réel des corps tantôt à des pratiques sexuelles transgressives par rapport aux normes de la société romaine. Les rapports économiques à Rome, en effet, comme dans bien des sociétés traditionnelles, pouvaient relever soit du don et du contre-don, soit de l'échange marchand. Dans le premier cas les services sexuels étaient inclus à Rome dans des relations de clientèle (il s'agissait d'un officium, d'un « devoir », de l'affranchi(e) à son ancien maître), dans l'autre il s'agissait d'une véritable prostitution, d'un commerce monnayé. À cela s'ajoutait une autre situation économique : celle de l'esclave qui était une marchandise et dont le corps était à la disposition de son maître (les lois condamnant les maîtres qui prostituaient leurs esclaves étaient si peu efficaces qu'elles furent souvent reproclamées du Ier au IVè siècle). La prostitution ainsi définie (limitée aux seuls échanges marchands des corps) pouvait être le fait soit d'esclaves, loués par leur maître, soit d'affranchi(e)s, soit d'hommes et de femmes libres car nés libres (ceux que les Romains appellent ingenui), des ingénu(e)s qui vendaient leurs prestations sexuelles. En fait les seul(e)s prostitué(e)s dont le droit et la morale se souciaient étaient les ingénus, faisant commerce de leurs corps de façon ouverte et notable. En effet, d'une façon générale l'impudicitia volontaire et en particulier la prostitution, ne pouvait déshonorer qu'un homme ou une femme susceptibles d'être honorables, ce que n'étaient pas les affranchi(e)s. Finalement la prostitution au sens strict était à Rome quantitativement moins importante que dans nos sociétés égalitaires et démocratiques. Et elle n'était problématique que pour les prostitué(e)s ingénu(e)s. Puisque des corps serviles, ou affranchis, masculins et féminins étaient disponibles en grand nombre, aussi bien dans les demeures des hommes libres que dans les maisons de prostitution, comment se fait-il que des femmes nées libres aient renoncé à leurs privilèges et statut de matrones ? Comment se fait-il aussi que la société ait institutionnalisé ce renoncement en prévoyant d'enregistrer officiellement ces prostituées d'origine libre ? La réponse à cette question tient à la place et la nature des loisirs (otium) voluptueux dans la vie romaine et au coût des plaisirs qu'ils imposaient. C'est pourquoi penser la prostitution romaine doit se faire d'abord en termes de dépenses somptuaires. D'ailleurs les Romains ne censuraient jamais l'usage des prostitué(e)s proprement dit(e)s pour des raisons morales mais prétextaient toujours de raisons économiques : payer des prostitué(e)s menaçait les patrimoines comme toutes les autres dépenses en argent destinées aux plaisirs de l'otium (trop d'hommes libres donnèrent tous leurs biens à une courtisane au point que le droit interdit les legs en leurs directions). Malgré le blâme moral adressé aux prodigues excessifs, les dépenses destinées aux plaisirs de l'otium et en particulier l'argent payé aux prostitué(e)s étaient à Rome une nécessité culturelle, la culture du plaisir étant constitutive de l'otium. En effet, il était convenu au sein de la culture romaine que les jeunes hommes non mariés pouvaient et devaient s'adonner aux divers plaisirs associés au banquet : le vin, la bonne chair et les filles (ou les garçons). Ces plaisirs juvéniles n'avaient pas lieu, en général, dans la maison du père mais dans les maisons de prostitution à cause de leur caractère exceptionnel et excessif. Un ou une esclave assez joli(e) pour n'être qu'un objet de plaisirs coûtait trop cher pour être présent(e) dans de nombreuses maisons, et les multiplier menait à la ruine. C'est pourquoi la cité avait besoin de prostitué(e)s pour ses plaisirs. Ainsi à côté de la population servile toujours sexuellement disponible, les Romains faisaient appel à des prostitué(e)s libres afin de donner une dimension somptuaire, luxueuse, indispensable aux plaisirs raffinés qui constituait ce pôle indispensable de la vie civilisée qu'était l'otium urbanum, les loisirs de la ville. Les prostitué(e)s appartenaient donc à la population urbaine et étaient des composantes indispensables à la civilisation telle que la concevaient les Romains, au même titre que le vin, la musique, la cuisine, les parfums et tous les autres plaisirs du banquet. La prostitution était donc une pratique non pas sexuellement mais culturellement nécessaire à Rome. Le système symbolique de Rome servait à représenter l'érotisme des corps libres, féminins et masculins. Alors que la cité marquait d'infamie ces hommes et ces femmes nés libres se livrant à la prostitution (les privant du droit d'hériter aussi bien que de porter plainte pour viol ou insultes, créant ainsi une catégorie inférieure de citoyens), ils exerçaient une fonction précise. Ces « parias » de la société romaine, toujours « efféminés », servaient à marquer les marges de l'humanité civilisée dans la continuité, à définir les hommes, libres et adultes et donc « masculins », par ce qu'ils ne sont pas mais ce qu'ils pourraient par malheur être, devenir des « efféminés » ou leur équivalent, des prostituées libres. Les prostitué(e)s libres assumaient donc une fonction symbolique qui était d'être l'autre du soldat comme l'acteur est l'autre de l'orateur. Un épisode du mythe de Romulus et Rémus est associé à ce rituel : les jeunes Luperques reproduiraient les deux jumeaux, guerriers et bergers nomades, avant la fondation de la Ville, élevés sur un Palatin encore sauvage par une prostituée, lupa (Accia Laurentia, à qui la beauté de ses formes et la voracité de son appétit charnel avaient attiré cette qualification de la part de ses voisins), compagne d'un berger, après avoir été allaités bébés par une véritable lupa-louve. Le loup figure la vertu militaire, le corps sacré du jeune soldat, la louve incarne le corps prostitué de l'un ou l'autre sexe. Que la louve soit devenue l'animal emblématique de Rome montre comment était centrale la figure de la prostitution (féminine ou masculine indifféremment) à Rome : elle structurait l'espace féminin et urbain, en s'opposant à la matrone domestique, et l'espace masculin de la guerre en s'opposant au soldat (d'ailleurs, une fois par an, les femmes de la noblesse romaine étaient obligées de s'offrir au premier venu pour le prix qu'ils décidaient ; de même, bien que les filles publiques portaient une toge ouverte sur le devant et une mitre jaunes, couleur de la honte et de la folie, leurs chaussures étaient rouges jusqu'à ce qu'Adrien réservât cette dernière couleur aux seuls empereurs - sous l'aspect du pourpre, couleur très chère car issue du coquillage murex). L'empire byzantin, héritier de Rome, continua longtemps de tolérer les formes les plus visibles de prostitution (il faut rappeler que dans le domaine familial, l'usage oriental d'offrir les esclaves de la maison aux hôtes de passage était un gage d'hospitalité), puisqu'il existait même à Constantinople un théâtre appelé Pornas où l'on donnait des spectacles débridés. Ainsi, Théodora (508-548), élevée dans un porneion (une maison de prostitution) puis membre d'un groupe de comédiens légers, usa de ses charmes pour s'élever dans la société, obtenant même en 524 l'abrogation de la loi qui interdisait à un patricien de se marier avec une actrice (elle étant plus qu'à fond dans son rôle de courtisane ... d'infanterie). Elle devint ainsi la femme du futur empereur Justinien et influença alors la vie politique pendant plus de vingt ans, poussant son mari à diriger l'Etat d'une main de fer. Mais elle n'oublia pas son passé, car en matière de prostitution, son grand empereur de mari fut très innovateur. Il stipula en 531 dans son Corpus Juris Civilis que tous les proxénètes tels les souteneurs et les maquerelles (de macalrellus : dans les anciennes comédies à Rome, les proxénètes de la débauche portaient des habits bigarrés ; ce nom n'a été donné à l'un de nos poissons de mer - maquereau - que parce qu'il est bariolé de plusieurs couleurs sur le dos) seraient punies sévèrement s'ils étaient trouvés coupable de pratiquer ces métiers. Pour la première fois, une loi s'attaquait aux problèmes de la prostitution par ces racines. Par le fait même, les lois interdisant aux ex-prostituées de se marier furent également abolies. Mais ce code de loi ne faisait pas allusion aux prostituées elles-mêmes. En fait, cette loi visait essentiellement à faire sortir les prostituées des maisons closes. Afin de réussir son projet, il devait évidemment faire plus, c'est pourquoi il mit sur pied le premier centre de réadaptation sociale, nommé Metanoia qui voulait dire se repentir. Mais malgré ces efforts considérables, le programme fut un échec. De quoi confirmer la réputation de Byzance, cette cité du vice et de la perversion.
• Historienne : En 326, l'empereur (futur chrétien) Constantin se contenta d'édicter une loi qui spécifiait que les servantes de taverne pouvaient rendre certains services à leurs clients en toute légalité, sachant que la même prestation serait tenue pour un adultère si c'était la patronne qui l'assurait. Le premier empereur chrétien savait de quoi il parlait : sa mère, la future Sainte Hélène, avait été tenancière d'une gargote avant d'épouser le général Constance Chlore. Par contre, la prostitution masculine fut interdite vers le milieu du IIIè siècle, l'empereur chrétien Théodose le Grand établissant en 394 que les hommes se prostituant dans les bordels de la ville seraient brûlés vifs en place publique, puis au Vè siècle il ordonna d'envoyer en exil tous les pères, époux, ou maîtres qui prostituaient leurs filles, femmes ou esclaves, mais il n'a pas créé une véritable loi. Cette répression, étendue aux souteneurs, s'explique soit par l'extension du phénomène avec la chute de l'empire romain soit sous l'influence du christianisme. Toutefois, en 438, le code de l'empereur Théodose II entérina l'existence légale des prostituées et de leurs souteneurs. Par la suite, la tradition chrétienne considéra la prostitution comme un moindre mal. Les Pères de l'Église en témoignent, tel Augustin d'Hippone au IVè siècle qui estimait qu'elle était naturelle et permettait de protéger les femmes honorables et les jeunes filles du désir des hommes. La prostitution était d'ailleurs jugée tellement naturelle que, pour plusieurs théologiens, il était préférable qu'une femme y pousse son mari plutôt que de consentir à certains rapports sexuels considérés, eux, comme de graves péchés. En effet, virulente à l'égard des proxénètes, l'Eglise était beaucoup plus hésitante vis-à-vis des prostituées car si la Bible évoque à plusieurs reprises les « femmes de mauvaise vie », celles-ci ne sont pas dépeintes en termes uniquement négatifs. Si Saint Paul s'est formellement élevé contre leur fréquentation, Salomon rendit ouvertement hommage au cœur de mère des deux courtisanes venues vers lui pour trancher une complexe affaire de fils nouveau-né, et Jésus salua la foi de Marie-Madeleine venue lui laver les pieds de ses larmes et les essuyer de ses cheveux (elle était sa meilleure amie, ils s'embrassaient sur la bouche, elle l'accompagna jusqu'à la croix, fut la première à vouloir l'embaumer au matin et elle vit donc la première le Ressuscité). Entre l'impureté méprisée de leur métier et les hautes compétences symboliques qui vont avec, il y avait toujours cette ambivalence, base du principe même du statut de ces femmes : elles étaient à la fois exclues, vouées à l'errance surveillée et à la clandestinité, et parfaitement insérées dans l'économie générale de la sexualité et des échanges, autant comme une ressource pour les cités que pour l'accompagnement obligé des cours et des armées. Cette contradiction essentielle qui les définit a été en quelque sorte traduite dans l'espace avec les projets de cantonnements de leurs activités sur les bords de la ville (d'où le terme de bordel) et dans des quartiers réservés. Autant de mesures qui concrétisent leur dualité sociale. En conséquence, tout en réprouvant la profession, les évêques hésitaient à condamner les femmes qui la pratiquaient, autorisant au IVè siècle les prostituées à recevoir le baptême (les hauts fonctionnaires de l'empire romain n'avaient pas le droit de le demander car ils faisaient usage de la peine de mort), n'invitant les miséreuses qui se vendaient par nécessité qu'à jeûner quelques semaines pour expier leur péché là où les femmes aisées qui trompaient leur mari par concupiscences étaient soumises à une dure discipline. Pour éviter que les veuves et les orphelines n'en vinrent à ces tristes extrémités, les évêques et les pieuses aristocrates donnèrent des pensions ou fondèrent des institutions.
• Animateur : Devenus maîtres de terres en voie de christianisation, quelle fut l'attitude des Barbares face à ce phénomène sociétal ?
• Historienne : Dans les sociétés germaniques, le mariage permet d'apaiser les tensions entre clans. Afin de ne pas insulter leur épouse, mais surtout leur belle-famille, les hommes évitaient donc les « mauvaises fréquentations » (au risque que sa belle-famille se venge, les armes à la main), sauf qu'ils avaient aussi des concubines. Ainsi, les Vandales, venus de la région du Rhin moyen, qui parvinrent en Afrique et s'emparèrent de Carthage en 440, découvrirent avec stupeur une ville où chaque rue comptait au moins un lupanar. Horrifiés, ils interdirent immédiatement la prostitution et condamnèrent les prostituées à se marier. Pour rappel, selon la loi salique, l'homme qui traitait une femme libre de prostituée devait payer une amende de 1800 deniers, là où le meurtre d'un esclave ne coûtait que 1200 deniers. Pour ces tribus, la prostitution représentait une malédiction à combattre. Théodoric Ier fut le premier à user de violence dans ce domaine. En effet, il parait que les proxénètes étaient jugés très sévèrement, car ils étaient passibles de la peine de mort pour avoir commis un tel crime. En 506, le roi wisigoth Alaric II proposa à ses sujets une nouvelle édition du code théodosien, modifiant le texte de façon à éliminer toute loi autorisant la prostitution. En effet, ce code prévoyait pour la première fois que les femmes de petites vertus étaient aussi coupable que les proxénètes et qu'elles étaient justiciables du fouet. Mais face à cette pudeur des barbares, on ne doit pas cacher la situation d'un monde où la prostitution restait largement pratiquée. Toutefois, la double influence du christianisme et de la législation germanique contribua à faire lentement évoluer les esprits : pour convaincre les paysans d'abandonner leurs cultes païens, des prédicateurs leur expliquaient que leurs déesses étaient jadis de simple prostituée et à ce titre digne du plans grand mépris. La figure de la femme vénale devint alors un repoussoir culturel absolu, même si à partir du VIè siècle des clercs traduisirent des textes grecs démontrant que des prostituées peuvent même prétendre à la sainteté, elles qui peuvent pécher longtemps à de nombreuses reprises et pourtant être pardonnées lorsqu'elles finissent par se repentir. Mais c'est bien à l'époque carolingienne (avec le rêve carolingien de Rénovation de l'Empire Romain) que l'on voit apparaître le souci d'améliorer la société, à la lecture d'Augustin, et donc les premières lois interdisant explicitement l'amour tarifé. Les réformateurs de ce temps entamèrent une sorte de longue marche vers la cité de Dieu qu'ils entendaient réaliser sur terre. Leur combat avait pour champ principal l'union des sexes, et il devait reléguer aux marges de la société un pouvoir féminin jusque là dominant dans les groupes claniques païens (les gentilices : groupes de familles portant un nom en commun) absorbés par l'Empire déchu, le but étant d'assurer l'alliance d'un groupe de clercs réformateurs et d'une noblesse germano-chrétienne. Malgré le fait que tous les chefs francs avaient des harems byzantins (ou des gynécées grecques où y vivaient leurs concubines), la prostitution pour le commun des mortels n'était aucunement tolérée. Pour autant, lorsque Louis le Pieux succéda à Charlemagne en 814, sa première mesure fut de chasser toutes les prostituées du palais, qu'elles avaient investi pendant les dernières années du règne du vieil empereur. En 820, il édicta un capitulaire précisant que « tout homme chez qui des prostituées auraient été trouvées devra les porter jusqu'à la place du marché où elles seraient fouettées et, en cas de refus de sa part, il sera fouetté avec elles ». En fait, les prostituées étaient perçues comme de très graves criminels, passibles de 300 coups de fouets, soit le nombre de coups de fouets le plus élevé mentionnés dans le « Code Alaric », en plus de voir leur chevelure coupée. L'humiliation publique des souteneurs semblait alors la meilleure façon de lutter contre le phénomène. En cas de récidive, la loi était intransigeante, et la criminelle était vendue au marché des esclaves. Malgré de telles mesures, Louis le Pieux n'a pu enrayer la prostitution, même si pendant cette époque la prostitution était un phénomène rare étant donné que la société franque était majoritairement rurale, et que la prostitution est un phénomène essentiellement urbain (toutefois, des sœurs vivant au couvent avaient été trouvées coupables de se livrer à de telles activités pour augmenter leur revenus). La législation carolingienne n'a sans doute pas été appliquée, mais elle a contribué à faire des prostituées des exclues, privées de protection légale. Au IXè siècle, la liste des péchés commença à gagner en sévérité et les prostituées furent traitées à l'égal des femmes adultères et soumises à trois ans de pénitence. Cherchant une nouvelle Eve, qui aurait également commis la faute mais qui aurait été pardonnée, les théologiens précisèrent le personnage de Marie-Madeleine (dont les Evangiles ne disent que peu de choses, sinon qu'elle a été libérée des sept démons) sous les traits d'une prostituée : la pécheresse repentie, vêtue de ses seuls cheveux, devint ainsi une figure majeure en Occident (Adam et Eve avaient provoqué la chute, Jésus et Marie-Madeleine en couple - comme compagnons de route - prodiguaient le salut). Pour autant, sans vouloir éradiquer la prostitution, le haut Moyen-âge contribua à la confiner dans la sphère de la marginalité, de l'illégalité, du secret. Dans les années 850, l'archevêque de Reims (menant une enquête sur la moralité des prêtres de sa paroisse) découvrit l'existence de demeures particulières avec de petites portes suspectes situées près des églises. Les prostituées avaient toujours été socialement dévalorisées, mais l'homme de l'Antiquité pouvait les fréquenter sans craindre pour sa réputation. Vers l'an mil, le client, honteux et inquiet, préférait cultiver le secret. En se fermant aux yeux du monde, le lupanar devint une maison close !
• Animateur : Oui, mais justement, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que cela n'existe pas/plus !
• Historienne : En effet ! Si les hommes qui s'élançaient à la conquête de Jérusalem à la fin du XIè siècle se présentaient avant tout comme des pèlerins accomplissant une pénitence, entre deux combats, ils succombaient facilement aux plaisirs sexuels, ne pouvant garder leur chasteté virginale dans ces parties d'Orient chaudes et stimulant la chair, bien que les prédicateurs (qui diffusaient la réforme géorgienne) rappelaient aux fidèles combien le péché de la chair offense le regard de Dieu. Ainsi, même si des milliers d'épouses ont suivi leurs maris, il existait des bordels en activité dans les camps, qui seront fermés afin de plaire à Dieu et attirer ses bonnes grâces (nécessaires pour la victoire vu l'infériorité numérique des chrétiens), révélant au passage leur existence, soigneusement tue jusque-là. De nombreux soldats, mais aussi des moins, et leurs ribaudes, furent promenés nus et fouettés en public, châtiment de l'adultère également appliqué à l'encontre des hommes surpris au bordel. Un siècle plus tard, malgré l'injonction du pape Clément III (1187-1191) que les expéditions ne comportent aucune femme, à l'exception des lavandières au-dessus de tout soupçon (ses femmes indispensables aux armées en route ayant bien souvent plusieurs cordes à leur arc), les conseils pontificaux ne furent pas écoutés et de très nombreuses femmes suivirent, tant pour se battre pour leur foi que pour rendre heureux en amour les malheureux aux combats. On pourrait penser que l'Orient luxurieux des harems méprisait la basse prostitution occidentale (pour autant, les villes musulmanes étaient au cœur d'un échange humain incessant, aussi, elles étaient structurées pour accueillir des gens en quête de plaisir éphémère et passager), mais il n'en était rien, surtout après avoir eu écho des excès de ces dévergondées de fesses-pâles. Notamment, les Mamelouks (esclaves militaires turcs asservis par les Arabes) n'hésitèrent pas à désarmer et déserter, voire à renier l'islam, pour goûter les plaisirs de la chair chez les chrétiens ; d'autres, conciliant mieux l'aiguillon du désir et celui de la religion, opéraient de nuit des razzias et capturaient de belles filles publiques. Toujours est-il que lorsque le nouvel évêque de Saint-Jean-d'Acre arriva à son poste en 1216, il découvrit avec horreur une nouvelle Babylone, où les courtisanes abondaient, payant des loyers élevés tant à des laïques qu'à des prêtres et moines. Plus tard, Saint Louis menant la septième croisade en 1248 et étant très pieux, aucune folle femme ne partit avec l'expédition. Mais sitôt qu'il fut emprisonné, des navires occidentaux ravitaillèrent les camps, des bordels fleurissant dans toutes les villes conquises. Les ribaudes courant après les croisés faisaient quelque peu désordre dans la quête du paradis en Terre sainte, mais là encore, la sagesse des Trois Singes (ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire) a fait son office, le repos du très chrétien guerrier valant bien une escort-girl, même vilipendée par la « sainte » Eglise. Pour autant, cet ordre moral que le roi cherchait à imposer en Orient, il l'appliqua également à son propre royaume par une série d'ordonnances, restées sans effet ! Ainsi, dans la cité des papes même on disait qu'on ne pouvait traverser le fameux pont sans rencontrer deux moines, deux ânes et deux putains. Les filles de joie, fillettes de vie, folles femmes, satisfaisaient un besoin social que les législations royales, princières et municipales n'ont jamais pu abolir, les tentatives répétées de Louis IX s'étant soldées par un échec. L'ordonnance de 1254 décréta l'expulsion des femmes de mauvaise vie de toutes les villes du royaume, bannies, se voyant confisquer tous leurs biens (jusqu'à leurs vêtements), mais suite à cette dure répression, la prostitution clandestine remplaça les maisons de débauches ouvertes à tous. Les hommes s'en plaignants furent nombreux, argumentant que depuis la publication de l'édit, il était difficile pour eux de protéger la vertu de leurs femmes et de leurs filles contre les assauts de violence que canalisaient autrefois les bordels (il n'est d'ailleurs pas anodin que deux femmes furent entourées de vénération à cette époque : Marie, mère de Jésus d'une part, et d'autre part les trois personnages féminins du récit évangélique alors confondus sous le nom de Marie-Madeleine ; la putain publique au secours de la vierge domestique). Sa décision ayant eu du mal à être appliquée strictement, les ordonnances suivantes furent relativement plus tolérantes. Ce trouvant devant l'échec cinglant de sa politique intransigeante, il décida d'ouvrir un centre de réadaptation et de reclassement, le « Couvent des filles-Dieu », poursuivie sous le règne de Charles V. En 1256, l'expulsion des « folles de leurs corps et autres fillettes communes » fut à nouveau décrétée, mais une clause précisa qu'il s'agissait surtout de les chasser des quartiers bourgeois, des églises, couvents et cimetières, pour les repousser « hors les murs », les mettre au ban de la société, en banlieue. Les échecs de cette prohibition révèlent un nouveau regard social porté sur la prostitution, un nouveau décret ayant rétabli la prostitution, à condition que différentes règles soient suivies. Etant donné que Paris (ville septentrionale) n'avait pas intégré, comme les villes méridionales, la prostitution dans ses institutions urbaines, Saint Louis accorda comme privilège aux pauvres lingères de Paris d'établir leurs étals près du cimetière des Innocents, face aux murs des Halles, moyen de restreindre la prostitution puisqu'une lingère honnête ne pouvait qu'être très pauvre (un surcroît de ressources ne pouvait être que le « fruit d'un commerce honteux et condamnable »). Que la prostitution, liée à l'insuffisance des ressources, se soit développée avec les crises est certain, ce qui a sans doute alimenté une constante suspicion à l'égard du travail des femmes : l'atelier et la boutique tenus par des femmes serviraient de façade à un commerce moins honorable (un texte de 1420 mentionne que les maquerelles « tiennent des échoppes de denrées et de métier », ce qui leur permettait d'accueillir jour et nuit une clientèle spéciale). De la fin du XIIIè au XVè siècle, les autorités admirent que cette pratique, profondément ancrée dans la société, était impossible à éradiquer : bien que la prostitution fût l'objet d'une réprobation générale, les fillettes trouvaient leur place dans la communauté (mais tout de même maintenues dans des quartiers spécifiques de la ville). Cette attitude de relâchement, que de nombreux politiciens préconisaient également, montre que la prostitution ne scandalisait pas la population en général. Alors que jusqu'au XIIè siècle l'Eglise condamnait strictement la fornication, c'est-à-dire tout forme de sexualité en-dehors du mariage, dès la fin du XIIIè siècle la morale s'accorda davantage à la réalité et reconnut les besoins sexuels des jeunes hommes. L'affirmation de la virilité entraînant fréquemment un déchaînement de violence et se traduisant par des viols collectifs commis sur des femmes isolées ou faibles, réputées communes, les autorités encouragèrent l'essor d'une prostitution officielle. Ainsi, à la fin du Moyen-âge, la prostitution apparut aux yeux de certains notables comme une thérapie sociale, voire une pédagogie de la bonne conjugalité (Thomas d'Aquin au XIIIè siècle jugeait qu'elle était nécessaire à la société comme les toilettes à une maison : « cela sent mauvais, mais sans elle(s), c'est partout dans la maison que cela sentirait mauvais »). Les filles publiques se dressèrent alors en gardiennes de la moralité (bien qu'une femme s'étant adonnée à de tels actes devait se soumettre à une pénitence de six années, alors que son partenaire ne devait jeûner que pendant dix jours) : chargées de défendre l'ordre collectif, elles luttaient contre l'adultère et juraient de dénoncer les contrevenants aux commandements du mariage, se montrant des plus actives dans la chasse aux filles secrètes et aux épouses dépravées, qu'elles menaient au tribunal ! Partant donc du postulat que les lupanars représentent un dérivatif à la violence sexuelle, les autorités au pire toléraient la prostitution, au mieux l'organisaient. Étant donné que le Grand Conseil de 1358 avait mentionné que « les pécheresses sont absolument nécessaires à la Terra », on assista à un effort d'institutionnalisation de la prostitution visant à tirer profit de ce commerce, mais surtout de le restreindre à certaines zones de la ville. A Paris, ces lieux restaient stables et correspondaient à ceux définis par Saint Louis. Une ordonnance de 1367 du prévôt Hugues Aubriot fixa d'ailleurs les rues où les ribaudes pouvaient exercer. Pourtant, en 1387, un procès se déroula au Parlement afin d'en chasser les prostituées, mais en vain, car les sentences reconnurent que « de tous temps » il y avait eu « femmes de vie ». A la Court-Robert, le prince Louis d'Anjou, agacé par ce mauvais voisinage, tenta lui aussi de chasser les pécheresses. Mais même racoler aux porches des églises n'effrayait pas les filles de vie, comme le prouve la liste des délinquants appréhendés par les marguilliers et les sergents du chapitre de Notre-Dame. Sur l'île de la Cité (celle de Notre-Dame justement), la rue de Glatigny resta le cœur de la prostitution parisienne, le fameux Val d'amour, fermé plus tard par François Ier. Au cœur des cités méridionales, les maisons de fillettes, les châteaux gaillards et autres maisons lupanardes devinrent des institutions municipales, entretenues et inspectées par les consuls, tandis qu'au Nord, plus méfiantes, les villes cantonnaient dans quelques rues les mères maquerelles et leurs pensionnaires. Pour les grandes villes telles que Lyon ou Arles, vu les besoins de la population, un quartier entier fut affecté à cette activité. Les filles communes « gagnaient leur aventure » sur les places, dans les rues et les tavernes des quartiers autorisés, mais elles devaient obligatoirement ramener le client dans le prostibulum publicum pour la passe. Edifiés avec les deniers publics, ces institutions étaient baillées à ferme à un tenancier (souvent une femme, surnommée l'abbesse), détenteur officiel d'un monopole, chargé du recrutement des futures besogneuses et du strict respect des règles intérieures (interdiction du blasphème et des jeux). Essentiel à la bonne renommée de la maison, le tenancier servait aussi d'agent de renseignement, très utile aux autorités. A la fin du XVè siècle, la figure féminine de l'abbesse (souvent fille commune ou ancienne prostituée reconvertie en honnête épouse) disparut au profit d'officiers de justice qui reprirent la direction. Les pouvoirs publics ne parvinrent pourtant pas à interdire les autres formes de prostitution, leurs institutions affrontant une intense concurrence : les tavernes, hôtels, bordes et étuves privées offraient une prostitution notoire et, de fait, souvent tolérée. Les étuves notamment constituaient des lieux de débauches célèbres, mais tous les bains publics ne pouvaient arborer l'enseigne de la luxure et du stupre, des règlements contraignants interdisant l'accueil des prostituées et précisant systématiquement les jours et heures réservés à chaque sexe. Finalement, la marge entre prostitution tolérée et prostitution prohibée était assez floue, les municipalités (ainsi que les religieux grâce aux loyers, à condition que les filles exercent par nécessité et non par vice et plaisir) profitant de ce commerce et s'enrichissant en prélevant des taxes sur les maisons publics ou en mettant les fillettes à l'amende. Mais il existait également des prostituées entretenues au sein même des palais royaux et princiers (recrutées par le roi des ribauds, un officier chargé de maintenir l'ordre au sein de ces palais, ou de surveiller les marginaux d'une ville), à disposition des puissants, locaux ou de passage. A l'image des princes, certains bourgeois souhaitèrent également entretenir pour leur confort quelques prostituées : Charles V puis Charles VI accordèrent ainsi aux puissants banquiers lombards le droit d'entretenir à domicile quelques femmes. A la campagne, les filles allaient de village en village en fonction des marchés, moissons ou vendanges. Seule l'enseigne permettait d'identifier la maison de passe, mais dans les rues les prostituées devaient rester tête nue, à une époque où il était impensable de sortir sans une coiffe. De fait, à la fin du Moyen-âge, la prostitution eut droit de cité : acceptée et légalisée, elle devint même une profession à part entière et toutes les grandes villes possédaient leur quartier réservé à cet effet. La borde (désignant une cabane de planches en ancien français) devint le bordel (ou bordeau), et prit le sens de lieu de débauche au Moyen-âge, les prostituées n'ayant alors le droit d'exercer leur activité que dans des cabanes, à l'écart des lieux habités. D'ailleurs, en langue d'oc, Bordeaux et bordel est un seul et même mot, bordèu, signifiant une maison isolée. Même si le nom Bordeaux provient du nom latin de la ville (Burdigala), étant donné que son port s'est développé du fait du vin mais surtout par la traite des noirs (plaque tournante la plus importante pour le commerce des esclaves), la ville était bien la capitale de la débauche par le vin et l'exploitation humaine (sachant que les marins trouvaient dans tout port bon nombre de prostituées pour leur faire traverser d'autres tourmentes que celles maritimes).