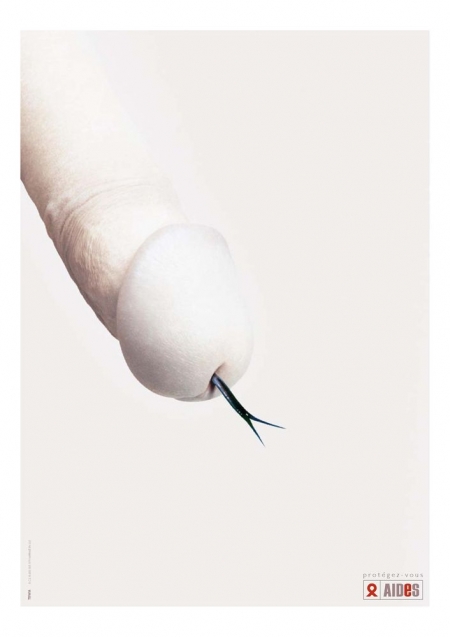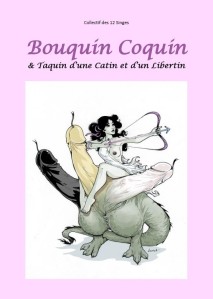 Bienvenue aux mateurs de tous poils ! Ceci est le blog dédié à notre troisième livre autoédité,
Bienvenue aux mateurs de tous poils ! Ceci est le blog dédié à notre troisième livre autoédité,
« Bouquin Coquin et Taquin d’une Catin et d’un Libertin »
(pour nous soutenir en commandant, c'est ici !!!).
Après « Lendemain du Grand Soir », « La philo south-parkoise, ça troue le cul !!! », voici notre essai érotique et réflexif sur la place et l’impact de la sexualité sur nos vies sociales et sentimentales, utilisant des vocabulaires thématiques « neutres » (nature, sports mécaniques, gastronomie, végétaux, sports, musique, drogues) détournés de leur contexte et sens originel pour visualiser des scènes érotiques (l’œuvre reste érotique-chic plutôt que porno-crado !).
Parallèlement à cela, nous avançons sur « Une histoire d’Homo Sexualis » : émergence biologique puis évolution comportementale du sexe, la sexualité chez les autres animaux ainsi que dans notre vaste groupe de primates, puis chez les différents Homo qui se sont succédés jusqu'à nous (même dans l'art préhistorique, constellé de triangles pubiens et de phallus), la vision mythologique du sexe et de la sexualité, la prostitution dans la civilisation.
Catégories
- Bouquin Coquin & Taquin ... (24)
- La prostitution à travers les âges (8)
- La contraception à travers les âges (2)
- La naissance de la sexualité biologique (1)
- La sexualité chez les autres animaux (1)
- La sexualité de la famille primates / Homos (1)
- La sexualité de nos ancêtres deux fois "sages" (5)
- La sexualité dans la civilisation et ses mythes (5)
Recherche
Derniers articles
- Histoire du sexe filmé
- ANNIV' des 5 ans du Collectif des 12 Singes : PROMO à pas chère jusqu'à Noël
- ** COMMANDER ** « Bouquin Coquin et Taquin d'une Catin et d'un Libertin »
- Chapitre 0 : L'innocence de l'enfance face à la montée du besoin/envie de jouissance
- Introduction de Bouquin Coquin et Taquin d'une Catin et d'un Libertin
- Chapitre 1b : Le boum-boum zen dans sa Benz
- Chapitre 1a : Contons fleurette à la belle des champs
- Chap 10b : Plus on est de fous plus on jouit
- Chap 8 : Les Amazones démontent Jésus
- Chap 5 : Heureusement qu'il y a l'Amour, enfin ... !!! / ???
Publications en direct liv(r)e
Liens
- Groupe facebook dédié à Bouquin Coquin
- Blog du Collectif des 12 Singes (et Bonobos)
- Suivi de nos publications en direct liv(r)e
- Une jolie histoire de libertinage : découvrir, pas à pas, les débuts d'un jeune couple dans sa quête du plaisir
- Histoire erotique gratuite (blog pour rendre le pouvoir aux mots)
• Historienne : La prostitution n'est pas « le plus vieux métier du monde » ! Elle n'a pas été présente, loin s'en faut, dans toutes les sociétés humaines (tout comme elle n'est pas intemporelle, car elle a même disparu lors de moments historiques révolutionnaires ou dans certains modes de vie communautaires qui ne réprimaient pas la sexualité). Dans les sociétés protohistoriques comme dans les sociétés primitives et les sociétés traditionnelles, la prostitution n'existait pas. En effet, la liberté des échanges sexuels, encore pratiquée dans certains groupes ethniques, montre que l'idée même de prostitution est restée étrangère à de nombreuses populations. Jusque dans son plaisir solitaire, le plaisir de l'individu des sociétés anciennes ne pouvait jamais être le plaisir d'un individu unique, puisque l'individu n'existait que dans son rapport à la communauté humaine. Cependant, avec la naissance des premières formes organisées de spiritualité, il pouvait déjà exister des femmes « maraboutes » vivant dans des demeures qui regroupaient des filles spirituelles et se livrant à l'exercice de la prostitution sacrée (parfois même toutes les femmes d'une tribu étaient concernées par cette pratique qui apparaît alors comme une survivance de rites d'initiation sexuelle). Dès la période historique, la prostitution exista, sous forme de prostitution sacrée puis de service sexuel vénal (certains pensent d'ailleurs que c'est la naissance du mariage institutionnalisé par l'état et la religion, à la place des alliances matrimoniales claniques, qui a incité le phénomène de prostitution, l'amour collectivisé ou tarifé permettant d'échapper au couple à visée essentiellement patrimoniale/propriétaire). Avec la formation des Etats-empires mésopotamiens, c'est-à-dire avec la mise en mouvement de la valeur comme puissance autonomisée par la domination d'une classe des maîtres sur une classe populaire, le plaisir était lié à la puissance de l'Etat et aux manifestations de cette puissance dans les cérémonies publiques et les réjouissances collectives à la gloire de l'aristocratie. La prostitution sacrée était, à l'origine, liée aux cultes de la fécondité, le point de départ étant à la fois religieux et familial : les cultes de la déesse-amante, présents dans toutes les sociétés anciennes, avaient pour rite essentiel l'union sexuelle des hommes avec des prostituées sacrées. Au départ, seuls les prêtresses et les prêtres de la divinité devaient s'accoupler, afin de provoquer la fertilité des terres et l'abondance du gibier, mais rapidement des groupes de femmes et d'hommes liés aux sanctuaires apparurent et s'unissaient aux prêtresses et aux prêtres, puis aux fidèles, afin de ressourcer la force génitale des fidèles masculins et pour que cette force étende ses effets positifs à la fertilité des troupeaux et des sols. Les premières femmes à avoir été consacrées à la prostitution sacrée pour honorer la déesse de la fertilité, Inanna à Sumer, devenue Ishtar pour les Babyloniens, étaient les femmes stériles ; ne pouvant assurer la procréation au sein d'une famille avec un seul homme, elles trouvaient une place dans la société en servant la déesse, devenant les épouses de tous. De même, les prostitués masculins apparaissent avoir été à l'origine ceux qui, par malformation naturelle ou par accident, ne pouvaient pas davantage assurer la continuité de l'espèce ; eux aussi trouvaient ainsi, au service de la déesse, une place dans la société (ayant également un rôle dans les liturgies publiques et privées d'Inanna et Doumouzi - son compagnon berger, image du roi avec son troupeau de fidèles -, mais cette prostitution semble avoir eu un caractère plus marginal et plus sordide). En Mésopotamie, les prostituées étaient nombreuses et leurs appellations diverses indiquaient leur allégeance à un dieu ou leur spécialité. Elles étaient attachées à l'un ou l'autre temple et y exerçaient leur art au bénéfice de la divinité qui les rétribuait. Il existait ainsi une homologie entre l'actrice rituelle et la prostituée qui, en l'occurrence, concilie l'impureté méprisée de son métier et les hautes compétences symboliques qui vont avec, la pauvreté de ces compétences culturelles et les pouvoirs qu'elle est capable de conquérir. C'est en tant que telles que les prostituées sacrées se trouvaient en affinité avec les vierges et les dieux, personnages transitifs, entre deux états, entre deux mondes, et susceptibles à ce titre d'assurer des médiations spécifiques. En effet, la vierge a une position neutre, hors du commerce sexuel donc asexuée en quelque façon, qui en fait une médiatrice religieuse centrale dans un monde social où la séparation des rôles masculins et féminins était très rigide. En jouant la vierge, la prostituée sacrée faisait sans doute écho à cette homologie et, en même temps, comme elle donnait corps à un être double (la putain vierge) elle en dévoilait le principe, le ferment : la vierge comme la prostituée nie les valeurs du groupe tout en les fondant (la fécondité pour l'une, la pureté pour l'autre). La prostituée sacrée était ainsi une médiatrice capable de veiller sur des passages, de capter et détourner vers le groupe social des influences cosmiques. Le noyau de l'action rituelle consistait alors à traverser les frontières et singulièrement la moins perceptible et la plus décisive, celle qui sépare les mondes visible et invisible : le fait de se dénuder, emblématique s'il en est du métier de prostituée, prenait le sens d'un dédoublement, d'un passage dans l'au-delà et d'une substitution avec l'entité invoquée. Sortir de son corps, à l'instant du rite et aussi en rêve, permettait à l'officiante d'assurer le lien entre des espaces et des êtres distincts et séparés. « Curatives », ces « femmes sans hommes » avaient un statut ambigu dans la mesure où elles oscillaient entre les catégories du féminin et du masculin, de l'humain et du divin, de l'impur et du pur : elles visaient à obtenir un bénéfice immédiat au moyen de rituels, lesquels, par les chants, la musique et la danse, permettaient de communiquer avec les dieux. Ces bayadères (femmes dont la profession était de danser devant les temples en Inde) étaient ainsi consacrées autant au culte des dieux qu'à la volupté des croyants, l'un nourrissant l'autre. Le Code d'Hammourabi, notamment la loi 181, citait une hiérarchie des prostituées sacrées sans faire ouvertement référence à une rémunération par les fidèles. Mais, très vite, on voit que les offrandes aux dieux furent remplacées par le paiement de ces personnes, et, en beaucoup de lieux, la prostitution du personnel religieux servit à alimenter le trésor du sanctuaire. Concrètement, des fonctionnaires de certains temples géraient des maisons de prostitution, et la déesse Inanna possédait ainsi des cabarets, des débits de boisson et des lupanars : « Sise à la porte du cabaret, je suis la prostituée experte du pénis ! ». Se détachant peu à peu de sa fonction religieuse (la « prostituée sacrée » comme vestale - prêtresse dédiée à Vesta, déesse du foyer à Rome, continuatrice d'une très ancienne tradition, le maintien du feu commun perpétuellement allumé, sauf qu'elle devait rester vierge, car en cas de relations sexuelles sacrilèges, un crime qualifié d'incestus, la vestale était enterrée vivante ou brûlée vive - et comme exorciste de la menace que les femmes faisaient peser sur la communauté abstraite de la religion), elle apparaît comme « marché » dans les sociétés où l'État, aux mains d'une classe sociale dominante (une aristocratie, une oligarchie, une théocratie), exerce sa puissance et sa tutelle sur le reste de la société. Il faut que le rapport marchand urbain se soit autonomisé comme espace d'échange de valeur pour que « le commerce » sexuel s'y rattache. Les empires-États mésopotamiens, non seulement permirent, mais établirent la prostitution comme catalyseur d'urbanisation et opérateur de la circulation de la valeur (à la place du système économique clanique basé sur le don et le contre-don, on instaura par ce biais la notion d'échange marchand propice aux sociétés étatiques). La prostitution devint une affaire d'argent et l'on quitta le domaine du « sacré ». Ces comportements se monnayaient : les sanctuaires s'enrichissaient des sommes payées par les fidèles désirant accomplir le rite, de même que les chefs de famille rentabilisaient le prêt des femmes qui étaient leur propriété. Les responsables des États, à Babylone comme dans tout le Moyen-Orient, ne laissèrent pas échapper cette source de revenus, et se mirent à créer leurs propres maisons de prostitution. Les prostituées se multiplièrent autour des temples, dans les rues et dans les tavernes. Ainsi, Ourouk, la ville d'Inanna, était renommée aussi bien pour les diverses catégories de femmes dont les activités étaient partiellement ou intégralement vouées à la prostitution que pour les diverses variétés d'invertis et de travestis, les deux associées ès qualités aux cultes locaux. Nanaya, autre déesse d'Ourouk, était clairement associée à l'érotisme et à la sexualité tarifée : « Si je suis droite contre le mur, c'est un sicle ; si je me penche, c'est un sicle et demi ». Toutefois, il ne manquait pas de péripatéticiennes qui travaillaient en indépendantes dans les rues, le long des quais ou à l'ombre des murailles. Les prostitué(e)s avaient en commun avec les humains consacrés aux dieux qu'ils échappaient au cadre familial et à ses règles sexuelles, mais le mariage ne leur était pas interdit, même si c'était une union que désapprouvait l' « homme sage » (il déconseillait d'ailleurs tout autant tout mariage avec une femme rencontrée lors de fêtes et spécialement parée à cette occasion). Pourtant, l'importance sociale et le rôle positif de la prostitution apparaissent bien dans l'Epopée de Gilgamesh où une femme, appelée « Epanouie », séduisit Enkidou, et, de brute sauvage qu'il était, en fit un homme ! Enkidou, à l'approche de la mort, maudit la prostituée qui l'avait arraché à l'innocence de sa vie première, puis, prenant en compte le bien qu'elle lui avait somme toute apporté, revint sur sa malédiction. Pour la Bible, les femmes mésopotamiennes aux mœurs dévoyées et les despotes efféminés étaient la négation même de la différence entre les sexes et donc la négation de la société et de la civilisation. Les fondateurs de la religion hébraïque voulurent rejeter le culte des idoles qui se manifestait, notamment, par la prostitution sacrée : ils furent donc amenés à proscrire toute prostitution sacrée pour les « filles d'Israël ». Mais les textes montrent le peu d'efficacité des interdictions car des prostitués, hommes et femmes, liés au Temple, sont évoqués de multiples fois, à propos du fils de Salomon ou du roi Josias, par exemple (le roi Josias, vers -630 « ordonna de retirer du sanctuaire de Yahvé tous les objets de culte qui avaient été faits pour Baal, pour Ashéra et pour toute l'armé du ciel. Il démolit la demeure des prostituées sacrées, qui était dans le temple de Yahvé »). La prostitution vénale existait aussi (évoquant la prostitution, le livre d'Ezéchiel précise dans un langage très cru comment la femme dite de mauvaise vie « raffolait d'amants dont le membre viril égalait celui d'un âne et la décharge celle d'un cheval »), les hommes avaient facilement recours aux prostituées et n'étaient accompagnés d'aucun jugement moral négatif (les livres de sagesse répètent à qui mieux mieux le conseil d'éviter celles qui vous prendront dans leurs filets pour vous dépouiller de tous vos biens, mais les recommandations sont du domaine de la prudence, non du respect des personnes, et la prostituée est un personnage bien présent dans le monde de la Bible) : dans ces sociétés, la sexualité était un comportement humain, comparable aux autres recherches de plaisir, donc tout à fait normal. La prostitution ordinaire était interdite aux femmes du peuple hébreu, mais autorisée pour les étrangères (finalement, même les juives la pratiquaient, presque légalement). En fait, cette interdiction fonctionnait grâce à un tour de passe-passe, car n'était pas appelée « prostituée » la femme que son père prêtait contre de l'argent, mais seulement la femme qui était sous l'autorité d'un homme et qui, sans son approbation, vendait ou donnait ses charmes. C'était le détournement du bien d'un chef de famille qui était interdit, pas le commerce sexuel, et, au Moyen-Orient, un père pouvait monnayer les services de sa fille dès que celle-ci avait trois ans. La Bible montre de fait que les hommes avaient facilement recours aux prostituées. En Egypte, la prostitution était pratiquée sur les bords du Nil, mais elle était condamnée moralement puisqu'on attendait même d'un veuf de longue date qu'il évite ce genre de fréquentations. Pour autant, les maisons closes existaient (représentations d'accouplements collectifs sur papyrus ou tessons de poterie). Par contre, il n'y avait pas de prostitution sacrée, les relations (même intimes) entre une prêtresse et une divinité s'effectuant dans le cadre d'une relation symbolique de couple légitime. En somme, dans de nombreuses sociétés archaïques, la prostitution n'était pas mal vue et représentait pour les femmes de condition libre une source de revenus pour se constituer une dot et accéder ainsi au mariage qui était un statut recherché (ce fut par exemple le cas dans la société étrusque, où les femmes avaient pourtant des droits importants, à la grande indignation des Grecs qui reprochèrent de ce fait aux Étrusques la légèreté des mœurs de leurs femmes - en plus de leurs pouvoirs et de leur « autonomie »).
• Animateur : Qu'en était-il justement des civilisations grecques et romaines, fortement influencées par leurs prédécesseurs orientaux ?
• Historienne : Dans ces sociétés esclavagistes, seul le plaisir des maîtres existait, car il était le seul à contribuer à la puissance de l'Etat. L'esclave concourait d'ailleurs à intensifier ce plaisir. Il n'était pas condamnable, ni même répréhensible, de vendre des êtres humains : son enfant, garçon ou fille, sa mère, sa sœur, voire soi-même. Avec l'esclavage, le commerce des humains générait la recherche de personnes à prostituer : guerres, rapts, razzias de pirates et de bandes organisées fournissaient un abondant personnel aux proxénètes et à tous les amateurs dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Dès la petite enfance on pouvait être rentable pour son propriétaire, et souvent celui-ci consacrait temps et argent afin de parfaire les qualités sociales et les compétences érotiques de ses protégés dans l'espoir d'un profit maximum (des hommes ou des femmes de bonne famille tiraient même profit de la beauté de leurs esclaves en les prostituant dans un coin isolé de leur domicile). L'histoire des plaisirs de la chair (manger, boire et faire l'amour) dans la démocratique Athènes est une étude de la jouissance des sens que procure aux hommes de la cité le marché des corps et de la table (sur les vases attiques du -Vè siècle, la représentation des ménades - ivres en permanence, jouant du tambourin et chantant la joie de chasser les chèvres -, les adoratrices et nourrices de Dionysos - dieu de l'extase et de tous les sucs vitaux dont le sperme, il est celui qui permet à ses fidèles de dépasser la mort -, est très proche de celles des courtisanes vouées au culte d'Aphrodite - déesse dérivée de la sumérienne Inanna, elle symbolise tant le plaisir de la chair que l'amour spirituel, pure et chaste dans sa beauté ; les femmes étaient tant ses victimes que ses instruments destinés aux hommes car, elle-même mariée à Héphaïstos, elle eut de multiples aventures extraconjugales). Le banquet athénien de l'époque classique, le lieu par excellence des plaisirs de la chair, avait recours à des « professionnels » des deux sexes. Les épouses et les filles de citoyens étant par leur statut exclues des festivités de l'andrôn, il était dans l'ordre des choses que les femmes admises à partager la couche des dîneurs et à contribuer à leurs divertissements soient exclusivement des « professionnelles », pornai (prostituées) ou hetairai (compagnes) rétribuées d'une façon ou d'une autre, pour leurs prestations. Rappelons tout de suite que l'érotisme masculin est à aborder dans la sphère de la consommation vénale de partenaires féminins ou masculins : l'hétérosexualité n'était pas uniquement confinée à la reproduction de l'oikos (la maison) et de la polis (la cité) et l'homosexualité masculine était aussi concernée par le marché du sexe. Même si la liaison de l'éraste, l'adulte, et de l'éromène, le pais (« l'enfant » qui n'a pas encore de poil au menton), ne relevait pas du marché des corps, mais de la paideia, de l'éducation, des adolescents apparaissent en grand nombre dans l'iconographie du banquet où ils faisaient les échansons (chargés de servir à boire aux personnages de haut rang) et le service de la table, et ils étaient, bien plus souvent que des éromènes (amants), des « professionnels » venus du marché du sexe. De leur côté, les femmes qui accompagnaient les hommes en société (fermée aux femmes honnêtes) et qui avaient reçu à cette fin une certaine éducation - dont étaient privées les femmes en général - étaient dites « compagnes ». Ces hétaïres (courtisanes de luxe) étaient de riches affranchies ou des étrangères qui faisaient, librement, commerce de leur corps. Elles circulaient librement et menaient une vie indépendante, contrairement aux femmes mariées, mais elles n'obtenaient jamais le statut de citoyennes. Comme disait un contemporain : « Les hétaïres nous les avons pour le plaisir, les concubines pour les soins de tous les jours, les épouses pour avoir des enfants légitimes (pour perpétuer le nom et recueillir le patrimoine du père) et garder fidèlement le foyer ». Les femmes étaient donc classées dans la société non par les critères sociaux, mais par leur rôle sexuel. Ainsi, dans le monde des plaisirs, à Athènes comme ailleurs, la hiérarchie des professionnelles a toujours un grand nombre d'échelons, ainsi la distinction entre pornai et hetairai devient obsolète. Ce sont toutes des prostituées. Toutefois, la première différence, essentielle, porte sur le mode de rétribution des prestations. La pornê était payée en argent par ses clients (souvent représentés sur les vases la bourse à la main !), l'hetaira recevait des cadeaux de ses hetairoi (compagnons) et de ses philoi (amis). Dans le premier cas, il y avait échange anonyme de marchandises : ce que vendait la pornê, son corps, son sexe, accessoirement ses talents artistiques, était une marchandise et elle était, elle-même, une marchandise. Cette dernière était tarifée, qu'il s'agisse de la personne (il y a des professionnelles nommées « une obole », « deux drachmes ») ou du type de passes demandées par le client, la kubda, la pénétration anale, ayant le prix standard le moins élevé. Dans le second cas, des cadeaux étaient échangés entre des personnes liées entre elles par la philia, un terme qui dit moins la relation sentimentale que l'appartenance à un groupe engagé dans des liens de réciprocité. Aux dons de ses philoi qui assuraient son entretien, l'hetaira répondait par un contre don. Le contenu et le montant du don et du contre don étaient à la discrétion des donateurs. Une hetaira n'avait pas les mêmes exigences et les mêmes gracieusetés vis à vis de tous ses philoi. Elle avait, en revanche, intérêt à ce que soit respecté ce mode de rétributions de ses prestations et à déployer toute une stratégie pour garder l'amitié hors du marché, car il y allait de son rang. Aussi, lorsqu'elle acceptait de se faire payer en argent, et que sa position dans le monde des plaisirs lui permettait de le faire, elle exigeait des sommes fabuleuses (mille drachmes pour une nuit) ce qui ne faisait qu'accroître son prestige et confirmer sa place dans la hiérarchie. Le deuxième paramètre à considérer est la nature et la durée des services demandés. Dans tous les cas, la copulation faisait partie du jeu, mais elle pouvait être associée à d'autres prestations comme le chant, la danse ou la conversation, voire des soins divers. La location pouvait être opérée par un ou plusieurs clients et sa durée pouvait aller de la simple soirée à celle d'un ensemble de festivités. Entre la pornê qui était payée à la passe et qui devait accepter tous les clients et l'hetaira qui avait un nombre restreint de philoi assidus et qui devait être « séduite » pour accorder ses faveurs, l'échelle était longue et ses degrés bien flottants. Le troisième paramètre à considérer lorsqu'il s'agit de distinguer la pornê de l'hetaira était « l'économie du regard ». A Athènes, la réclusion dans l'espace privé était le signe d'un statut (et même d'un rang social) : l'Athénienne, la fille / épouse / mère de citoyen, était dissimulée à tous les regards, à l'abri de ses vêtements et des murs de l'oikos de son père puis de son mari. L'espace de l'hetaira oscillait entre ces deux extrêmes qu'étaient l'espace public de la pornê et l'espace privé de l'épouse. La pornê était exposée aux regards de tous : son corps était dénudé (pour l'exhibition du bordel puis lors de ses prestations de musicienne et de danseuse) ; elle n'était pas rattachée à un oikos et partageait la promiscuité du bordel. L'hetaira avait une résidence personnelle, mais ce n'était pas une recluse enfermée dans la maison. Elle n'exhibait pas son corps ; au contraire, lorsqu'elle sortait, elle le couvrait pour en garder toute sa valeur. Lorsqu'une hetaira était prise comme concubine (pallakê), elle perdait son ambivalence : elle devenait une « femme de l'intérieur », traitée comme une épouse et astreinte au même comportement. L'opposition hetaira / pornê a donc été mise en place en Grèce archaïque, pendant la période où les banquets aristocratiques constituaient « une anti-cité » avec ses propres règles et ses propres conventions. Alors que la cité adoptait le système monétaire, l'anti-cité aristocratique le refusait et entendait garder l'organisation de ses plaisirs hors du marché. Situer les échanges entre l'hetaira et ses hetairoi dans le champ du don et du contre don relèverait donc plus du politique que de l'économique. Selon le droit athénien, l'homme libre qui se prostituait (dans une relation homosexuelle, comme prostitué ou comme courtisan/amant) perdait la capacité d'exercer une fonction publique et de fréquenter les lieux publics (tout comme celui qui avait frappé ou négligé ses parents, celui qui n'avait pas pris part aux expéditions militaires ou avait jeté son bouclier, celui qui avait dévoré les biens de ses parents ou tout autre héritage), la violation de ces interdits étant punie de mort. La raison de ces règles se trouve dans le rôle social que jouait la pédérastie. On déduisait en outre de la prostitution d'un homme, l'engloutissement de son héritage, notamment par une insatiable soif des plaisirs et les dépenses que génère l'absence de maîtrise de soi. La passion de la bonne chair (opsophagia), des joueuses d'aulos, des courtisanes et du jeu, amène à accepter de s'installer chez son amant pour jouir de tout cela gratuitement et toucher un misthos, devenant de fait un courtisan hetairikos. Ce genre de citoyen était considéré comme un prostitué parce qu'il faisait commerce de son corps et comme un « efféminé » parce qu'il était insatiable dans sa quête des plaisirs. Ce qu'on lui reprochait n'était pas son comportement sexuel mais sa situation de dépendance vis-à-vis des amants chez lesquels il s'était installé, une situation qui était celle d'une femme vis-à-vis de son mari, entretenu par autrui parce que son corps ne lui appartenait plus et parce qu'il avait perdu toute liberté de parler et d'agir. Ainsi, la métamorphose d'un amant devenant homme après avoir été femme n'a rien de sexuel, elle est simplement dû à un changement de situation économique et de position sociale : après avoir été entretenu par un amant, le prostitué/courtisan devient à son tour suffisamment riche pour entretenir à son tour un amant. Mais un hetairikos citoyen qui impose à son amant des dépenses considérables dans la vie privée doit nécessairement le payer de retour dans la vie publique. Comme le « parasite » (le asumbolos, qui ne paye pas son écot) avec son « sponsor », l'hetairikos entretient avec son amant une relation de dépendance politique, ailleurs on dirait de clientèle. Cela aboutit dans tous les cas à la même conclusion : comme l'avait prévu le législateur, la prise de parole d'un débauché qui s'est vendu à ses amants ne peut rien apporter de bon à la communauté. Parallèlement à cela, la prostitution féminine n'était pas punie, car elle remplissait une fonction socialement utile (rempart contre l'adultère). L'offre et la vente des corps se déroulaient dans des lieux publics, rigoureusement séparés de l'espace privé de l'oikos (la maison) et considérés comme des zones de commercialisation, des espaces magiques qui transforment les humains en produits. C'étaient évidemment les rues de la cité où les épouses, « les femmes mariées selon les règles » et soucieuses de leur réputation, ne s'aventuraient que par nécessité et cachées sous un épais manteau. C'était là que déambulaient en revanche, s'offrant à tous les regards, des troupeaux de péripatéticiennes (prostituée qui arpente le trottoir, par allusion plaisante au verbe grec signifiant se promener, qui inspira les péripatéticiens, les partisans de la doctrine d'Aristote qui apprenaient en marchant et en regardant la vie autour d'eux) : gephuris (fille des ponts), dromas (coureuse), peripolas (vagabonde)... Les murs, les portes, les places et le port de la cité étaient particulièrement fréquentés. Il semble que le quartier du Céramique avec sa porte (le Dipylon), son cimetière et ses jardins était un haut lieu du commerce du sexe. Parmi les racoleuses de l'espace public, les auletrides, les joueuses d'aulos (une sorte de hautbois), étaient les moins chères et les plus méprisées même si certaines d'entre elles parvinrent à s'élever dans la hiérarchie de la prostitution. Elles pouvaient en effet être distinguées dans des « écoles de musique », sans doute sans grande qualité artistique, mais très prisées par un public masculin assidu. Les rues d'Athènes étaient dures : les bagarres pour se procurer une professionnelle étaient très fréquentes et les dîneurs se disputaient particulièrement les « musiciennes » indispensables à leur fête. Pour canaliser les pulsions naturelles des jeunes gens et protéger les femmes mariées, Solon (le grand démocrate) fit l'acquisition de femmes esclaves, les installa dans différents quartiers de la cité (près des remparts ou dans les quartiers populeux) pour les offrir à tout le monde dans le cadre d'établissements municipaux (même si très vite purent s'ouvrir des établissements privés, soumis à autorisation et redevables de taxes). Protégées par les autorités, les maisons publiques versaient en échange une redevance, le pornikon. Avec cette taxe, Solon fit construire un temple à Aphrodite Pandémos (l'Aphrodite commune à tous ; au-delà de ça, la prostitution sacrée était pratiquée auprès de certains temples et à leur profit), patronne des plaisirs tarifés. Pour que l'ordre public soit respecté, les astynomoi, les dix magistrats qui en étaient chargés, devaient veiller à l'application de la loi : les joueuses d'aulos et autres musiciennes ne devaient pas profiter de la compétition dont elles étaient l'objet pour faire monter les prix. En effet, le prix forfaitaire pour une nuit ne devait pas dépasser deux drachmes et si des hommes se disputaient la même professionnelle, cette dernière était tirée au sort sans être consultée. Celui qui payait plus était passible d'une eisangélie, une action judiciaire qui concernait les délits politiques. Dans une cité démocratique, le marché du sexe devait être ouvert à tous, sans distinction de fortune ! Ainsi, le bordel était un « lieu public » où se pratiquait légalement le commerce du sexe féminin. Le terme normal pour le désigner depuis Solon est ergasterion, atelier (non pas que du sexe, car il était aussi un atelier de filature et de tissage ce qui doublait sa rentabilité). Des hommes (et des femmes) sont quelquefois décrits comme « assis dans un oikêma », une stalle (siège de théâtre, mais aussi espace limité par des cloisons, notamment réservé à un cheval dans une écurie) individuelle dont la porte s'ouvre directement sur la rue, ce qui laisserait supposer qu'il s'agissait d'une institution légèrement différente de celle du bordel (mais que la porte soit modestement fermée ou ouverte pour un « show », la profession de l'occupant ne faisait pour le passant aucun doute). La forme la plus dépréciée de prostitution était celle que pratiquaient les femmes en se vendant au bord des routes ou dans les bordels. C'était notamment le cas des pornai, des prostituées de basse condition. Ce nom vient du verbe « vendre », car les prostituées étaient au départ des esclaves achetées sur le marché par des proxénètes femmes et installées dans de petites cellules qu'un simple rideau fermait pendant la passe. Pour autant, les esclaves pouvaient espérer (pour certaines d'entre elles, les plus belles et talentueuses) changer de statut, passer de la condition d'esclave à celle d'affranchie : c'était alors pour une prostituée accéder à la propriété, propriété de son corps, propriété de ses biens et propriété de ses enfants qu'elle pouvait désormais garder si elle le désirait. Comme en Grèce, la prostitution (du latin « prostituere » : mettre devant, exposer au public) était tolérée à Rome tout en faisant l'objet d'une réprobation sociale. Pour autant Caton l'Ancien (homme de la République pourtant réputé pour sa sévérité), disait à des mâles sortant du lupanar : « Bravo ! Courage ! C'est ici que les jeunes gens doivent descendre, plutôt que de pilonner les épouses des autres » (à Rome, les dicterions - lupanars - étaient considérés comme lieux d'asile et, par la suite, reconnus inviolables ; dans leur enceinte, les hommes mariés ne pouvaient y être accusés d'adultère, un père ne pouvait y chercher son fils pas plus que le créancier poursuivre son débiteur) ; de même, après la morosité du règne augustéen, les mœurs se libérèrent brutalement pendant les premières années du règne de Tibère et on vit même un sénatus-consulte de 19 se plaindre, entre autres « déviances », qu'aucune fille libre de moins de 20 ans n'avait le droit de se prostituer contre un salaire. La prostitution, très fréquente et totalement admise (rejetée certes, mais tolérée quand même) puisqu'aucun homme ne se cachait pour aller au bordel, était peu onéreuse. A Rome, les professionnels (femmes ou hommes) se rencontraient dans les lieux publics tels que les forums, les portiques, les théâtres, les auberges et bien sûr les lupanars (du mot « louve », le surnom des prostituées ; leurs chambres étaient ordinairement construites sous terre et voutées, fornix, d'où est dérivé le mot fornication). Les maisons closes étaient encadrées par l'Etat au nom de l'intérêt public (pour éviter que les jeunes gens ne se ruent sur les femmes mariées). Au-delà des créatures aussi vénales qu'affolantes qu'étaient les courtisanes de comédie, ou encore ces figures de « demi-mondaines » (que célébraient les poètes), sans parler des princesses impériales (comme Julie ou Messaline, dont les historiens anciens dénonçaient à plaisir les incartades sexuelles la nuit dans Rome), les hommes eux-mêmes étaient accusés de se prostituer comme César et son ami Mamurra dont Catulle prétend qu'ils disputaient leurs clients aux filles des rues. Toutes ces figures peuplent la Rome imaginaire de nos contemporains, dont ils font volontiers une société orgiaque et « décadente ». Toutefois, le mot de prostitution renvoie tantôt au commerce réel des corps tantôt à des pratiques sexuelles transgressives par rapport aux normes de la société romaine. Les rapports économiques à Rome, en effet, comme dans bien des sociétés traditionnelles, pouvaient relever soit du don et du contre-don, soit de l'échange marchand. Dans le premier cas les services sexuels étaient inclus à Rome dans des relations de clientèle (il s'agissait d'un officium, d'un « devoir », de l'affranchi(e) à son ancien maître), dans l'autre il s'agissait d'une véritable prostitution, d'un commerce monnayé. À cela s'ajoutait une autre situation économique : celle de l'esclave qui était une marchandise et dont le corps était à la disposition de son maître (les lois condamnant les maîtres qui prostituaient leurs esclaves étaient si peu efficaces qu'elles furent souvent reproclamées du Ier au IVè siècle). La prostitution ainsi définie (limitée aux seuls échanges marchands des corps) pouvait être le fait soit d'esclaves, loués par leur maître, soit d'affranchi(e)s, soit d'hommes et de femmes libres car nés libres (ceux que les Romains appellent ingenui), des ingénu(e)s qui vendaient leurs prestations sexuelles. En fait les seul(e)s prostitué(e)s dont le droit et la morale se souciaient étaient les ingénus, faisant commerce de leurs corps de façon ouverte et notable. En effet, d'une façon générale l'impudicitia volontaire et en particulier la prostitution, ne pouvait déshonorer qu'un homme ou une femme susceptibles d'être honorables, ce que n'étaient pas les affranchi(e)s. Finalement la prostitution au sens strict était à Rome quantitativement moins importante que dans nos sociétés égalitaires et démocratiques. Et elle n'était problématique que pour les prostitué(e)s ingénu(e)s. Puisque des corps serviles, ou affranchis, masculins et féminins étaient disponibles en grand nombre, aussi bien dans les demeures des hommes libres que dans les maisons de prostitution, comment se fait-il que des femmes nées libres aient renoncé à leurs privilèges et statut de matrones ? Comment se fait-il aussi que la société ait institutionnalisé ce renoncement en prévoyant d'enregistrer officiellement ces prostituées d'origine libre ? La réponse à cette question tient à la place et la nature des loisirs (otium) voluptueux dans la vie romaine et au coût des plaisirs qu'ils imposaient. C'est pourquoi penser la prostitution romaine doit se faire d'abord en termes de dépenses somptuaires. D'ailleurs les Romains ne censuraient jamais l'usage des prostitué(e)s proprement dit(e)s pour des raisons morales mais prétextaient toujours de raisons économiques : payer des prostitué(e)s menaçait les patrimoines comme toutes les autres dépenses en argent destinées aux plaisirs de l'otium (trop d'hommes libres donnèrent tous leurs biens à une courtisane au point que le droit interdit les legs en leurs directions). Malgré le blâme moral adressé aux prodigues excessifs, les dépenses destinées aux plaisirs de l'otium et en particulier l'argent payé aux prostitué(e)s étaient à Rome une nécessité culturelle, la culture du plaisir étant constitutive de l'otium. En effet, il était convenu au sein de la culture romaine que les jeunes hommes non mariés pouvaient et devaient s'adonner aux divers plaisirs associés au banquet : le vin, la bonne chair et les filles (ou les garçons). Ces plaisirs juvéniles n'avaient pas lieu, en général, dans la maison du père mais dans les maisons de prostitution à cause de leur caractère exceptionnel et excessif. Un ou une esclave assez joli(e) pour n'être qu'un objet de plaisirs coûtait trop cher pour être présent(e) dans de nombreuses maisons, et les multiplier menait à la ruine. C'est pourquoi la cité avait besoin de prostitué(e)s pour ses plaisirs. Ainsi à côté de la population servile toujours sexuellement disponible, les Romains faisaient appel à des prostitué(e)s libres afin de donner une dimension somptuaire, luxueuse, indispensable aux plaisirs raffinés qui constituait ce pôle indispensable de la vie civilisée qu'était l'otium urbanum, les loisirs de la ville. Les prostitué(e)s appartenaient donc à la population urbaine et étaient des composantes indispensables à la civilisation telle que la concevaient les Romains, au même titre que le vin, la musique, la cuisine, les parfums et tous les autres plaisirs du banquet. La prostitution était donc une pratique non pas sexuellement mais culturellement nécessaire à Rome. Le système symbolique de Rome servait à représenter l'érotisme des corps libres, féminins et masculins. Alors que la cité marquait d'infamie ces hommes et ces femmes nés libres se livrant à la prostitution (les privant du droit d'hériter aussi bien que de porter plainte pour viol ou insultes, créant ainsi une catégorie inférieure de citoyens), ils exerçaient une fonction précise. Ces « parias » de la société romaine, toujours « efféminés », servaient à marquer les marges de l'humanité civilisée dans la continuité, à définir les hommes, libres et adultes et donc « masculins », par ce qu'ils ne sont pas mais ce qu'ils pourraient par malheur être, devenir des « efféminés » ou leur équivalent, des prostituées libres. Les prostitué(e)s libres assumaient donc une fonction symbolique qui était d'être l'autre du soldat comme l'acteur est l'autre de l'orateur. Un épisode du mythe de Romulus et Rémus est associé à ce rituel : les jeunes Luperques reproduiraient les deux jumeaux, guerriers et bergers nomades, avant la fondation de la Ville, élevés sur un Palatin encore sauvage par une prostituée, lupa (Accia Laurentia, à qui la beauté de ses formes et la voracité de son appétit charnel avaient attiré cette qualification de la part de ses voisins), compagne d'un berger, après avoir été allaités bébés par une véritable lupa-louve. Le loup figure la vertu militaire, le corps sacré du jeune soldat, la louve incarne le corps prostitué de l'un ou l'autre sexe. Que la louve soit devenue l'animal emblématique de Rome montre comment était centrale la figure de la prostitution (féminine ou masculine indifféremment) à Rome : elle structurait l'espace féminin et urbain, en s'opposant à la matrone domestique, et l'espace masculin de la guerre en s'opposant au soldat (d'ailleurs, une fois par an, les femmes de la noblesse romaine étaient obligées de s'offrir au premier venu pour le prix qu'ils décidaient ; de même, bien que les filles publiques portaient une toge ouverte sur le devant et une mitre jaunes, couleur de la honte et de la folie, leurs chaussures étaient rouges jusqu'à ce qu'Adrien réservât cette dernière couleur aux seuls empereurs - sous l'aspect du pourpre, couleur très chère car issue du coquillage murex). L'empire byzantin, héritier de Rome, continua longtemps de tolérer les formes les plus visibles de prostitution (il faut rappeler que dans le domaine familial, l'usage oriental d'offrir les esclaves de la maison aux hôtes de passage était un gage d'hospitalité), puisqu'il existait même à Constantinople un théâtre appelé Pornas où l'on donnait des spectacles débridés. Ainsi, Théodora (508-548), élevée dans un porneion (une maison de prostitution) puis membre d'un groupe de comédiens légers, usa de ses charmes pour s'élever dans la société, obtenant même en 524 l'abrogation de la loi qui interdisait à un patricien de se marier avec une actrice (elle étant plus qu'à fond dans son rôle de courtisane ... d'infanterie). Elle devint ainsi la femme du futur empereur Justinien et influença alors la vie politique pendant plus de vingt ans, poussant son mari à diriger l'Etat d'une main de fer. Mais elle n'oublia pas son passé, car en matière de prostitution, son grand empereur de mari fut très innovateur. Il stipula en 531 dans son Corpus Juris Civilis que tous les proxénètes tels les souteneurs et les maquerelles (de macalrellus : dans les anciennes comédies à Rome, les proxénètes de la débauche portaient des habits bigarrés ; ce nom n'a été donné à l'un de nos poissons de mer - maquereau - que parce qu'il est bariolé de plusieurs couleurs sur le dos) seraient punies sévèrement s'ils étaient trouvés coupable de pratiquer ces métiers. Pour la première fois, une loi s'attaquait aux problèmes de la prostitution par ces racines. Par le fait même, les lois interdisant aux ex-prostituées de se marier furent également abolies. Mais ce code de loi ne faisait pas allusion aux prostituées elles-mêmes. En fait, cette loi visait essentiellement à faire sortir les prostituées des maisons closes. Afin de réussir son projet, il devait évidemment faire plus, c'est pourquoi il mit sur pied le premier centre de réadaptation sociale, nommé Metanoia qui voulait dire se repentir. Mais malgré ces efforts considérables, le programme fut un échec. De quoi confirmer la réputation de Byzance, cette cité du vice et de la perversion.