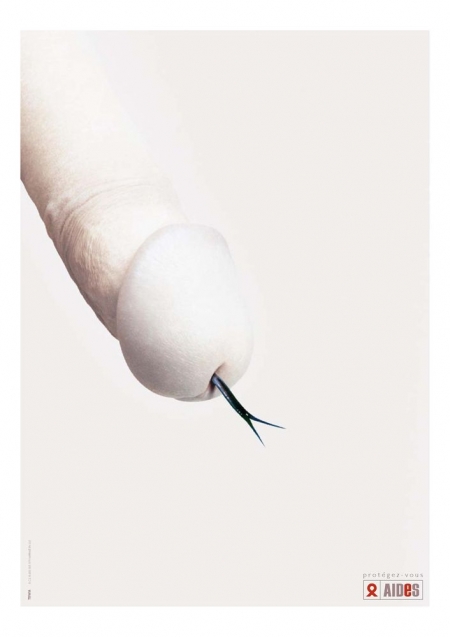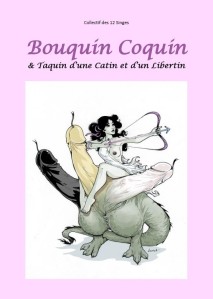 Bienvenue aux mateurs de tous poils ! Ceci est le blog dédié à notre troisième livre autoédité,
Bienvenue aux mateurs de tous poils ! Ceci est le blog dédié à notre troisième livre autoédité,
« Bouquin Coquin et Taquin d’une Catin et d’un Libertin »
(pour nous soutenir en commandant, c'est ici !!!).
Après « Lendemain du Grand Soir », « La philo south-parkoise, ça troue le cul !!! », voici notre essai érotique et réflexif sur la place et l’impact de la sexualité sur nos vies sociales et sentimentales, utilisant des vocabulaires thématiques « neutres » (nature, sports mécaniques, gastronomie, végétaux, sports, musique, drogues) détournés de leur contexte et sens originel pour visualiser des scènes érotiques (l’œuvre reste érotique-chic plutôt que porno-crado !).
Parallèlement à cela, nous avançons sur « Une histoire d’Homo Sexualis » : émergence biologique puis évolution comportementale du sexe, la sexualité chez les autres animaux ainsi que dans notre vaste groupe de primates, puis chez les différents Homo qui se sont succédés jusqu'à nous (même dans l'art préhistorique, constellé de triangles pubiens et de phallus), la vision mythologique du sexe et de la sexualité, la prostitution dans la civilisation.
Catégories
- Bouquin Coquin & Taquin ... (24)
- La prostitution à travers les âges (8)
- La contraception à travers les âges (2)
- La naissance de la sexualité biologique (1)
- La sexualité chez les autres animaux (1)
- La sexualité de la famille primates / Homos (1)
- La sexualité de nos ancêtres deux fois "sages" (5)
- La sexualité dans la civilisation et ses mythes (5)
Recherche
Derniers articles
- Histoire du sexe filmé
- ANNIV' des 5 ans du Collectif des 12 Singes : PROMO à pas chère jusqu'à Noël
- ** COMMANDER ** « Bouquin Coquin et Taquin d'une Catin et d'un Libertin »
- Chapitre 0 : L'innocence de l'enfance face à la montée du besoin/envie de jouissance
- Introduction de Bouquin Coquin et Taquin d'une Catin et d'un Libertin
- Chapitre 1b : Le boum-boum zen dans sa Benz
- Chapitre 1a : Contons fleurette à la belle des champs
- Chap 10b : Plus on est de fous plus on jouit
- Chap 8 : Les Amazones démontent Jésus
- Chap 5 : Heureusement qu'il y a l'Amour, enfin ... !!! / ???
Publications en direct liv(r)e
Liens
- Groupe facebook dédié à Bouquin Coquin
- Blog du Collectif des 12 Singes (et Bonobos)
- Suivi de nos publications en direct liv(r)e
- Une jolie histoire de libertinage : découvrir, pas à pas, les débuts d'un jeune couple dans sa quête du plaisir
- Histoire erotique gratuite (blog pour rendre le pouvoir aux mots)
• Historienne : A l'époque anté-islamique et même par la suite (non du fait du Coran, plutôt à cause du poids des traditions), les femmes étaient dominées par les hommes, un homme pouvant épouser à sa guise et en même temps le nombre de femmes qu'il voulait. Les femmes dépendaient donc souvent du mari pour survivre ; de la même manière, il pouvait aussi en répudier autant qu'il voulait, la répudiation d'une femme par son époux la laissant sans droits et sans recours. Assez vite, ces femmes répudiées qui dépendaient de leur époux pour vivre, se retrouvaient dans la misère. Lorsqu'elles ne tombaient pas en esclavage dans le strict sens du mot, elles se livraient à la prostitution (qui est une forme terrible d'esclavage). La prostitution était donc exercée par des femmes libres, célibataires, veuves ou divorcées que la misère contraignait à faire commerce de leur corps, mais principalement par des esclaves travaillant pour leurs maîtres. En fait, le Coran ne condamne pas expressément la prostitution, mais se borne plutôt à interdire d'y contraindre une femme : il interdit la rétribution de la courtisane et les produits de la prostitution, moyen détourné de prohiber une activité jugée peu honorable, mais finalement considérée comme un mal nécessaire. La précocité des mariages chez les Musulmans, qui pouvaient prendre quatre épouses légitimes et autant de concubines que leur situation le permettait, aurait pu être de nature à limiter l'amour vénal. Cependant, bien des jeunes gens des milieux modestes ne pouvaient s'initier autrement, et le mariage légal impliquait des charges que les hommes du peuple n'étaient pas toujours à même d'assumer. Par ailleurs, l'interdiction prononcée par le Coran fut toujours aisément contournée par des proxénètes que l'appât du gain attirait, tandis que les facilités de répudiation jetaient à la rue des femmes qui n'avaient pas toujours la possibilité de retourner dans leurs familles. De fait, la prostitution n'a jamais cessé d'être florissante dans les pays musulmans (notamment du fait des nombreuses esclaves), même si la police les pourchassait, les promenant en ville après avoir eu la tête rasée (et elles étaient enterrées dans un coin spécial des cimetières). La galanterie fut de tout temps plus ou moins tolérée, mais même souvent reconnue par les autorités et soumise à des taxes qui alimentaient le trésor public. Il y avait ainsi des maisons publiques dans les divers villes islamiques (un lupanar à Suse - Iran - se situait près de la mosquée ; on pouvait mettre aux enchères les faveurs des filles publiques). Mais il existait bien des prostituées indépendantes, qui pour attirer l'attention, avaient souvent la poitrine nue, à l'image des prostituées sacrées, connues en Mésopotamie et en Inde, régions avec lesquelles la péninsule arabique commerçait et avait des échanges culturels et humains intenses. Nous savons, à partir des sources de l'Inquisition de Modène (1580-1620), que les femmes accusées de prostitution l'étaient moins pour leurs activités prostitutionnelles que pour leurs performances rituelles liées à un savoir sur l'amour dont elles étaient les seules détentrices (incantations, conjurations et oraisons). De même, l'islam orthodoxe des oulémas nord-africains s'accommodait mal des pratiques magico-religieuses des « filles soumises » (prostituées réglementées). Dans le Maghreb du milieu du XIXè au milieu du XXè siècle, les prostituées se situaient à la croisée de la tradition et de la modernité, du visible et de l'invisible, du permis et de l'interdit. Les prostituées étaient en effet souvent en rupture avec les obligations coraniques. Globalement indifférentes aux piliers de l'Islam, elles n'accomplissaient pas les cinq prières journalières, ne pratiquaient pas l'impôt rituel (zaka) et ne respectaient pas le ramadan (il y avait ainsi une forte intensité de la vie sexuelle des prostituées du quartier réservé de Casablanca pendant le mois de jeûne, ces dernières continuant de manger et de boire normalement). Par contre, les filles soumises du quartier récitaient la profession de foi musulmane (shahada) et elles pratiquaient l'aide ponctuelle aux indigents (sadaqa). Les rues et les quartiers réservés étaient d'ailleurs fréquentés, dans l'ensemble du Maghreb, par de nombreux miséreux qui vivaient des libéralités des filles soumises. En somme, les prostituées conservaient un rapport quotidien, mais sélectif, à la religion. Un rapport qui s'accommodait surtout de leurs conditions de vie et de travail à l'intérieur des espaces réservés à la prostitution. Dire la shahada, pratiquer la sadaqa et l'entraide, était une manière simple et non contraignante d'être dans l'Islam et de continuer à appartenir à la communauté des croyants (oumma). Donc de repousser la marginalité imposée par le réglementarisme colonial et d'une certaine manière aussi par la religion officielle des juristes musulmans (fuqaha). Dans cette entreprise, les prostituées formaient une alliance informelle avec les zaouïas (angle ou coin d'une maison ; au début, la zaouïa ne semble avoir été que le nom donné à la rabita - ermitage où se retire un saint -, mais par extension, la zaouïa, c'est aussi l'oratoire, les salles de réunion, les cellules des disciples et des étudiants), la protection des bandits, des voleurs et des prostituées étant chose commune et fréquente dans les zaouïas maghrébines « précoloniales ». Alliance logique puisque certaines zaouïas, comme celle de Sidi Rahhal, étaient renommées pour se livrer à la prostitution sacrée, tout comme la zaouïa de Sidi Ben Arous était de même considérée comme un lieu de débauche féminine. En effet, la prostitution n'étant en Islam ni un métier ni une activité commerciale, on ne légiféra pas dessus mais on y apportait des solutions d'accompagnement. À cette protection revendiquée au sein de l'espace sacré du sanctuaire (haram) s'ajoutait aussi une proximité géographique certaine, en totale opposition avec la centralité islamique des ulémas (en général, les quartiers réservés étaient localisés à l'opposé de la grande mosquée, point axial de la cité islamique). À Kairouan, les rues et quartiers réservés étaient souvent situés près des zaouïas et la moitié des maisons de prostitution étaient érigées en biens religieux (habous). En général, les prostituées étaient symboliquement désignées par le nom du saint du quartier où elles officiaient (les filles de Sidi Abdallah Guèche par exemple). De cette proximité géographique naissait une sorte d'intimité de situation et de sensibilité. Souvent marqués d'un sceau d'étrangeté (folie, pauvreté, infirmité...), les saints et les marabouts parlent en effet un langage que les filles publiques comprennent. Au point que certaines prostituées n'hésitaient pas à se faire tatouer sur le corps des motifs rappelant le rapport privilégié qu'elles entretiennent avec un saint. Bien qu'elles s'adonnaient à la zina (à la fornication), au kif, à l'alcool, et aux jeux de hasard, les prostituées se sentaient, à juste titre, « protégées » par le droit d'asile des zaouïas et « rachetées » par le droit d'humanité des saints et des marabouts. Cet étonnant lien entre profane/ halal (l'illégalisme sexuel des filles) et sacré/ haram (le monde des zaouïas), était apparemment quotidien et continu. De même, une prostituée pouvait rendre visite à une nouvelle mariée, l'aider à se parfumer, à se farder, à se mettre du henné (« La jeune personne sera aimée, car la prostituée a entre ses sourcils, sept fleurs magiques qui attirent l'amour »). De même, dans les petites villes tunisiennes, des prostituées, profitant d'un statut souvent considéré comme transitoire (en attendant un mariage éventuel), devenaient les initiatrices sexuelles des fils de la notabilité (telles nos filles de noces d'antan). Dans ce cas de figure, les filles soumises étaient invitées aux fêtes de familles « pour égayer de propos libertins femmes et enfants » et avaient ainsi une vie sociale très développée. Il existait donc bien une réelle dichotomie entre la nécessité apparente d'intégrer ou de réintégrer, à l'intérieur de la communauté, les individus prostitués et un mépris profond pour les activités prostitutionnelles (ce mépris viendrait du fait que les prostituées sont en rupture avec la qayda, la base/ règle religieuse : les prostituées reçoivent de nombreuses sollicitations d'hommes qui les méprisent puisqu'elles ont rompu avec la qayda - qui les veut voilées, claustrées et soumises à l'autorité du père ou du mari - mais qui les incitent avec ténacité à la débauche). En Algérie (débarquée le 14 juin 1830, le 5 juillet les troupes françaises firent leur entrée dans la forteresse d'Alger, le dey capitula le jour même), le monde des courtisanes et des concubines, celui des « femmes libres » auquel était attaché ce groupe (qu'on a cru faire disparaître avec l'arrêté du 12 août 1830 qui classa les filles publiques en « officielles » et en « clandestines »), allait resurgir pour se réorganiser autour de la nouvelle économie touristique. Marginalisées par le système réglementariste et stigmatisées par ses agents, les filles soumises étaient considérées de fait comme des exclues de la société coloniale (d'autant plus que la prostitution était perçue comme une pratique qui perturbait l'ordre social de la société coloniale, que l'on voulait morale selon ses propres référents, les prostituées pouvant, elles aussi à l'occasion, grossir les rangs des mécontents et des contestataires, entretenant ainsi un lien entre pauvreté, désordre sexuel et sédition sociale). Le régime colonial se dota donc d'un certain nombre de moyens pour maîtriser, canaliser et surveiller cette pratique (notamment à cause des maladies vénériennes qui hantaient les esprits). Ainsi, au café maure de Bou-Saâda, des jeunes filles des Ouled Naïl, couvertes de vêtements et d'ornements bizarres, dansaient au son d'une « étrange musique » (pour les Blancs). Alors qu'auparavant c'était au mezouard, un agent désigné au temps de la période ottomane, qu'il revenait d'assurer la surveillance des filles publiques et de lever l'impôt (institution qui fut reconduite pendant quelques temps par l'administration coloniale), en 1850, jugé archaïque, ce système fut remplacé par la police des mœurs. On affecta alors aux filles publiques un lieu spécifique, appelé « l'Asile des Naïlia », qu'on installa sur la place, bordée d'un côté par les boutiques indigènes, de l'autre par le Commissariat de police et la « maison d'école » : le quartier réservé était né. Organisé autour d'une cour centrale entourée de seize à dix-huit cabanons, dont chacun était destiné à loger deux femmes prostituées, il était nommé localement « Beit el kabira » (la grande maison), terme qui désigne en arabe une tribu de « grande tente » ou une grande famille. Le terme tabeg el kelb, la patte levée du chien, rappelle l'image abjecte qu'avait engendrée ce lieu. Un lieu qui resta, pendant longtemps, au centre de la vie économique et sociale de la cité. Au début du XXè siècle, au moment de l'émergence de la bourgeoisie puritaine et du réformisme religieux qui s'affirmèrent avec l'évolution urbaine de la cité, on annexa au bâtiment un dispensaire infirmerie-prison. Les filles publiques furent définitivement enfermées dans ce nouvel espace, dont elles ne sortaient plus que sur autorisation. Au cours des années 1930, la population de Bou-Saada atteignit 50 000 âmes : l'urbanisation et l'euphorie touristique aidant, la topographie de la prostitution allait dès lors se modifier. Autour de « Beit el kabira », déplacée sur les berges de l'oued, allaient s'établir peu à peu des maisons de tolérance. Elles formèrent la rue de la « tolérance », appelée communément la « rue des Ouled Naïl » (la mémoire évoque plutôt, z'gag el qanqi, la rue de la Lanterne, qui fut l'une des premières à être éclairée). La rue des Ouled Naïl était, à Bou-Saada, la plus animée de la ville. En apparence bien sûr, puisque la rue de l'amour et de la joie était aussi un lieu de mort et de bagarres, il ne se passait pas un jour sans que la police ou l'armée n'interviennent. En 1932, une bagarre entre clients qui se disputaient les faveurs d'une prostituée dégénéra en une véritable révolte qui souleva presque toute la ville. L'administration centrale avait même cru à une rébellion populaire suscitée par les nationalistes. Le Gouverneur Général y dépêcha une commission pour enquêter, le lieu de l'amour vénal étant de nouveau au centre de la cité, les voies y conduisant furent murées. Une manière de dénoncer l'infamie et de s'en distancer (comme à Alger, où faute de disposer d'un espace propre à la prostitution, l'inscription « Maison honnête » au frontispice des maisons indiquait la frontière à ne pas franchir ; ou encore à Tunis, où les portes des filles publiques étaient marquées d'une teinte rouge). A Bou-Saada, le recrutement se faisait dès le jeune âge, au sein de la famille, du village ou de la tribu (Yamina, à la redoutable réputation, avait mis à son service toutes ses sœurs et ses nièces). Pour les filles, le choix était limité : naissant et vivant au quartier réservé, l'avenir était assuré, le « métier » de maman étant le seul modèle à suivre. Quant au garçon, il devait apprendre un métier en relation avec le milieu (Shaush était le métier le plus prisé, le garçon administrait alors les biens de sa mère, de sa sœur ou de ses tantes). L'initiation à la danse, point d'entrée dans la prostitution, exigeait un véritable apprentissage. Il s'agissait là de « prostitution traditionnelle », en opposition à la « prostitution sacrée » (longtemps tenue pour être à l'origine de la prostitution en Algérie). L'entreprise « familiale » ainsi bâtie, son chef n'était autre que la dame de maison selon le règlement. Elle agissait en véritable patron face à l'administration qui lui imposait un règlement et exigeait d'elle des taxes. C'est ainsi que l'administration a été confortée dans son rôle, rassurée quant aux aptitudes de ses recrues. La vie quotidienne était organisée selon un calendrier établi par l'administration : les samedis et dimanches étaient réservés exclusivement aux militaires pour éviter tout incident avec la clientèle civile. Le mardi, jour de marché à Bou-Saâda, était réservé aux clients civils, voyageurs et commerçants de passage. Le reste de la semaine les prostituées recevaient surtout les citadins. Le programme d'une journée commençait le soir où, dans une première partie, on assistait à un « spectacle banal ». Et dans une deuxième partie, qui commençait très tard, venait le spectacle « des danseuses nues ». Aucun répit n'était accordé à la fille publique de Bou-Saâda, puisqu'elle était également sollicitée par l'administration pour animer les festivités officielles : on ne manquait pas le 14 Juillet, lorsque les filles publiques, dans leurs palanquins (siège installé sur des bras inamovibles et porté par des hommes dans les pays orientaux), défilaient aux cotés des militaires dans les rues de la cité. Après ce programme chargé, auquel la fille publique était soumise pendant ses années de jeunesse, sa gloire passée, vieillie par le temps ou par l'alcool, le tabac, et toutes sortes de boissons frelatées qui faisaient partie des nouvelles pratiques adoptées au quartier réservé, elle était abandonnée. Avec plus de chance, certaines finissaient tenancières de maison de tolérance. Parfois, les plus jeunes avaient la chance d'être choisies par un homme riche ou par un amant de cœur pour des épousailles que le prophète Mohammed autorise et même recommande aux croyants. C'est un acte de bravoure qu'un musulman se doit de faire pour sortir une femme de la déchéance (même s'il y a davantage de mépris porté à ces « épouses » que de respect pour la bravoure de l'homme). Leur réinsertion au sein de la société locale n'était pas chose évidente, ni acquise d'avance : elles y étaient admises - ou réadmises - à travers des rites de passage. Elles devaient emprunter des savoirs aux épouses-mères (celles dont les épousailles supposent des alliances entre groupes, la cousine étant la plus privilégiée), comme le tissage et la cuisine qui constituent un gage de reconnaissance. Conscientes de la fragilité de leurs atouts, elles cherchaient à se replacer dans la société comme bonnes ménagères. Les autres épouses, quant à elles, n'étaient pas indifférentes à la façon d'être de leurs nouvelles concurrentes, leur empruntant l'art de l'entretien du corps et de la séduction. Ce sont là des échanges qui montrent combien la société locale s'accommodait de ses déviantes : elle n'encourageait pas la prostitution qu'elle stigmatisait par toutes sortes de méthodes, verbales ou non, mais elle ne l'excluait pas complètement ; elle la tenait plutôt en respect. Au sein de la société locale, prostituée ou pas, la femme restait marginalisée, qu'elle soit dans la condition d'épouse-mère pour assurer la descendance ou dans un statut de femme de plaisir pour que puissent être assouvis les besoins sexuels masculins. Ballottée entre deux sociétés, la femme « indigène » restait donc une laissée pour compte. Ces pratiques qui viennent d'être décrites étaient méprisées par la société coloniale qui avait du mal à les comprendre et à les percevoir. Jusqu'au moment où la raison économique allait l'emporter : « L'Ouled Naïl » (un terme générique qui englobait des statuts de courtisane, concubine, danseuse et prostituée) allait répondre à cette demande. Les traditions prostitutionnelles, méprisées parce que représentatives d'une société « arriérée », furent reprises pour le compte et dans le cadre d'un tourisme « folklorisé ». Le syndicat d'initiative de Bou Saada inséra la « rue des Ouled Naïl » dans son programme de visite comme une « attraction touristique », et fit de la maison de tolérance une « maison de danse ». Une mise en scène dans laquelle la fille publique, consciente plus que jamais de son nouveau rôle, mit à contribution tout son savoir-faire. Mais le commerce sexuel n'était pas la seule chose visée, le syndicat d'initiative ayant introduit dans ses programmes des attractions essentielles, telles les soirées m'bita, nuitées de chants et de danses : les filles publiques exécutaient, pour les touristes, des danses locales, telle la danse naïli, accomplie par deux femmes qui vont et viennent en une démarche glissante et légère, ou la « danse de la bouteille » (danse étrangère à la tradition locale, qui fit son apparition pour la première fois au quartier réservé), où la danseuse portait une bouteille d'alcool en équilibre sur sa tête. La danseuse ne pouvait se présenter à son public et à ses clients qu'affublée du costume « traditionnel », costume qui ne diffère guère de celui des autres femmes. Mais il y avait bien sûr des spectacles plus attrayants, comme la « danse nue » : elle était exécutée en seconde partie du programme de la soirée, moyennant un supplément (aujourd'hui, certaines anciennes danseuses comptent parmi les notables les plus fortunées de la cité). Finalement, ce tourisme du « Ouled Naïl » reposait sur un mythe solidement échafaudé qui mit en échec la loi française du 13 avril 1946 (dite loi Marthe Richard) relative à la fermeture des maisons de tolérance.