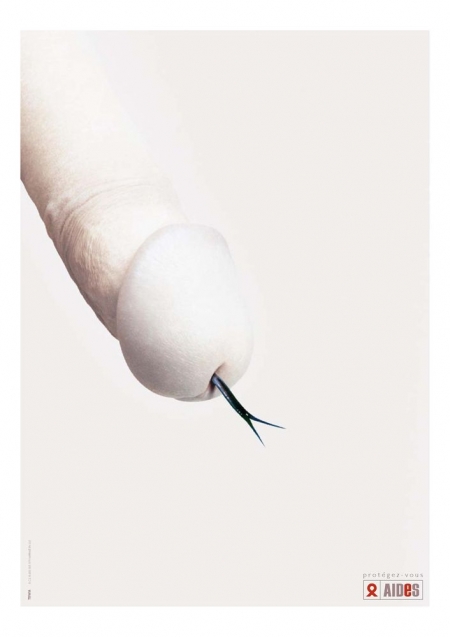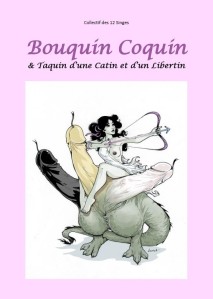 Bienvenue aux mateurs de tous poils ! Ceci est le blog dédié à notre troisième livre autoédité,
Bienvenue aux mateurs de tous poils ! Ceci est le blog dédié à notre troisième livre autoédité,
« Bouquin Coquin et Taquin d’une Catin et d’un Libertin »
(pour nous soutenir en commandant, c'est ici !!!).
Après « Lendemain du Grand Soir », « La philo south-parkoise, ça troue le cul !!! », voici notre essai érotique et réflexif sur la place et l’impact de la sexualité sur nos vies sociales et sentimentales, utilisant des vocabulaires thématiques « neutres » (nature, sports mécaniques, gastronomie, végétaux, sports, musique, drogues) détournés de leur contexte et sens originel pour visualiser des scènes érotiques (l’œuvre reste érotique-chic plutôt que porno-crado !).
Parallèlement à cela, nous avançons sur « Une histoire d’Homo Sexualis » : émergence biologique puis évolution comportementale du sexe, la sexualité chez les autres animaux ainsi que dans notre vaste groupe de primates, puis chez les différents Homo qui se sont succédés jusqu'à nous (même dans l'art préhistorique, constellé de triangles pubiens et de phallus), la vision mythologique du sexe et de la sexualité, la prostitution dans la civilisation.
Catégories
- Bouquin Coquin & Taquin ... (24)
- La prostitution à travers les âges (8)
- La contraception à travers les âges (2)
- La naissance de la sexualité biologique (1)
- La sexualité chez les autres animaux (1)
- La sexualité de la famille primates / Homos (1)
- La sexualité de nos ancêtres deux fois "sages" (5)
- La sexualité dans la civilisation et ses mythes (5)
Recherche
Derniers articles
- Histoire du sexe filmé
- ANNIV' des 5 ans du Collectif des 12 Singes : PROMO à pas chère jusqu'à Noël
- ** COMMANDER ** « Bouquin Coquin et Taquin d'une Catin et d'un Libertin »
- Chapitre 0 : L'innocence de l'enfance face à la montée du besoin/envie de jouissance
- Introduction de Bouquin Coquin et Taquin d'une Catin et d'un Libertin
- Chapitre 1b : Le boum-boum zen dans sa Benz
- Chapitre 1a : Contons fleurette à la belle des champs
- Chap 10b : Plus on est de fous plus on jouit
- Chap 8 : Les Amazones démontent Jésus
- Chap 5 : Heureusement qu'il y a l'Amour, enfin ... !!! / ???
Publications en direct liv(r)e
Liens
- Groupe facebook dédié à Bouquin Coquin
- Blog du Collectif des 12 Singes (et Bonobos)
- Suivi de nos publications en direct liv(r)e
- Une jolie histoire de libertinage : découvrir, pas à pas, les débuts d'un jeune couple dans sa quête du plaisir
- Histoire erotique gratuite (blog pour rendre le pouvoir aux mots)
Il y a un peu moins de 40 000 ans, les variations individuelles étaient fortes, ainsi que le dimorphisme sexuel, toutes proportions gardées : durant l’Aurignacien et le Gravettien (-40 000 à -30 000 et -30 000 à -22 000), les hommes se distinguent des femmes par le degré de robustesse et par une morphologie plus archaïque qui évoque certaines formes anciennes d’Homo sapiens. Mais on est tout de même passé du mini-harem exclusif au sein de la communauté (polygamie) au droit de cuissage prioritaire.
Pour autant, il est intéressant de noter que selon la théorie d’Eve et Out of Africa basée sur l’étude ADN de la répartition des mitochondries (uniquement transmis par la mère), nous aurions tous une mère unique, originaire d'une seule région au sud du Sahara en Afrique il y a 50 000 ans, dont les descendants sont partis à la conquête du monde, en plusieurs vagues rapprochées !
Vers -19 000 environ, on constate une évolution progressive vers une
plus grande diversité morphologique et une plus grande gracilité, ce qui a pour effet de réduire considérablement le dimorphisme sexuel, surtout au niveau du crâne. C’est le début du couple
parental monogame tel que nous le connaissons encore. Il y a quelques 12 000 ans, bien que certains traits archaïques soient encore présents, la morphologie des hommes et des femmes s’avère
très proche de la nôtre, à très peu de choses près.
Ceux qui vivent en ayant acquis un « attachement sécurisant » aiment se sentir responsables : c’est souvent angoissant, mais ces personnes apprécient cette angoisse, car elle leur laisse une part de liberté qui leur procure du plaisir !
Après Homo sapiens sapiens en Israël/Palestine (respectivement -97 000 et -80 000 ans), les plus anciens établissements de type aurignacien en Bulgarie se situent entre -41 000 et -38 000. La première répartition des sites du Paléolithique supérieur se déroule au cours d’un épisode climatique tempéré de -40 à -28 000 ans. La pénétration des premiers humains modernes en Europe survint pendant le méga-interstade prolongé (OIS3, vers -38/-22 000 ans), période sans glace jouissant d’un climat froid et instable et de petites oscillations répétitives : interstade chaud Krasnogorsky (vers -46/-43 000 ans), épisode froid Shapki (sur 200 ans vers -43 000 ans), interstade Grazhdanski (vers -43/-40 500 ans), épisode froid Lejasciems (vers -40 500/-30 000 ans), interstade Dunaevo-Bryansk (vers -30/-23 000 ans).
Le climat est rude sous nos latitudes : 200 000 ans marqués par de longs épisodes de grands froids, entrecoupés de courtes périodes de réchauffement. Plantes, animaux, humains sont soumis à la loi de ces cycles qui ont pour effet de redistribuer les ressources alimentaires, d’où migrations et redéfinition des territoires. Jusqu’aux environs de -40 000 ans, l’Europe est peuplée de Néandertaliens, puis arrivent les humains modernes qui, pour survivre, ont dû s’adapter à des conditions extrêmes, dans des paysages glacés, immenses et désertiques. Pas moins d’une vingtaine d’épisodes glaciaires, étalés chacun sur environ 10 000 ans, se sont succédé, entrecoupés de phases plus tempérées de 10 000 ans. A l’intérieur de chaque cycle, de brèves sautes de température se produisent, qui à chaque fois modifient le climat et la géographie (et donc la répartition des ressources animales). L’environnement des humains qui peuplaient l’Europe au Paléolithique supérieur (entre -35 000 et -15 000 ans) se partageait en trois régions distinctes : le nord de l’Europe, l’Europe centrale et orientale, et l’Europe de l’Ouest.
Au nord de l’Europe, le sol, qui ne dégèle pas, et la couverture neigeuse ajoutent à l’inhospitalité des lieux : ici ne pousse qu’une végétation de toundra (des mousses et des lichens).
A la frontière sud de ces espaces quasi déserts s’étend une taïga, englacée l’hiver et dégelée par endroits l’été. S’y développe alors une végétation éphémère (proche de celle actuelle du Nord canadien ou de la Sibérie, composée de rares pins et de bouleaux nains) et quelques animaux, adaptés aux climats rigoureux y vivent, comme le bœuf musqué ou le renne. Leurs prédateurs sont les bandes de loups et les renards polaires (ou isatis, dont la belle fourrure blanche est convoitée par l’humain).
En Europe centrale et orientale, les grandes plaines froides et les plateaux calcaires sont recouverts par la « steppe à mammouth », formée de graminées, d’arbustes, de lichens et de rares bouleaux. Ce paysage était très semblable aux steppes actuelles de Mongolie : d’immenses espaces où graminées sauvages ondulent avec le vent. Le sud de la Russie bénéficie d’un climat moins rigoureux que le centre de l’Europe : on y trouve une steppe arbustive composée d’herbacées et de bouquets d’arbres (pins, bouleaux, genévriers).
La biomasse fournie par la steppe est quatre fois supérieure à celle fournie par la forêt, grâce aux grands troupeaux qui y vivent.
L’Europe de l’Ouest, la moitié sud en particulier, constitue une zone bien plus hospitalière. Le climat, océanique, y est moins rigoureux et plus humide. La végétation combine une prairie parsemée de pins sylvestres et de bouleaux, où les chevaux pâturent lors des périodes froides, et une forêt clairsemée d’arbres apparaît à chaque réchauffement. La vallée de la Vézère (qui abrite nombre de grottes ornées), dans le sud-ouest de la France, constitue une véritable zone refuge pour les animaux et les humains, avec des bosquets de conifères comme le pin et des arbustes de type genévriers, où les cerfs, les chevreuils et les sangliers se côtoient.
Vers -35 000 ans, une amélioration relative du climat permet l’arrivée de l’humain moderne en Europe. En revanche, une nouvelle détérioration s’amorce 2 000 ans plus tard, laissant place à des pulsations climatiques plus rigoureuses. Parallèlement à cela, on observe un grand nombre d’éruptions dans la chaîne des Puys en Auvergne, avec un pic d’activité vers -28 000 ans.
L'apparition de l'Aurignacien en Europe occidentale se situe autour de -33 000 ans mais certaines datations font parfois remonter cette période aux alentours de -38 000 pour le Protoaurignacien. Le résultat de cette expansion relativement rapide des humains modernes est que l’Eurasie était uniformément couverte de sites clairsemés qui formaient une « nébuleuse aurignacienne ».
Cette industrie venue du Proche-Orient se répand d’abord en Espagne, puis en Dordogne 5 000 ans plus tard. Elle apporte une innovation technique avec le débitage laminaire des silex : production, à partir d’un même bloc, d’un grand nombre de lames régulières et standardisées, autant débauches à partir desquelles il est possible de faire varier l’outillage de base. Pour la première fois, les paléolithiques utilisent les matières dures animales (os, ivoire et bois de cervidés) pour créer notamment des sagaies, des grattoirs et des poinçons pour le travail des peaux et la confection de vêtements. Cette nouveauté transforme profondément les modes économiques et les activités de subsistance (chasse, pêche, collecte), autant qu’elle provoque un choc entre deux systèmes de valeurs, entre deux univers métaphysiques distinctes voire inconciliables. Jamais les Néandertaliens n’utilisèrent les armes d’origine animale ; tout à coup, les humains modernes (Homo Sapiens Sapiens arrivé il y a peu en Europe) commettent ce sacrilège et tournent les défenses naturelles (ramures et « cornes ») contre les proies elles-mêmes.
Le monde du mythe éclate tout à coup : à la place des ramures symbolisant la nature dans les sépultures des Néandertaliens, Sapiens passa aux représentations de la nature, sous la forme d’images, donc artificielles cette fois, disposées au fond de grottes sanctuaires où leurs agencements se déploient. Dans le cas européen (et peut-être seulement là), cette histoire semble enclenchée par la mise en cause des vérités fondamentales d’une population par l’autre : mises en danger, sinon en concurrence, les mythologies, fondées sur des récits abstraits, durent se matérialiser, se donner des formes afin d’acquérir un surcroît de réalité et de permanence. Statuettes et grottes ornées furent alors réalisées, précisément aux marges de cette extension moderne : tout l’ouest, resté néandertalien (culture de Châtelperron), forma le réservoir densifié des traditions antérieures ; aux limites de ce territoire culturel, l’œuvre d’art spirituel apparaît, sanctifiant l’espace là où il doit être marqué de symboles, délimitant les aires spirituelles récentes.
L’image, accédant au statut symbolique, se substitue à la nature véritable. La distinction fondamentale entre Neandertal et Sapiens résiderait ainsi dans l’habileté des humains modernes à connaître et à s’exprimer par des symboles qui sont à la base du discours humain (même si Neandertal pouvait parler, il n’aurait pas conceptualisé un langage symbolique).
Les sociétés font preuve de comportements symboliques nouveaux : les premiers éléments de parure voient le jour (perles en os ou ivoire, bandeaux ou diadèmes, pendeloques taillées et polies en ivoire et pierre, coquillages percés), les petites statuettes animales et les manifestations artistiques pariétales font leur apparition (en Europe de l’Ouest, en France en particulier, dessins et gravures apparaissent vers -32 000 sous une forme tellement parfaite qu’ils pourraient constituer l’aboutissement de pratiques plus anciennes). De telles merveilles sont l’indice de groupes humains fortement structurés, apparemment hiérarchisés et pratiquant déjà une certaine forme de division du travail (la qualité des œuvres mobilières puis pariétales, l’unité stylistique dont témoigne leur découverte sur des sites éloignés suggèrent un certain professionnalisme). Ces modifications entraînent des changements de représentation et de communication dans les relations sociales.
Ces manifestations graphiques (sculptures, peintures, gravures) constituent un corpus multiforme d’images souvent (mais pas exclusivement) animalières, un espace abstrait, un univers imaginaire et symbolique avec référence narrative.
Par cette nouvelle emprise, l’humain s’attaque alors à la nature du mythe en lui donnant une consistance visuelle, mise à son service : la nature du monde y est spirituellement maîtrisée via sa représentation. Ceci entraîna un bouleversement conceptuel radical : la création d’icônes permit d’étendre infiniment le champ d’actions mythiques. Pour les humains de la préhistoire, l’image dessinée sur les parois des grottes fut un moyen de donner vie à l’invisible et au surnaturel. Selon la pensée structuraliste, les contes et les mythes (racontées souvent quand les enfants étaient partis se coucher) évoquent un monde révolu, passé. Les mythologies et croyances des peuples chasseurs restent dominées par le monde naturel : l’animalité y tient la place principale. L’animalité, si proche de l’humanité dans son comportement, forme le véritable symbole du défi inaccessible, lancé par la partie biologique à sa propre conscience : d’innombrables récits mythologiques s’articulent donc selon cet axe où l’animalité règne absolument.
En effet, les chasseurs ne pouvaient s’assimiler aux autres animaux, chassant à pattes nues : les chasseurs n'étaient pas des pilleurs de la Nature, puisque ce serait oublier que la chasse humaine suppose toujours un équipement technique. Le milieu a eu une importance significative, mais ce sont les groupes humains eux-mêmes qui ont été capables d'organiser des stratégies socio-économiques très claires de production et de travail. L'appropriation explique la manière d'obtenir des aliments par le moyen de la chasse, de la pêche et de la cueillette/collecte. Cette base définit le mode de production et le contrôle social sur la Nature par le développement de quelques techniques, d'un travail et de quelques relations sociales spécifiques. Ainsi, il n'y a pas d'adaptation au milieu, mais, par une technologie développée, les humains ont réussi à transformer et surmonter ce milieu qui fut hostile dans les nombreuses étapes du Quaternaire : le contrôle de la Nature est arrivé par le biais du travail en société.
Ainsi, lorsque l’humain moderne débarque en Europe, les témoignages de ses activités spirituelles se multiplient, principalement par le biais de l’art mobilier (portable : statuettes, objets légers) et pariétal (peintures ou gravures sur parois, en grotte ou sur rocher).
Lorsque l’humain se met à dominer le monde environnant (notamment par ses techniques de chasse, bien que calquées sur celles de ses concurrents prédateurs, et ses armes), il montre que la nature est très effrayante, mais qu’il est capable de la conquérir et de la dompter/dominer. C’est ainsi que cet art paléolithique sophistiqué (les principales techniques artistiques étaient pleinement maîtrisées dès le début), présente la caractéristique rarissime d’être en grande partie un art de l’obscurité, le feu maîtrisé permettant aux humains de se rendre au plus profond des entrailles de la Terre, là-même où nombre de carnivores ont élu domicile (ours et lions des cavernes, hyènes, loups). Dans une grotte, on se trouve dans un monde souterrain de terre et de pierre, clos, sombre et mystérieux, dans le lieu même où l’œuvre a été peinte : seuls comptent l’œuvre elle-même et celui qui la regarde, avec ses valeurs culturelles et cultuelles. Il pouvait y avoir des participants multiples ou au contraire des pratiques individuelles de recherche spirituelle dans l’isolement, dans le but de pénétrer un monde surnaturel pour bénéficier des forces qui s’y trouvent.
L’humain tient ainsi à montrer une image exacerbée de l’opposition entre le « dedans » (campements bien organisés et grottes ornées) et le « dehors » (redoutable habitat du monde sauvage).
Toutes les religions placent le surnaturel là où l’humain ne vit pas : dans le ciel, sur les hautes montagnes, dans le monde souterrain dont les portes sont les grottes. La localisation de l’art pariétal n’est pas due au hasard. Généralement, les sites ornés ne sont pas associés à des restes d’habitat, ce qui accentue le choix symbolique de leur implantation, et tous les espaces investis sont des sites exceptionnels, naturellement grandioses, souvent proches de l’eau (pendant la glaciation du Würm, l’essentiel des œuvres est situé dans les massifs calcaires de l’Europe du Sud, dans lesquels les rivières ont creusé des cavernes). L’intérieur de la roche renfermait un autre royaume, celui des esprits, notamment accessibles par le rêve (voire la transe), ainsi que par les peintures magico-spirituelles. L’idée de base devait être de capter la puissance surnaturelle des lieux, notamment lors de rites de passage comme ceux de la puberté ou d’actions pour favoriser la chasse (même si le bestiaire consommé est très minoritairement représenté).
A l’Aurignacien (de -38 000 à -26 000), ce sont les animaux dangereux (rarement consommés, chassés parce que craint et donc sources de fierté) qui dominent. Ces prédateurs ou concurrents immobilisés sur les parois, sont les symboles de la force assimilée par l'Initié qui a su maîtriser la bête et dompter sa puissance, choisissant ainsi de capter et réguler son énergie jusqu'alors destructrice, plutôt que de la tuer et de s'affubler de sa dépouille : symbole, en somme, de la Force mise au service de la Sagesse. On voit ainsi un grand ours des cavernes dessiné à l’ocre dans une rotonde, accompagné par un ours plus petit (équivalent de l’humain – car rare animal à pouvoir se tenir droit –, capable de s’accoupler avec des femmes et de donner naissance à des petits d’humains, même s’il est considéré comme un symbole féminin de part sa fourrure chaude, sa couleur brune comme la terre et l’éducation attentionnée qu’il donne à sa progéniture) ; des félins (le lion est un symbole masculin, lié au soleil, de domination : il détient une grande énergie, qu’il maîtrise cependant de manière souveraine, sans avoir besoin de faire montre de sa force ; mais on ne peut pas contrer celle-ci quand elle rentre en action, faisant du lion un adversaire redoutable) ; des rhinocéros (dont celui de la Salle du Fond dessiné en noir avec de nombreux traits rouges soulignant ses cornes, sortant de sa bouche et marquant son flanc) ; des mammouths et mégacéros.
Les thèmes, empruntés à la nature environnante, faisaient l’objet d’une sélection qui accordait ainsi une nette préférence aux animaux forts et dangereux, ainsi qu’aux représentations sexuelles féminines (de manière beaucoup plus discrète, sans tenter de rivaliser avec les grandes fresques animalières des grottes – on trouve plutôt leurs peintures dans les endroits confidentiels).
Après la bipédie, la deuxième grande révolution pour la sexualité est la mise en place de tous les systèmes de représentations pour le corps, lien social par excellence. Au sein même des sépultures, la différenciation des sexes est essentielle pour le groupe (les hommes apparaissent plus nombreux à avoir été enterrés que les femmes). Dans l'art, le corps est segmenté : la main, les parties sexuées. Or l'image sexuelle n'est pas neutre, puisque l'effet d'image a modifié la sexualité en créant l'émotion, les réactions, la séduction. Ainsi, quand l'humain a mis en place des systèmes de communication, il s'est affirmé comme étant différent de tous les autres animaux et dans cette différence, l'expression de la sexualité est très active.
Chez les humains, la perte de l’œstrus (ensemble des phénomènes physiologiques liés à l'ovulation et à la fécondité) permit une disponibilité sexuelle absolue (non soumise à des périodes de rut). C'est ce qui fût la raison d'être des normes et des interdits qui, dans toute société humaine, limitent les usages et les pratiques de la sexualité (la mauvaise utilisation du sexe à l’intérieur d’un groupe de parenté peut être la cause de sanctions surnaturelles, lancées par les ancêtres pour qui l’inceste est une transgression capitale, la maladie et la mort étant le résultat du non-respect d’un tabou sexuel), notamment l'inceste qui est à la base du fondement de tout groupe social (comme le disent les Jivaros : « L'incestueux est comme le ver de terre, il rentre dans le premier trou venu »). L'inceste (du latin incestus : « impur ») désigne une relation sexuelle entre membres de la même famille et soumise à un interdit. Toute la difficulté réside dans la définition de ce que sont des parents trop proches (l’inceste sœur-frère est le plus craint parce que cette relation est à la base de l’organisation familiale comme du système de parenté), et il y a de grandes variations selon les sociétés et les époques, et même selon les circonstances (la Bible, par exemple montre l’inceste, normalement interdit, comme un impératif pour sauvegarder une lignée vouée sans cela à l’extinction). Il y a ainsi une typologie de l'inceste fondée sur le discours social à propos du degré de proximité et le genre de parenté biologique, imaginaire et symbolique, discours social d'où découle le sentiment incestueux.
Cela n’est pas un hasard, car ce qui est en cause, c’est ni plus ni moins ce qui nous distingue des bêtes. C’est en effet une évidence de l’anthropologie universelle et du sens commun de dire que nous autres, les humains, à la différence des bêtes, vivons sous le règne de la Loi, le mot culture signifiant distinction et discrimination. La prohibition de l’inceste symbolise et focalise la conscience que nous partageons tous de vivre sous le règne de la norme et non selon les nécessités de la nature, elle est donc fondatrice de l’identité de l’individu dans son rapport aux autres.
Pour autant, s’il était vrai que c’est la prohibition de l’inceste qui distingue la nature de la culture, il faudrait considérer que les autres animaux sont beaucoup plus cultivés que nous car l’inceste est rarement pratiqué chez les autres animaux (en milieu naturel – même s’il peut y avoir initiation sexuelle par un parent, mais jusqu’à un certain âge seulement –, autrement la domestication a sélectionné et forcé les individus les moins regardant sur l’inceste afin de favoriser la transmission de certains caractères), alors qu’il est relativement souvent consommé chez les humains. Il en est ainsi de l’ « aversion » de l’étalon à l’égard de l’inceste. On lit ainsi dans l’Histoire des Animaux d’Aristote : « Les chevaux ne couvrent pas leurs mères, et même si on les force, ils s’y refusent. En effet, il arriva qu’un jour, manquant d’étalon, on recouvrit la mère d’un voile et on lui amena son rejeton. Pendant la saillie le voile tomba : alors le jeune mâle consomma l’accouplement, mais peu de temps après, il mordit l’éleveur et le tua. On raconte aussi que le roi de Scythie avait une jument de race dont tous les poulains étaient bons : voulant avoir un produit du meilleur de ces poulains et de la mère, il la fit amener pour la saillie. Mais le poulain ne voulait pas. On couvrit la mère d’un voile et il la monta sans la reconnaître. Mais après la saillie, on découvrit la face de la jument, et le poulain à cette vue prit la fuite et alla se jeter dans un précipice. Les chevaux, en effet, conclut Pline, ont aussi le sens de la parenté. Ces observations et ces jugements ont précisément la domestication pour origine, l’idéal domestique étant ainsi défini par Aristote : « Les étalons couvrent même leurs mères et leurs filles, et le haras est considéré comme parfait lorsqu’ils saillissent leur progéniture » ; quand la nature résiste à la pression de l’éleveur dont l’objet est la sélection et la reproduction de caractères utiles et non le polymorphisme de la reproduction sexuée.
Dans les populations naturelles, l’inceste n’est la règle, pour d’évidentes raisons, que chez certains vers parasites dont l’écologie interdit la reproduction exogame. On constate, d’ailleurs, chez certains hermaphrodites qui ont la faculté de s’autoféconder, que la « préférence » va à la fécondation croisée, l’autofécondation, dernière chance de la reproduction, n’ayant lieu qu’en situation d’isolement. L’intérêt de l’exogamie sur l’agamie (reproduction asexuée, division), sur l’autogamie et sur l’inceste serait donc un intérêt sélectif. La description des structures sociales de populations naturelles de mammifères fait apparaître l’existence de mécanismes qui ont pour effet de limiter ou de prévenir les contacts sexuels entre individus apparentés. Chez les animaux supérieurs, les plus importants de ces mécanismes sont : le changement d’objet, la répression de la sexualité et, du point de vue de la femelle, la réaction de rejet, enfin l’émergence de revendications d’autonomie qui entraînent l’expulsion.
On a écrit qu’il pouvait y avoir des accommodements même avec le ciel ; en fait, la culture permet des accommodements même avec la génétique [la pathologie culturelle, avec ces incestes si peu exceptionnels chez cette exception naturelle qu’est l’humain, démontre aussi, et de manière critique, sa liberté quant aux injonctions de la nature et la « variabilité de l’humeur » (labilité : instabilité de certaines composantes de la personnalité, en particulier l’attention et l’affectivité) humaine par rapport à la règle de l’inceste, universelle par excellence]. Il y a ainsi des écarts entre les règles de la culture et les pratiques réelles, l'inceste ayant lieu dans des sociétés qui ont des interdits de l'inceste.
Le mariage et l’exogamie (chercher son partenaire dans un autre groupe) sont donc les deux noms d’une même réalité, le refus de l’inceste, et si l’exogamie constitue une loi générale de la reproduction, il n’est nullement absurde de rechercher la trace de dispositifs génétiquement fixés, hérités de la sélection naturelle, qui seraient perceptibles dans la constitution émotionnelle de l’humain avant d’être relayés et systématisés par la loi (ce tabou étant une norme établie par la société, par l’accord régulier des individus, cela implique donc que la société existe avant la prohibition).
On définit en effet la liberté de mariage à partir du seuil où « s’éteint l’odeur de la parenté », souvent bien au-delà de la « zone d’horreur » (« inceste absolu »), c’est-à-dire entre parents et enfants ou entre frères et sœurs. Tout un programme auquel les travaux récents sur la communication chimique dans le monde animal (sur les phéromones qui véhiculent les messages chimiques de la communication animale), donnent consistance. On sait en effet que l’humain ne possède pas seulement un nez « conscient » chargé d’identifier les odeurs, mais aussi un organe qu’on croyait fossile et inactif, l’organe voméronasal, véritable « nez sexuel » (certaines traditions, coutumes ou proverbes attribuent à la sueur, par exemple, un grand rôle dans l’empreinte sexuelle et dans la séduction). Le jugement relationnel est affaire de nez, dit-on, ce qui témoigne de manière empirique du rôle de l’odeur dans la régulation de la proximité et des engagements affectifs : « Cette personne, je ne la sens pas, je ne peux pas la blairer ! » (un blair étant un nez, comme le blase – à rapprocher de nom/surnom et de blason, identité d’un clan ?). L’appareil olfactif se signale en outre par une exception qui le distingue des autres systèmes sensoriels : l’absence de relais thalamique ; l’information est directe de la muqueuse olfactive au paléocerveau, dénommé rhinencéphale (cerveau-nez), intéressant à la fois l’olfaction, l’émotion et la mémoire (circuit de Papez). Ainsi, la perception olfactive équivaut à la lecture d’une carte d’identité génétique. Cette reconnaissance s’opère vraisemblablement par l’interprétation des gènes d’histocompatiblité que le système immunitaire exprime pour reconnaître le soi et le non-soi. Ces signaux moléculaires sont évidemment des indicateurs de la proximité génétique (toutes les cellules d’un même organisme doivent savoir qu’elles sont « sœurs ») et ce sont des protéines issues de ces signaux qui, en passant dans les odeurs corporelles, transmettent aux humains l’ « odeur de la parenté génétique ». De fait, on s’accouple préférentiellement avec des partenaires génétiquement dissemblables car c’est le non-soi qui est sexuellement intéressant, parce que conforme au plan de la reproduction sexuée.
Pour autant, l’idée que le respect du tabou réduirait le taux de défauts congénitaux causés par les relations sexuelles entre parents trop proches, n’est pas valide : premièrement, la proximité des parents n'implique pas directement des défauts congénitaux (elle augmente la fréquence des gènes homozygotes, avec pour effet la réduction de la fréquence du gène défectueux dans la population), deuxièmement, l'interdit contre les relations ne repose pas sur des préoccupations strictement biologiques/génétiques. Effectivement, cela ne se limite pas à la parenté directe : en effet, une tendance croissante à la gêne, plus marquée chez les filles, fortement teintée d’antagonisme à l’égard de l’autre sexe, se développe au seuil de la puberté envers des sujets du même groupe (mais non apparentés). Les filles tentent de cacher leur nudité aux garçons ; leur intérêt se tourne alors vers des jeunes gens de l’extérieur. La raison invoquée par les adolescents eux-mêmes serait qu’ils se sentiraient comme « frères et sœurs ». Cet exemple constitue un parallèle évident des mécanismes de rejet et d’inhibition des relations sexuelles engendrés par la familiarité (par la proximité et non par la parenté). La préférence va donc à l’ « étranger », car l’herbe est toujours plus verte ailleurs.
Pour Freud, la frustration sexuelle, née de la nécessité de limiter la sexualité pour notamment éviter/limiter l’inceste, est à l'origine du langage, de l'intelligence, de la magie, de l'art et de la structuration de la société.
Les plus anciennes figurations féminines connues (et donc humaines puisque les hommes ne seront que plus tardivement représentés, alors que c’est eux qui pratiquaient la mise à mort à la chasse – activité en contact direct avec les autres animaux et donc les forces de la nature –, les femmes s’occupant essentiellement de la collecte – part importante de l’alimentation, car régulière et non soumis à la chance –, du feu et du foyer au sens large) remontent à la culture aurignacienne (de -38 000 à -26 000), mais elles ne concernent qu’une zone géographique limitée au Jura Souabe (Allemagne), à la Basse-Autriche et au Sud-Ouest de la France. La Vénus du Galgenberg (Autriche), surnommée « Fanny » ou « la danseuse », serait la plus ancienne statuette féminine connue à ce jour : il s'agit d'une petite figurine de schiste vert, maladroitement parée d'un sein sur le côté gauche du corps, et qui est âgé d'au moins 30 000 ans. Elle est montrée dans une attitude dynamique (ce qui est très rare dans l'art paléolithique), un bras levé contrebalancé par une jambe fléchie. A la même époque, dans le Sud-Ouest de la France, on ne trouve pas de statuettes féminines (alors qu’on a trouvé à Chauvet un phallus en os, daté de -29 000), mais des « vulves » (triangles pubiens) gravées dans la pierre, exprimant l'apogée des organes génitaux à l'Aurignacien : ainsi, dès la naissance de l'art, l'humain grave sur le rocher des séries rythmées (cupules – signes pleins féminins ; bâtonnets – signes minces masculins), mais il représente aussi des triangles pubiens ou des phallus. La tendance au réalisme et au naturalisme ne se rencontre pratiquement jamais chez les premiers peintres ou graveurs aurignaciens, pour autant, les triangles pubiens (graphisme utilisé couramment par les Aurignaciens sur les blocs gravés) et phallus (bien plus rares) traités de façon réaliste sont plus fréquents dans les phases anciennes, aurignacienne et gravettienne, que plus tard, où ils se transformeront en signes géométriques plus ou moins explicites.
Les triangles pubiens constituent un thème tout à fait particulier de l’art paléolithique, figure banale et fréquente. L’extension dans le temps et l’espace est également très importante : les triangles pubiens traversent sans variations notables les époques et les cultures préhistoriques. Jamais plus cette partie du corps féminin ne sera représentée aussi souvent et avec un tel soin. Même si spectaculaires, ces représentations élémentaires du sexe féminin ne sont pas fréquentes : actuellement, on compte en moyenne un triangle pubien par millénaire.
La forme des images pubiennes est dans l’ensemble assez simple : un triangle dont la pointe est marquée par une bissectrice plus ou moins étendue. Une fente modeste serait à l’évidence suffisante pour marquer le caractère sexuel d’une figure qui autrement ne serait qu’un triangle plus ou moins arrondi. Bien au contraire la fente vulvaire paléolithique est toujours très marquée voire disproportionnée. Fente ou béance, cette déformation constante qui rend visible ce qui ne l’est pas normalement n’est pas le fruit du hasard. La fréquence de ces images témoigne de l’attention portée au sexe de la femme dans ce qu’il a de plus secret, et peut-être, de plus passionnant. Cette outrance représentative est le juste pendant de l’ithyphallisme (phallus dressé).
À l’exception de ces contextes, la simple allusion au sexe doit être évitée. Ce comportement est lié à la peur de l’inceste. L’inceste est une menace permanente et toujours présente à l’esprit de chacun, si présente que cela devient l’un des facteurs les plus importants dans les conduites à avoir et concerne tout particulièrement les femmes. L’inceste est l’un des pires événements qui puisse advenir à une famille puisqu’il peut avoir pour conséquence la rupture des liens de parenté qui structurent l’ordre social. La mauvaise utilisation du sexe à l’intérieur d’un groupe de parenté peut être la cause de sanctions surnaturelles, lancées par les ancêtres pour qui l’inceste est une transgression capitale. En brisant le tabou de l’inceste, les frontières qui définissent les liens de parenté sont transgressées, parce que les liens de parenté sont définis par une absence de contact sexuel. L’inceste peut être perçu comme l’invasion d’une entité par son contraire : là ou règne la famille, il n’y a pas de sexe et, vice versa, l’intrusion du sexe annihile tout lien de parenté. En évitant toute connotation sexuelle, l’espoir est de ne pas réveiller les appétits sexuels entre gens incompatibles, en particulier entre les frères et les sœurs. C’est ce qui cantonne le sexe à la clandestinité.
L’ignorance qui mène à l’inceste représente un danger latent lié au sexe et duquel il faut se méfier. C’est le cas de « l’ignorance des organes sexuels » : un père et sa fille commettent un inceste suite à l’ignorance inhabituelle du père vis-à-vis de l’utilisation et de la nature des organes sexuels de sa fille. Le plus souvent il s’agit d’un couple formé par un frère et une sœur, l’inceste frère-sœur étant le plus dangereux des incestes, parce que la relation frère-sœur est la relation de parenté principale. L’ignorance des enfants s’explique par leur jeune âge, d’où l’importance de les instruire et des les éduquer aux besoins nécessaires de la reproduction tout en prenant en compte les dangers de la sexualité mal maîtrisée. Le danger se trouve dans le corps même des humains et les esprits surnaturels ne sont pas nécessaires pour rendre le sexe dangereux (même dans le « simple contact incestueux », qui n’implique pas nécessairement une relation sexuelle). Le danger émane du corps des femmes plutôt que de celui des hommes : ce sont les organes génitaux féminins qui provoquent le désir des hommes et mènent à une situation catastrophique, d’où les règles qui régissent la distance entre les gens qui doivent éviter toute relation sexuelle sont liées aux organes féminins. Le comportement général des femmes est ainsi conditionné par la continuelle préoccupation qui consiste à cacher cette partie de leur corps de façon à ne pas exciter les hommes de la famille.
Ainsi, les représentations sexuelles féminines ne tentent pas de rivaliser avec les grandes fresques animalières des grottes : elles sont beaucoup plus discrètes, on trouve plutôt leurs peintures dans les endroits confidentiels.
La grotte Chauvet est un grand sanctuaire Aurignacien situé en face du Pont d’Arc (Ardèche), merveille naturelle, voie de passage primordiale perçue comme un signal ou un symbole par les préhistoriques. Alors qu’on y note encore la présence de l’ours à -35 000 puis lors de deux phases (entre -30 000 et -28 000, puis vers -27 000), que le site avait servi voire servait encore de repaire aux loups, lions, renards, hyènes, deux grandes périodes artistiques y sont représentées : la plus ancienne se situe entre -31 000 et -27 000 (court épisode froid : végétation steppique avec zones protégées plus humides près des falaises), la seconde entre -25 000 et -23 000, éventuellement une troisième période vers -21 000. Le secteur du Panneau des Chevaux est l’une des zones les plus denses de la cavité, avec de nombreux chevaux et bisons regardant dans le même sens, ainsi que deux rhinocéros affrontés. Sur un ensemble de points-mains (grosses ponctuations rouges par l’impression de paumes de mains enduites d’ocre, technique pour la première fois mise en évidence dans une grotte ornée), les mains de chaque panneau n’appartiendraient qu’à un seul individu, tantôt une femme, tantôt un homme, assez grands (1,80m) ; on constate également de nombreuses empreintes de pied d’un individu jeune dans la Galerie des Croisillons. On trouve en outre un tas de pierres aménagé en face du Panneau des Mains positives.
Dans la Salle du Fond, sur la paroi droite, on voit des signes de type Chauvet, faits de deux demi-cercles accolés. A la fin de la galerie, à côté du panneau des lions, il existe un dessin qui épouse le contour d’une stalactite, pendant rocheux de forme phallique : cette composition inclue un bison à main et bras humain, penché vers un être à tête de lionne qui a un triangle pubien et des cuisses de femme. Il s’agit du premier « nu » féminin, réalisé il y a environ 33 000 ans, suggérant un esprit femme-lionne important dans la mythologie de cette époque.
Vivant dans la nature, les humains ont eu besoin d’invoquer des esprits protecteurs, domiciliés au fond des cavernes, royaume des lions des cavernes et des ours en hibernation. De par les formes de la roche sous la lumière vacillante des torches, ils pensaient que les esprits des animaux vivaient dans les grottes. La peinture agissait alors comme médiateur entre le monde réel et celui de l’au-delà (dessins si expressifs qu’on les croirait bouger), l’univers étant divisé en trois parties : étage inférieur des esprits, sol d’habitation intermédiaire, étage supérieur du ciel.
L’ours et le lion (notamment la femme-lionne) sont beaucoup présents à Chauvet.
L’ours est considéré comme l’équivalent de l’humain car il est un rare animal à pouvoir se tenir droit, capable de s’accoupler avec des femmes et de donner naissance à des petits d’humains, même s’il est considéré comme un symbole féminin de part sa fourrure chaude, sa couleur brune comme la terre et l’éducation attentionnée qu’il donne à sa progéniture (à Chauvet, grand ours des cavernes dessiné à l’ocre dans une rotonde, accompagné par un ours plus petit). En cosmologie, on voit dans la constellation du grand chien (qui dessine, appuyée sur deux étoiles écartées, une ligne oblique qui monte de l'horizon vers Orion, et se termine par Sirius, le phare stellaire blanc-bleuté le plus remarquable du ciel entier) un animal dressé sur ses pattes arrières dont Sirius constitue, bien logiquement, la « tête ». Par son éclat exceptionnel et sa position au pied du grand alignement, au bord de la Voie Lactée, Sirius, tête du Chien d'étoiles, s'érige, dans tout l'hémisphère nord, en repère saisonnier sans rival. L'Inde garde les traces d'un ours, Riksha, maître du royaume de la nuit que parcourt la « Vierge lumineuse » conductrice des âmes. Riksha est détenteur du joyau le plus brillant du ciel, la Syamantaka : or Syama est un des noms de Sirius. Cette silhouette d'ours redressé, gardien du flot des âmes, qui correspond assez bien aux lignes de la constellation, peut être une des clefs de l'apparition de l'image de l'ours dans bon nombre de mythes et de cultes eurasiens, en accord avec l'hibernation saisonnière si remarquable de l'ours qui s'endort en Automne pour s'éveiller à la Pleine Lune voisine de l'Équinoxe de Printemps.
L’ours se manifeste comme un signal ambiguë, à la fois porteur de passage par la mort et riche d'espoir en la renaissance de la Vie : à travers la tradition orale, sa silhouette paraît se confondre avec celle de l'ancienne « déesse-mère » qui a présidé aux origines de la tribu ou du clan et aux grands rites saisonniers, telle la rencontre avec les âmes à la Pleine Lune voisine de l'Équinoxe d'Automne (danses de transe d'automne, saison du Passage des Ames). Pour autant, on note l’extrême rareté de témoignages relatifs à des pratiques funéraires pendant l’Aurignacien.
Parallèlement à cela, on voit à Chauvet des clans entiers (dont des couples) de lions des cavernes (félin rarement représenté ailleurs). Il s’agit de peintures pour s’approprier la puissance de l’animal ou sa fertilité en le multipliant sur les parois. Le lion est un symbole masculin : il détient une grande énergie, qu’il maîtrise cependant de manière souveraine, sans avoir besoin de faire montre de sa force ; mais on ne peut pas contrer celle-ci quand elle rentre en action, faisant du lion un adversaire redoutable. On note toutefois la présence d’êtres anthropomorphes à tête de lion, mais en tant que femme-lionne. Comme l’aigle, le lion est un animal symbole de domination, dont la constellation est liée au soleil (force de l’animal, pelage brun-roux et crinière qui semble rayonner), puisqu’il peut le regarder sans ciller, même si plus largement, il peut aussi symboliser le ciel tout entier, qui engloutit chaque soir le soleil.
Au centre de la salle située au fond de la grotte Chauvet, se distingue, peinte sur une stalactite, la moitié inférieure d’un corps de femme qui épouse la concavité de la roche. Le sexe (triangle sombre, coloré de pigment noir, est creusé en sa pointe inférieure d’une fente profonde de 4 cm) est entouré de hanches rondes prolongées par deux cuisses charnues et une ébauche de jambes en fuseau (le corps est représenté dans sa moitié inférieure, en partie effacée par l’image d’un bison qui lui est superposée). Un corps de femme sans visage, réduit au ventre, au sexe, à la fente d’une vulve, à la courbe d’une hanche : cette « Vénus » de la grotte Chauvet est située au centre d’une composition qui associe symboles masculins et féminins : au-dessus d’elle, deux félins, un mammouth et un petit bœuf musqué, tandis qu’un bison lui est apposé sur sa droite (ce dernier, être composite dont la patte antérieure ressemble à une main humaine, a pu être interprété comme un « sorcier »).
Lorsqu’on trouve à Chauvet cette composition avec un bison, un triangle pubien et une tête de lionne : le bison exprime le principe masculin (alors qu’en astrologie il est féminin car lunaire par ses cornes), la lionne le principe féminin (alors qu’en astrologie il est masculin car solaire par son pelage) ; au milieu, le triangle pubien représenterait un esprit maternel de la fécondité entouré de ses deux créations.
C’est la différence sexuée observable et le privilège détourné de l’enfantement des deux sexes par les femmes qui constituent le socle dont tout le reste de la réflexion humaine est issu. La plupart des groupes humains se signalent par une forte domination masculine et perçoivent les femmes comme des êtres potentiellement dangereux et polluants (craintes liées au sang –notamment menstruel, puisqu’une femme saigne régulièrement sans en être affectée, à contrario des animaux blessés – et ses inquiétants pouvoirs, d’où des pratiques rituelles homosexuelles), leur accordant une place limitée dans leur conception de la génération et de la reproduction sociale, se contentant de ritualiser la valorisation des liens utérins et le rôle essentiel que joue la figure maternelle dans les représentations de la procréation. Ainsi la valence différentielle des sexes, moteur interne de l’organisation des systèmes-types de parenté est-elle étroitement liée à un ensemble global de domination du masculin sur le féminin (donc du paternel sur le maternel) dû à la domestication du privilège qu’ont les femmes d’enfanter les deux sexes. En quelque sorte, un système de parenté est un artefact uniquement établi pour rendre compte du fait que les femmes font des enfants … des deux sexes.
Mais il est cependant permis de se demander en quoi la réflexion primordiale des humains originaires sur la nature même de l’être sexué, dans ses substances et dans sa chair (ce qui est une donnée universelle irréfutablement constante dans le temps et l’espace), entre en ligne de compte dans la mise au point de l’interdit sexuel. Dans la forme universelle de dominance du principe masculin sur le féminin, on retrouve évidemment les notions principielles d’identité et de différence. Mais ce qu’il convient de bien comprendre à ce niveau est que ces ressorts essentiels de toute pensée classificatrice, et donc de toute pensée, sont issus directement de l’observation originelle par les humains de l’inébranlable différence sexuée et peut-être aussi de quelques autres oppositions naturelles, tout aussi peu manipulables par l’humain, comme l’opposition alternée du jour et de la nuit. Nous penserions peut-être différemment et d’une manière que nous ne pouvons même pas soupçonner si l’humain et le monde animal le plus visible n’étaient pas sexués.
Matrice de toute forme de pensée en tant que source du système de catégories binaires opposables qui gouverne nos raisonnements, et argumentations tant profanes que savantes, la différence observable par le seul truchement des sens se fonde sur les appareils anatomiques et les fonctions physiologiques si nettement différenciés selon les sexes. Mais si cela suffit pour comprendre l’origine du système des oppositions et même l’affectation (tacite ou explicite) dans chaque culture à une catégorie sexuée de chacun des pôles des catégories traitant du rapport concret aux choses (ainsi dans notre propre culture actif, chaud, sec, haut, fort, rugueux, etc., sont-ils masculins, tandis que passif, froid, humide, bas, faible, lisse… sont féminins), cela ne suffit pas pour comprendre pourquoi ces catégories sont hiérarchisées, le pôle considéré comme relevant du masculin étant positivement marqué et supérieur à l’autre (on ne trouve pas, ou rarement, d’égalité par le neutre).
Derrière le jeu logique entre réciprocité et symétrie, parallèle et croisé, identique et différent, s’observent des représentations locales du corps, de ses substances et de ses humeurs qui sont adaptées non seulement au fonctionnement matrimonial mais plus profondément à l’édiction des règles de la prohibition de l’inceste tant à l’égard des consanguins que des alliés (inceste de deuxième type) et à la domination masculine quasi-universellement observée.
Dans l’ignorance absolue du rôle des gamètes et de la génétique (ignorance qui va durer jusqu’à la fin du XVIIIè siècle pour les unes et au début du XXè pour l’autre) si ce n’est du rôle déclencheur du rapport sexuel, il fallait expliquer et ce privilège et la raison qui faisait que d’une forme puisse sortir une autre forme, que les femmes puissent enfanter des garçons. En outre, si la fécondité était bien l’apanage des femmes, il s’ensuivait logiquement que la stérilité était imputable également à un mauvais vouloir ou à un mauvais fonctionnement du féminin.
Il en est résulté un état remarquable par le retournement qu’il implique : la prise en charge, par le côté masculin de l’humanité, de l’initiative et de la responsabilité dans la procréation, puisqu’il fallait faire en sorte que les femmes acceptent d’être fécondes et d’enfanter des fils. Les riches systèmes de représentations que l’on trouve dans chaque culture montrent le rôle dominant de l’homme dans l’acte procréatif et la genèse d’un nouvel enfant et pas seulement dans l’implantation de fils dans le corps des femmes, celles-ci pouvant ne fournir parfois qu’un espace de développement ou la matière nécessaire au malaxage et au façonnage d’une forme reconnaissable de l’espèce humaine où vont s’insérer le souffle, la vie, l’identité, venus de l’homme (comme on le voit dans le modèle aristotélicien où la naissance d’une fille est déjà en soi une monstruosité, le signe d’un développement non contrôlé de la matière féminine). Si certains systèmes partagent la responsabilité et les apports entre les deux sexes, il est rare, même en régime matrilinéaire, que tout vienne des femmes.
Il faut alors rappeler la distinction opératoire qu’il est nécessaire d’établir entre deux règles généralement confondues : celle qui organise l’appartenance sociale et institutionnelle d’un individu à un groupe (du type lignage), et celle qui commande les représentations de l’identité, de la proximité, et, par là, des interdits sexuels ou matrimoniaux. Si, « socialement » parlant, les sociétés peuvent souvent être qualifiées de « patrilinéaires », ce sont en revanche les femmes qui apparaissent comme les vecteurs essentiels d’une identité commune. Les représentations du corps et des substances corporelles (sang, lait, sperme) nous parlent donc bien dans ce cas d’identité, de « parenté » (avec son inventaire des interdits et empêchements matri-moniaux), mais non de « filiation » et de droits (patri-moniaux, tels l’héritage). De ce registre de « l’identité » découlent les interdits du « trop proche » et de l’incestueux.
Les notions d’identité « biologique » et de réglementation des interdits sexuels et matrimoniaux font la part belle au lien féminin. Le fœtus est explicitement le résultat de la mixtion, dans la matrice, du sang maternel et du sperme paternel. Une fois que le mélange sperme-sang « a pris » (l’apport de l’un et de l’autre se faisant à part égale), l’issue se ferme et les menstrues restent bloquées afin d’assurer une fonction nutritive. Le sang maternel nourrit alors de façon exclusive le fœtus et forme son sang propre. D’autre part, une partie des aliments consommés par la mère se transformera également en sang et passera dans le corps de l’enfant. Le père n’intervient ainsi que durant la phase de la conception, tandis que l’apport maternel non seulement intervient durant cette phase, mais est ensuite le seul agent de la croissance fœtale.
La transmission du sang s’effectue donc exclusivement par voie utérine, et, par la suite, le lait maternel est censé augmenter encore la quantité de sang dans le corps du nourrisson. Un homme et sa sœur sont de la sorte tous deux formés du même sang maternel, mais celle-ci sera seule apte à le transmettre à ses propres enfants. Il s’ensuit que les enfants de la sœur d’une femme seront considérés en tous points comme sa propre progéniture.
La filiation ne joue pas en fait le rôle structurant. C’est plutôt l’analyse du rapport entre paternels et maternels, entre preneurs et donneurs, qui permet de comprendre la structure sociale d’un groupe à travers la diversité des pratiques matrimoniales et des modes de filiation (la relation entre filiation et normes matrimoniales peut être critiquée, il vaut mieux distinguer le « groupe de parenté » du « groupe de filiation »).
Pour contrebalancer l’hégémonie des substances féminines, l’être humain est perçu comme un composé de multiples substances caractéristiques chacune d’une souche agnatique (descendance par les mâles d'un même père), mais d’importance inégale.
Chacun possède donc huit souches sanguines agnatiques : en premier vient celle du sang du père, du lignage paternel, transmise par le sperme, puis en second, transmise par la moelle osseuse qu’on tient de la mère, vient la souche sanguine agnatique du lignage de celle-ci. Ce sont là les deux souches majeures, dominantes. Viennent ensuite de façon moins marquée, récessive, les souches de la mère du père et de la mère de la mère (souches agnatiques, répétons-le), puis enfin, sur le mode résiduel, celles de la mère du grand-père paternel, de la mère du grand-père maternel, de la mère de la grand-mère paternelle, puis enfin de la mère de la grand-mère maternelle.
À sa naissance, chaque être humain dispose de quatre souches provenant de son père et de quatre souches provenant de sa mère, par une redistribution du feuilletage dans l’ordre ci-dessus, avec pour effet le rejet des souches qui étaient résiduelles pour les parents dans un ensemble faiblement différencié. Il suffit ainsi de trois générations pour que s’évanouissent les traces résiduelles des arrière-grands-mères des parents d’un enfant.
La valorisation de l’un des partenaires s’accompagnant nécessairement de la dévalorisation de l’autre, c’est ce double mouvement qui permet de comprendre la composition des groupes.
Les règles sociales d’alliance, qui impliquent très majoritairement l’échange des femmes par des hommes entre eux complètent le dispositif en établissant de façon sûre non seulement le social, la solidarité et une entente relative entre les groupes humains, mais aussi une sorte de redistribution des capacités reproductrices féminines, de la vie. En regard de leur descendance masculine aussi bien que féminine, les hommes exercent une tutelle qui prolonge leur capacité de former des alliances en échangeant les filles. Du côté des mères, cette maîtrise est impensable : entre une mère et la progéniture issue de son corps, il y a une familiarité aussi irremplaçable qu’anonyme. Ainsi, du côté paternel, il est possible de faire et défaire la filiation, alors que la lignée utérine est au contraire le lieu d’une transmission ne pouvant ni être altérée ni être transgressée. L’analyse des unions consanguines montre que si la règle d’exogamie lignagère est parfois transgressée, celle qui suppose la prohibition du mariage entre individus apparentés en ligne utérine ne l’est jamais. En effet, s’il y avait relation sexuelle avec une consanguine à sa mère, cet inceste serait une manière d’épaissir le sang de la lignée, sorte de revanche de l’ethnie sur la filiation, de la femme sur l’homme. On se trouve donc en face d’un système matrimonial où l’identité née des femmes semble plus forte (puisqu’elle interdit toute conjonction d’individus la partageant) que celle née des hommes, dont la conjonction est, sinon permise, du moins possible puisque parfois réalisée. Il serait excessif cependant d’en conclure que la relation paternelle serait purement « sociale » tandis que la relation maternelle serait « naturelle ».
Ainsi, l’inquiétude que de façon générale les hommes manifestent à l’égard de la filiation n’a peut-être pas d’autre origine que cette prééminence accordée aux « vieux liens du sang » dont la femme n’est, au fond, que le relais, le lieu de passage, et que, dans cette société-là, on aimerait ne pas penser obligé. Le problème est tout aussi classique : ravir en somme à la femme la transmission du sang, et par conséquent, l’hérédité de l’ethnie (le nom n’y suffit pas).
On en déduit que la relation entre le père et le fils est presque toujours interprétée en termes d’ambivalence et de rivalité. En effet, voulant préserver son ethnie par la transmission du nom (par lequel se répète la destinée), le père voudrait que le fils garde sa fille (et donc sœur), voire prenne sa femme (et donc mère). De cet antagonisme « naturel » entre le père et le fils, de cette tension entre le nom qui se transmet en ligne agnatique (par les paternels) et l’ethnie qui se perpétue en ligne utérine, résulte probablement la tentation de l’inceste entre frère et sœur. C’est la tentation de l’inceste « pur et parfait » : le frère, se rendant compte que la virginité de sa sœur doit être détruite afin d’avoir réellement existé, détruit cette virginité par l’intermédiaire de son beau-frère, l’homme qu’il voudrait être s’il pouvait par métamorphose devenir l’amant, le mari ; par qui il voudrait être ravi, qu’il voudrait choisir comme ravisseur, s’il pouvait par métamorphose devenir la sœur, la maîtresse, l’épousée.
L’inceste se place ainsi dans un ensemble complexe liant les représentations du corps et de la personne, les rituels du cycle de vie, le système de parenté et la construction sociale de la différence des sexes.
Dans les sociétés de chasse au Paléolithique, les relations humaines entre les peuples étaient paisibles (aucune trace de guerre n'a encore été fournie). Les blessures observées sur les ossements n’étaient jamais dues à des pointes en silex, mais étaient, au contraire, souvent consolidées : les blessés étaient donc pris en charge par la société, ce qui implique la coopération. En fait, le climat de paix de cette époque peut s'expliquer par la constitution d'alliances entre les tribus paléolithiques, avec échanges de femmes (ou d'hommes), l'exogamie étant le moyen d'éviter les guerres endémiques (l’échange des jeunes géniteurs d’un groupe à l’autre – constaté également chez d’autres primates – créant des alliances) tout en permettant l’évitement de l’inceste.
Les populations du Paléolithique supérieur étaient constituées d’unités sociales isolées au sein desquelles il y avait plusieurs familles apparentées par les liens du sang, et dont le nombre fluctuait périodiquement entre 5-10 et 15-20 familles. Dans plusieurs cas on peut noter l’installation de groupes « co-résidents » qui comprenaient plusieurs unités sociales distinctes avec des habitats semi-permanents dans une région limitée, très riche en ressources naturelles (animaux et/ou matières premières). La stabilité des grands groupes sociaux n’a jamais été absolue : leur style de vie nécessitait des déplacements saisonniers considérables au sein d’une « zone d’exploitation », ce qui impliquait des rencontres institutionnalisées avec d’autres groupes résultant de l’établissement d’ « alliances négociées » et de réseaux d’unions (matrimoniales ou autres). Ces derniers comportaient un ensemble de relations sociales marquées par une circulation régulière des personnes et des biens (apparition d’un réseau complexe d’échanges relié au système hydrauliques des grands fleuves), et par des liens d’intensité et de durée limitée.
A partir de cette époque, les hommes se défient pour prendre la tête d’un petit groupe (au sein d’une plus grande communauté) composé de plusieurs femmes. Il y a un peu moins de 40 000 ans, les variations individuelles étaient fortes, ainsi que le dimorphisme sexuel, toutes proportions gardées : durant l’Aurignacien et le Gravettien (-40 000 à -30 000 et -30 000 à -22 000), les hommes se distinguent des femmes par le degré de robustesse et par une morphologie plus archaïque qui évoque certaines formes anciennes d’Homo sapiens.
Des études génétiques montrent ainsi que les femmes auraient connu une expansion démographique importante entre -70 000 et -20 000 alors que l’expansion démographique des hommes serait beaucoup plus tardive.
Cela ne signifie pas qu’il y avait plus de femmes que d’hommes durant cette période, mais qu’un petit nombre d’hommes donnait naissance à beaucoup d’enfants. Cela laisse à penser qu’ils vivaient et se reproduisaient avec plusieurs femmes, alors que les autres hommes n’avaient pas ou peu de descendance.
Des « entités ethniques » se sont donc développées, cela se marquant par des comportements rituels et stylistiques d’une part, par des interactions génétiques et culturelles intenses entre les groupes d’autre part. Les provinces du Sud-Ouest de l’Europe correspondaient au degré le plus élevé du « réseau d’alliance ». Malgré leurs distinctions locales, les groupes culturels composant chaque province présentaient beaucoup de similitudes fondamentales dans le mode de vie et le symbolisme.
Les groupes établirent des relations actives avec des groupes économiquement et socialement semblables, interactions documentées par la dispersion des matières premières sur de longues distances (200 km, mais aussi des trouvailles isolées à 500 voire 800 km), échanges actifs dans une région considérée comme correspondant aux migrations saisonnières des groupes ou aux réseaux d’intermariages (le décor de grottes dans l’Yonne est fortement influencé par celui des grottes de l’Ardèche, style venu avec des personnes depuis le Sud par la vallée du Rhône).
Les interdits matrimoniaux se définissent ici en termes négatifs, règles négatives énoncées et connues par tous. L'inceste est absurde socialement, les individus s'entendant à ne pas mettre au contact l'identique à lui-même (sachant qu’au-delà de la consanguinité biologique, la consanguinité sociale est souvent arbitrairement et variablement définie par la lignée paternelle).
L’idée sous-jacente nous amène à la problématique centrale de l’identique et du différent : trop d’identique nuit et tout « cumul d’identique » est préjudiciable à l’entourage comme à la descendance en raison d’effets supposés d’assèchement, de dessiccation et de dépérissement qui accompagnent la stérilité des unions provoquée par ce cumul ; mais trop de différence est également néfaste (comment rendre compatibles l’un avec l’autre des sangs qui ne se connaissent pas, qui ne se sont pas déjà mêlés ?). L’idéal se trouve donc quand les sangs sont déjà quelque peu familiers l’un avec l’autre, mais à bonne distance tout de même.
À chaque fois qu’une ligne a été sélectionnée pour fournir un « conjoint » (définition neutre et asexuée) à un membre d’une autre ligne, tous les individus de la ligne qui a donné sont exclus du domaine du choix pour la deuxième, au moins pendant plusieurs générations. Cette structuration des interdits matrimoniaux permet aussi bien des mariages dans la consanguinité éloignée (6è degré ou plus) que les redoublements d’alliance au sein d’une même génération, en particulier le mariage de deux frères avec deux sœurs (type d’union érigé au statut de règle positive d’alliance).
Si l’interdit de l’inceste entre consanguins est bien fondé sur la crainte et le rejet du cumul de substances identiques en nature, dans le domaine de l’alliance, l’interdit portant sur ces alliés avec qui un individu est apparenté (essentiellement soit par l’intermédiaire direct de son conjoint, soit par l’intermédiaire d’un de ses géniteurs ou parents sociaux), est dû au même refus de mettre en contact des substances identiques, cette fois-ci non de façon directe mais par le biais d’un partenaire commun ; c’est l’inceste de deuxième type (valable tant pour les alliés que pour des individus tiers en relation avec des personnes consanguines entre elles). Si, par exemple, le fils d’un homme couche avec l’épouse de son père (qui n’est pas nécessairement sa mère), il se met par l’intermédiaire de celle-ci en contact direct avec l’essence de la substance de son père, et plus encore, en raison de l’identité substantielle entre le père et le fils, avec la sienne propre. L’interdit, fonctionnant comme un court-circuit, empêche (ou cherche plutôt à limiter) la mise en contact de deux substances identiques. Ainsi, dans le choix du conjoint, l’essentiel est que des notes dominantes et même récessives (où il faut avoir deux porteurs pour que le caractère s’exprime, comme pour les albinos par exemple), ne peuvent pas être présentes en double chez le même individu. C’est surtout entre porteurs des mêmes marques résiduelles (non pas des « tares » récessives, mais des caractéristiques qui se dilueraient trop dans les échanges) qu’il est bon de se marier. Une telle théorie explicative rend compte absolument de toutes les prohibitions énoncées en termes lignagers et de consanguinité.
Le processus se répétant à chaque mariage, le résultat ne peut en être qu’une « turbulence » permanente au rebours des régularités engendrées par le mariage asymétrique.
Cela résulte de l’impossibilité de boucler totalement de façon logique les systèmes, en faisant se correspondre étroitement les points de vue des descendants de frère et des descendants de sœurs entre eux. Une « pesanteur structurale » due à l’effet de la valence fait de l’ensemble des filles du lignage, quel que soit leur niveau générationnel, des équivalents de sœurs/filles pour tous les hommes de ce lignage, quel que soit leur niveau généalogique.
S’il est bien question ici d’un refus de l’inceste, c’est pourtant moins une forme particulière de mariage qui est visée que la répétition outrancière de telles unions car, si l’on n’y prêtait garde, l’inceste finirait par confondre ce qui ne saurait l’être : les lignées, les peuples et les différentes parties du monde. Un groupe est exogame lorsqu’il interdit tout mariage entre ses propres membres, endogame lorsqu’il interdit tout mariage avec un membre d’un autre groupe, ceci défini par les règles de filiation (ou fondés sur la proximité individuelle). Ainsi, le mariage dans un degré rapproché est une négation de l’échange.
Ces logiques d’identique et du différent peuvent expliquer non seulement la pratique de tel ou tel mariage mais aussi l’enchaînement des mariages, les préférences, les évitements mais aussi les prohibitions.
On peut ainsi pratiquer l’alternance de mariages proches et de mariages lointains, de cycles courts et de cycles longs, qui permet ainsi de dépasser l’antinomie endogamie vs exogamie. Il ne s’agit pas, en effet, d’étudier cette alternance comme la simple succession de choix individuels opposés, mais de prendre en compte la dynamique d’ensemble : la valorisation du mariage patrilatéral s’accompagne nécessairement d’autres « stratégies », tandis que l’allongement des cycles ou le mariage avec des étrangers accroissent l’instabilité du système, et donc appellent des « stratégies » opposées pour revenir à plus de stabilité. Ce « jeu » entraîne ainsi une oscillation permanente : si dans les générations antérieures il y a eu des mariages lointains, plus prestigieux, un type de mariage au plus proche suivra, dès lors justifié par la volonté de resserrer les liens entre enfants issus de différentes mères, comme si un mariage d’autant plus lointain avait pour conséquence immédiate un mariage d’autant plus proche.
Tout se passe comme si chaque société pouvait être positionnée à une place qui lui convient et qu’elle peut partager avec d’autres, sur un vecteur orienté allant du plus grand attrait pour l’identique à la plus grande aversion, doublée d’un attrait, pour le différent. Nonobstant les variantes culturelles que l’on observe, il s’agit toujours d’une mécanique où identiques et contraires peuvent soit s’attirer, soit se repousser et entraînent ce faisant de manière automatique des effets considérés soit comme bénéfiques, soit comme maléfiques. Toute pratique dans l’un ou l’autre sens, cumul ou écartement, a toujours pour fondement la crainte ou le désir d’un effet attendu et contraint.
Pour ceux qui pratiquent l’inceste plutôt que le mélange, la tare plutôt que le bâtard, cela signifie à terme l’arrêt de mort de la « maison » (ensemble des liens au sein d’une famille élargie) qui ne peut plus s’accrocher à un sol, ni s’inscrire dans la durée, ni perpétuer une ethnie en danger de s’éteindre à force de se vouloir pure, en peine de se reproduire à force de chercher à cumuler l’identique, en proie à la répétition du Même par crainte qu’il ne soit souillé par l’Autre. Les « maisons » n’auront donc été que de « petites îles », limitées à leur architecture familiale/clanique, symbole ironique d’une communauté qui se voulut homogène – de même ethnie, de même lignée, de même territoire– dans une aire pourtant composite et mouvante, dont les diversités n’étaient pas seulement de l’ordre du décor.
Le concept d’inceste est donc une règle sociale de gestion et de contrôle des relations, ceci visant fonctionnellement à créer une alliance entre groupes distincts. En effet, si chaque famille conserve ses femmes (c'est-à-dire si les femmes d'une famille n'épousent que des hommes issus de la même famille), il n'y a pas d'alliance possible entre familles, donc pas de société humaine. Il n'y a que des groupes. Ainsi, la fonction essentielle de la femme est de maintenir les liens sociaux en étant donnée, échangée, afin que les familles soient alliées, et qu'une société existe.
Pour autant, les communautés maintenaient de façon stricte l’identité des groupes (maintien des connaissances de leur forte continuité avec les groupes des cultures ancestrales des époques précédentes). En effet, si le mélange c’est s’approprier ce qui nous a séduit chez l’autre (progrès palpables – production, technologie, connaissances –, innovations conceptuelles – spiritualité, organisation, gestion des groupes), le mélange est aussi un feu orange envers l’autre : « j’y vais » ou « je n’y vais pas » ? Les marqueurs identitaires sont alors comme des garde-fous pour éviter la dissolution des identités dans un mélange devenant fusion.